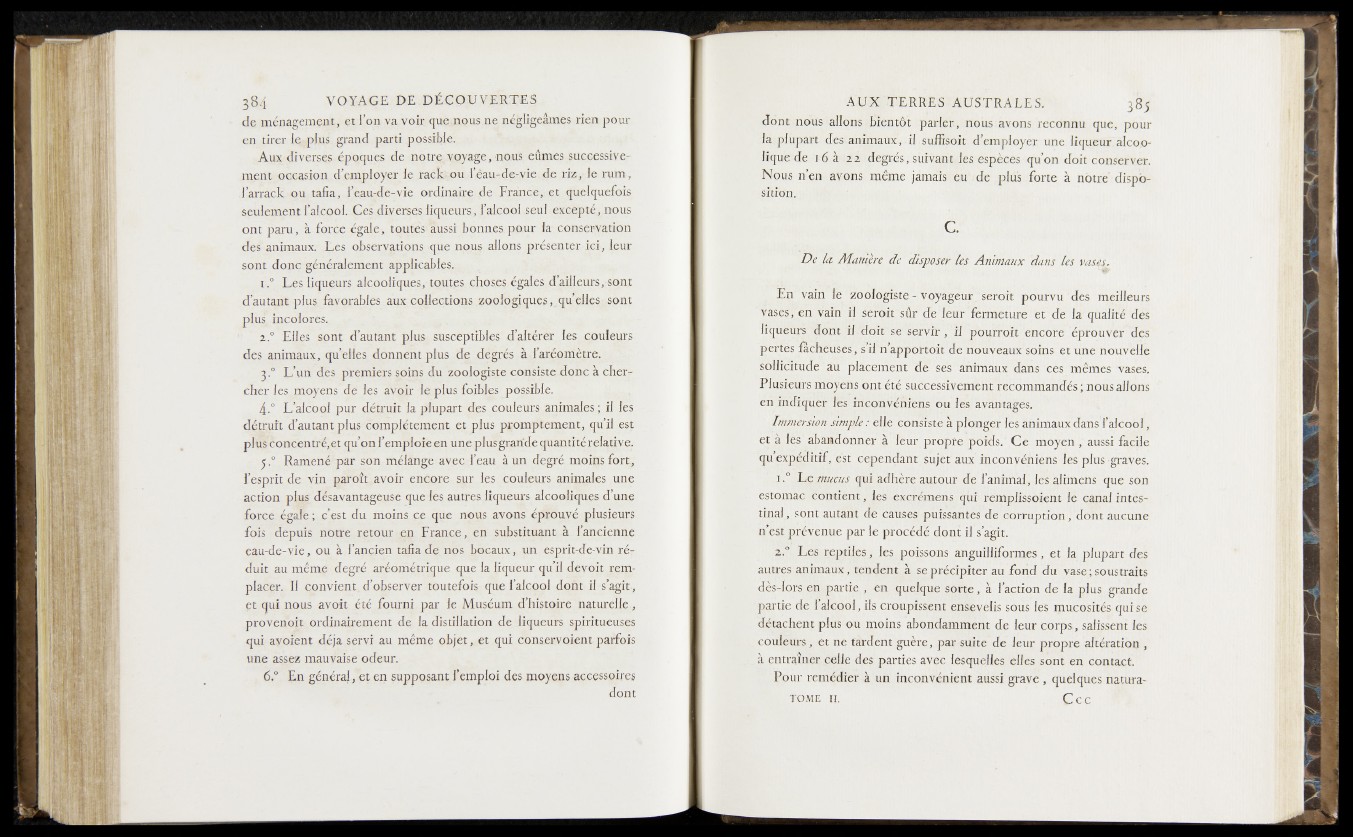
de ménagement, çt l’on va voir que.nous ne négligeâmes rien pour
en' ;tfeer :lq§pfiis; grand parti pçssitjie.
Aux diverses, époques de notr%y^y-age, -no,ds eûmes suçoessiVe-
ment ^occasion,, d’employer le racî^oud’êau-d&rjyic do riz, le- rym-,
l’arraek-ïOii. tafia, l’eau<de-vie ordinaire de .France; et quelquefois
seulement l’alç^ol. |2es diverses liqueurs, l’alcQ^fesenl excepté, nous
ont paru, à force .égale, toutésyïussi bannes,pour la' conservation
de£ animaux. Les observations que nota? allons . présenter,-idy.feur
sont donc-généralement applicabfe^&e
i .° Les lîqupurs alcooliques, toutes çfto^égale^çLaijleurs,;sont
d’autant -plus, favorables _aux, cojleçtions .zoofogique^qu’elle^sont
plus, incolores;, J
2.” Elfes sont d’autant pluSÿ susceptibles d ’altérer les QDuIeurs
des animaux, qu’éMes^ donnent plus de dëgrés àd’arépnî^e,
3.0 L ’un des premiers soins du zoologiste pM|iste^dQji(; a chercher
les moyens"de les avoir lopins' foibl& p o^ ^ fe M
4.' L ’alcool pur défeuit la plupart des xoufedriüânimales.il l'es
détruit d’autant plus"complètement et plus promptement, qu’il est
pî®conc^ntrS^$ qu’en l’emploie en une plus graifde quantité relative.
- 1 y,° RamenéJ‘par son méltnge avecri’eâu à up-dgfeé moiqrs fort,
l’esprit de, vin paroîp avoir encore §ur ,Jç£ ^couleurs animales mne
action p t e désavantag^se que les autres Jiquémsralcooliqùç,s. d’yne
force égaiipnest du moins ce que nojis avons' é^ oM é jply|ieqr?
fo^^depuis notte retour jm Fraqcq , en' yid^stituant Aj*l’ancienne
eau-de-yie, ou à l’ançjen tafia de nos feôcaux, un esprit^ejejn ,rér
dùk au même degré aréoxnétrigue que la liqueur qu’il dévoit^ein-
placpr. II convient, d’observer toutefois que l’alcéol dont ibs’agit*,
pt qui nous avoit été fourni par ,fe Muséum d’histoire "naturelle.,
provenoit ordinairement de la distillation de liqueurs spiritueüses
qui ayofent déjà servi au même objet*,et.qui/cônseryoient,parfois
une as.se« mauvaise odeur.
6 ° En général, e t ep supposant l’emploi des pioyeçs aceess^lreï
dont
AXTX TERRES AU STR A LE S . 385
"dfin-t nous allons ^bientôt parler., nous avons reconnu que, pour
la plupart ifes s animaux,. i l . suifisoit d’employer,- une liqueur, alco.o-
lique'de 'véi-ik^zi dégris, suivant, les' espèces qu’on doit conserver.
Nous n’en avonsymeme jâmais?tà*vde plus, , forte à nôtre disposition.
c .
De ta 'Manière ' de 'disposer les Animaux dans les vases.
, En vain le zoologistdr^oyâgeur “ seroit pourvu des meilleurs
Vffi^^en éain il JérdiLsÛr de leur Xermetüîpljgt de la'qualité des
1 icjueqls^ôrit il'ifdoit" i^ b r v ir , i l0 pourrait encore éprouver des
4e/tes’ filrhe usps ; s i 1 *n’app o r toi t aê A ôû v eauxsoins et une nouvelle
®llicitude^ au placement' d©||||f aniinaux ,%âûs ’cès mêmes''vases,
Plusic t lis ont étd^mc^sivemeii^ècommandés ; nous allons
erijndiqup ^jes/frij. op\ c nr<|j|s^où iês: kv’ajîtagés.
Iw/nèijum^nple ('Hdlônsftlpa'] Longerïtglninlaux'daiis’l alcool,
et J a illi abaa-donn.ergi’ leur'prqpïe p oids.'jüe .moyqn , aussi facile
rqv|^®ttifô^^2çe^ndant"/sujéf aux’ i&convéniens ’les plus graves,
I , t qui adhère autpur- <fe l’animaipieljalimens que son
estomac|^r|Giè.pt, les lexcrî4|qens,i qui remplisspïent le canal intestinal
jjfflnt auras? deoaipWp u is s an tefpçfc oriuptio n!/don t aucune
n’ëâtpr-évenue par Ié§||racede dont i f s’agit.'
2,° Les repjd|es,;J |^ n ofesons anguilliformes, et la plupart des
autres - animaux,' tendent précipiter au ' fond du 'vase ; soustraits
dèsHprs; en marrie , err quelque^ôrte, à l’action de la plus grande
partie,de l’alcool, ils crpupjs&e&t ensevepts^us les naucosités qui se
détachent plüS ou moins abondamment de leur corps-, salissent les
couleurs, et ne tardent guère, par suite*de' leur propre altération >
ijk entraîner celle desfmarries avec lesquelles e ll^ son t en contact.
Pour remédier à un inconvénient aussi grave, quelques natura-
TOME II. C c c