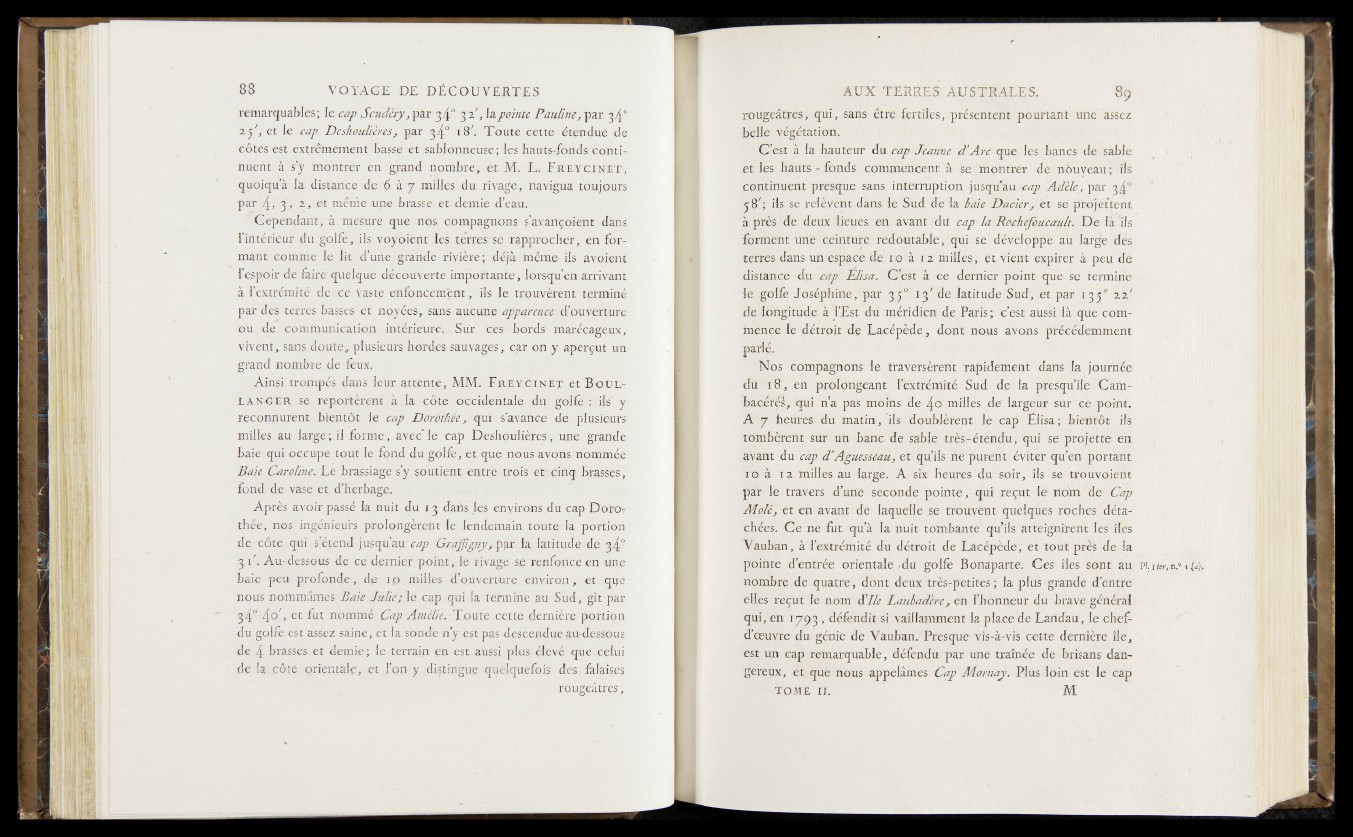
remarquables; le^cap^cud&y, pgr qpl,îlapeinte Pauline, par,!â^
2 5 et. le ecap> Deshouhpres,, par 3^° mj$\ Toute cettes?!ëienduè de
dotes est èxtrémementjbass,ete,&îsabiom-eS.I4Fles bauS-fôridsp^ktiï
nuent.â s’y mqhtier?en grand nombre.;-'ett.M.cÉ. Freycinet,
quoiqu’à la, distance de>é$àh4milles,,düu rivage, navigua toujours
par/4>~3> 2j et meme une’bmlsdiet demie d’eau. .
^’Cependant, à mesure que; nos-compagnons, -s’àvançoient dans
l’intérieur du.golfe, ilsïw>y©ient les térrés^ë-.-rappr qcheiy “en formant^
comme le dit* d’une.1 grandë/riyi§re| déjà ‘même iis1 avdient
■ Fdspjoir dëfStrë quelque dé^ut^rtè- impoff^nte, lorsqu’en-arrivant
à l’extrémité devaste enfoncejp^nt, iik$ïe trou^èdébt 'terminé'
par des terres -bassé^iiet noyées, .sans, aucune apparerikeÎ et’ouvertnre
ou de, communication intérieure .u Sur c!§ b^d||îSd^%"â§;eux,
vivefet,; sans doute., plusieurs hordes sauvages^,car on yéajl^çut un
grand nombreîcfe $eux.
Ainsi trçôipés dans lepr attente, MM. FRE^,^t^è‘,5Edet Bo;tgiV
lAn-^ser-,sejT.epoiïèrent à la cote occidentale;"dit .g « f4 : dsi y
^ C onnurent bientôt le cap Dorothée, qui
milles au large ;_il forme, avec*le cap Ded^o'uhfo'élx, une. grande
baie quijACCUpe. tout le,fond du golfe, no us avons^^riifiâ'ée
Baie Caioline. Le_brassiaggs’y s.outient^entre froi|aèjî^çi®q bradés
fond dé vase et. d’herbage.
Après-avoir passé la nuit du 13 dans leÿenvirons d!ù çap.Dok)*
thée:, nos ingénieurs, prolongèrent, fe- lendemain tcfutp l|4?ô’Etion
der§pte^qui s’étend jusqu’au cap, Craffigny^,'p^xA?^'^^}%P-àe ..deniA9
ÿ i '. Au-dessous de ce dernier point, le rivage se renfonce en une
baie peu profonde, de 1 p milles d’ouverture environ, et que
nous nommâmes Baie Julie; le cap qui la termine au Sud, gît par
34° 4p7j et M1. nommé Cap Amélie. Toute cette dernière portion
du golfe est assez saine, et la sonde n y. est pas descendue au-dessous
de 4 brasses et demie; 4e terrain en eft.aussi plus^lfevé que celui
de la côte orientale, et Fon y distingue quelquefois des falaises
rougeâtres,
rougeâtres, qui, sans, être.fertiles, présentent pourtant une assez
belle l^gjÉatfohy â
' Cfe|$*à l'a hâdtèuf àUmàp^Peühtîe d ’Arè que les*bancs de sable
et feafeauts 7 fonds1' commencent ^?‘!sc^montrèr de nôuveau ; ils
contidutenü presque ;;s#rïs, interruption jusqu'au*-oz/ Adèle, par 34°
y8’; ils. spfode vent dànsTé^tid .de \a.bdie%Dd’cief, èt se’ projettent
àLprè's’d-é dieux iHuêS^eh.’diVant du cap$l^Rochefoucauld. De la Ils
forment unie ceinturé*redoutable, qui se dé’fèloppe au làrge des
'terres'dans un'ëspace de tWfàti'Cmilles -,‘ et vient'expirer à* peu de
distance à\y pàpf Elira; C’est à ce dernier point que* se terminé I
lè golfe Joà^»hrne,'par--3^?"ïÿ'dè latitude Sud, et pari kpÿ0 22/
cfe&Égitudé du méridien-çfe/Pàæis ; »è’esf aussi là que comménce
lèfdétroit de Lacépède-, dont nous àvonsH précédemment
parlé,
‘^fNds compagnons'le traversèrent rapidément dans la journée
du 18, eh prolongeant" l’extrémitédSüd de la presqu’île- Cam-
bkjérés/ qui n’a pas moins de 4® millës'de forgéàp Sur ’ce point.
A ^heures du m,atin, ils doublèrent le cap Elisa ;1 bientôt ils
tombèrent sur un banc dessable .trëlféi^idu, qui se projette en
avant àri^c&p.d’Acpüesiedu ,'ét qu’ils dépurent ^évitersqu’èn portant
,r© à 12 millfes âu forge. A six 'hèufe's du’!éoir',dii>se trouvoient
par. Iè-travers d’une“ seconde pointé',-qui reçut lè nom de Cap
Mêm, et eh avant dfe laquelle trouvent qûelqüèsNfblîlîpsI'déta-
ch^sïqitlè‘pëifut^qu’à la nuit tombante qu’ils atteignirent les îles
Vauban, à l’extrémité du détroit de Lacépède, e% tout prêt de la
pointe d’entréè orientale -du gêlfé-Bonaparte. Cîèt îles sont au w.uir.ns 1 (4,
nombre de quatre*, dont deux très-pétifes ; la plus grande d’entre
elles reçut le nom à’Ile Laubadère, en l’honneur du brave général
qui, en 1-793 ; défendit;^vaillamment la place de Landau, le chef-
d’oeuvre du géniède Vauban/ Prèsque^v-is-à-vis cette dernière île,
est un cap remarquable /défendu par une traînée de brisans dangereux,
et. que nous appelâmes Cap Mornaÿ. Plus loin est le éap
'ij 11. M