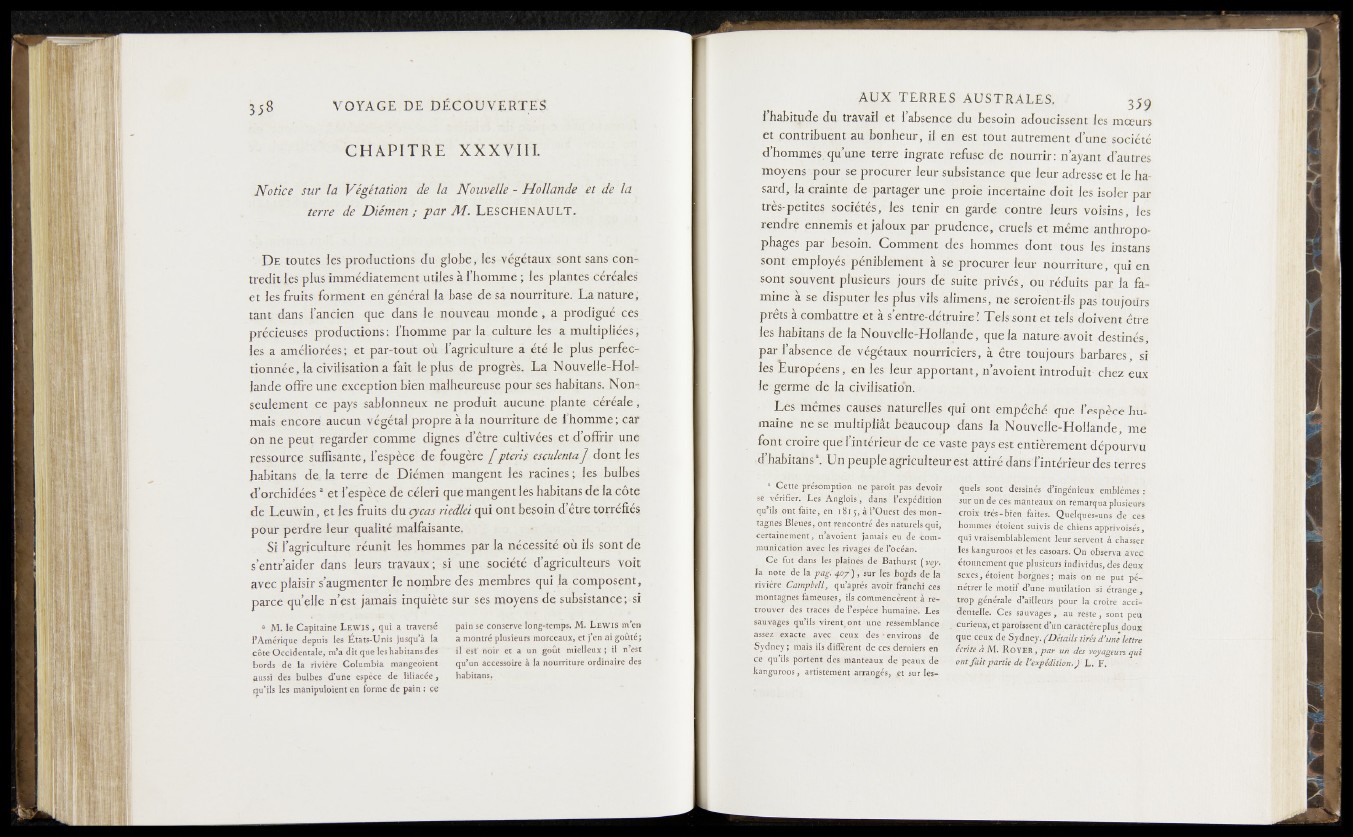
CHAPITRE XXXVIII.
Notice sur la Végétation de la Nouvelle*- Hollande et.de la
- *&nefrW D tétoën / p a r M . L é sch enAü l t .
• D e toutes, ies productions du globe, les -végétaux* sont sans- con^
tredit iestplus immédiatement utiles à l’homme ; tes. ^plantes céréales
et les fruits forment en général la basé de-sa-1 nourriture.- La nature-;
tant dans l’ancien que dans le nouveau monde, a prodigué çes_
précieuses productions; l’homme par la.cukürê les a multipliées^
|es, a améliorées.* et par-tout .où l’agricuiturç/ë été le plus,perfectionnée
, la civilisation a fait le plus de progrès, La HoUVelle-Hoh
lande offre une, exception bien malheureuse- pourvus hal^tans, Jibn-
seulement ce pays sablonneux ne produit, aucune, plante céréale ,
ynais encore aucun végétal propre a la nourritutreLde l’homme; car
qn.ne peut regarder comme dignes.dette cüki^eç^^d’offiir^une
ressource suffisante, l’espèçg de fougère [ pûris çscukntp^%Qri%im
fiabiràTis déTit terre de Diérqeh * mangent, les; raèines. vi|^SHhj^be^
d’orchidées a et i’espèçede cëlerique mangent-tés hahkans de laxôte
de Leuwin, et les fruits àxuycas riçdlei qui ont besoin d’être torréfiés
pour perdre leur qualité malfaisante,
$i {’agriculture réunit fçs hommes par la nécessité où jls sont de
s’éntr’aider dans. Jéfiçs travaux ; si une. soejétç d’agricuhpufs voit
avec plaisir s’augmenter je nombre des membres qui la composant,
parce quelle npst jamais inquiète sur ses moyens de subsistances si
a M>de Capitaine LEWlS-^quia, traversé
l’Amérique depuis les tEtats-Unir jusqu’à la
cSte Occidentale, m’âtdjt que les habitans des'
bords de la rivière Columbia mangeoient
aussi Sfes bulbes d’une espècè . dè liliacée,
ou’ils les manipulojent fojrnie dç pain ; çe
pain se conserve long-temps. M. LEWi9 m’en
a montréplusieu-rr morceaux, et j’en, ai goûté)
il ësT Tîoir et a-un goût mielleux ;®il>, n’est
qu’un aeéësstfké à la nourriture ordinaire
habitans,.
-l’habitude du- travail et l’absence du besoin adoucissent les moeurs
et contribuent au bonheur , il en * est, tout autrement d’une société
d’hommes-.qu’une terre ingrate refuse, de nourrir: n’ayant d’autres
moyen!-pousse prppurer leur subsistance que leur adresse et le hasard,
Ja crainte départager une proie incertaine doit les isoler par
tres-petiteç soejétés, les tenir pn garde* contre leurs voisins, lés
rendre ennemis ët jaloux par-prudence,, cruels et même anthropophages
par-- besoin’. Comment, dëfcfiommes dont tous les instans
sont emplfÿé^péniblement à ^procurer leur nourriture, qui en
sont souvent plusieurs jours de suite privés, ou réduits par. la fa-
mine^vsé'disputer $èh plusjvife alimens, ne seroient-ils pas'toujours
.paiêÊS|a;€omèat<treuet à -s’entre-détruire ! Telssont értels* doivent être
les habitans de?la«ié@^elle-‘Hoilande, que la nature-avoir destinés;)
par l’abiseï|.c%de végétaux npûrrieiers, toujours barbares, si
les Européens,,en fescieur apportant, n’aboient introduit- chez eux
le germe de la civilisation. -
EêSrmentes cafses naturelles qui ont emplie- qtfe l’espèce hid
riiaine n^èï.multipliât hêauG’oup dans l’a NnùvÉfehHohâ'nde:, me
font croire'tpte 1 intérieur de ^^'ÿastè pay§h!t entièrement dépourvu
•d4foabitahs-a.TJn peuple agriculteur est ëttfcé dansfintérfeurdes ferres
■* Cette M’e-dmpy'on rft; ptiVoiKpa ,.devoir
séJ vérifier.-Les "Anglqisïj dans "Ÿ^p<$mt\p*
^bü’ibiQnt'laitii, en 181 OuësV'dèsimôny
^rignes Bleues, ont rencontre tifs nàtu/tlFouf,j
fcérfainçmiDri, ii.aVefenj?-y/Wai-v
mnnieariegBi av§u-I'es| ri yages; é&n’. "jf.
fut cîara Its plajnes de iBfcth-trst tvry-
la iweicfe , sbr'Iës- bords ffe la
rivière Cajtipbell.J qu’àgfel| avoirîfl^fc'lîi éfes-
montagnes fùm,eu-.es, ils tomnjerùçurerina reh
'trouvenaes traces- de l’espete* IiumaihV.’”Les*
sAyvagej qu’ils Vjirenl^ont une ressemblances t
asse?tjgx^ct.e avec - ceux 1 d e^^yjrw s, «oh:
«Sydney ; maii.irs different" de ce^jlernieVs-cm
^e- qu’ils p o'rè'^A," y è^p|an t eaux p’eàux~dè:-,
art-istemènt arrangés, f t fur.lesjquujs
^sorù^'Jes^int's ^d’ingénieux emblèmes':
'fsu'rxrn de,ces manteaux tnùreinàrquiaplusieurs
IfcS^ljèsTfiiM’iajtps.- tJluèlqüës-uns- ,de ,ces
"In^ijmï’rttOKnt-tint de thuiis ppmow-s,
qu^l^isêAblafâéittlnV-jleuf servent à" chasser-
tetef’ka!i|gqjMç®q^vçasoars. lÔri observa .ayec
L^BnynMtflT'p bltftnjut iqdrt idu jiffpdepix
éïoKiùtiorgnlsj'm’îrWon ne put péi
Jrictrer le'moût c^w-e mUtiI.itron -si étrange ,
a^ntelIe^C'es’i^^agÆ, au reste',-Suit peu
-curieiMc) et,pàroïssent 'd’un-caractère pi-us doux
d ^ 1Sûi& d’itne lettre
écr$e ’|n des voy-dgiu^qui
ont fâïtpattiè d'è 'U'expékitiûn. ) ' L. F.