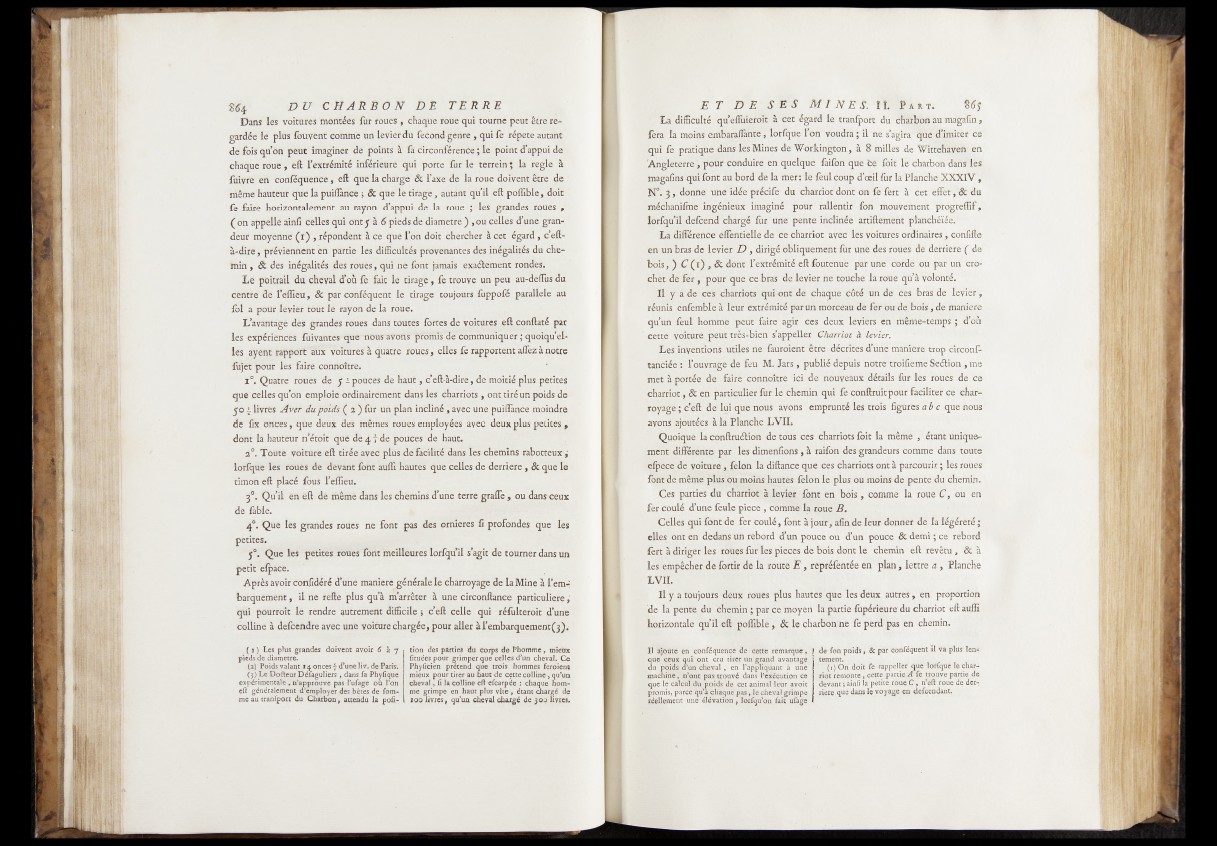
I j i D U C H A R È O N D E T E R R E
Dans les voitares montées fur fûUêS , Cniqîïe foüé qui tourne peut être regardée
le plus fouyent comme uii levier dü fécond genre , qui le répété autant
de fois qu’on peut imaginer de points à la cireonferénêe.; le point d’appui de
chaque rbuë, eft l’extrémité iftférieiirè qui porte fur le terrein* la réglé à
fûlytb èiî borifoqUeflcè , eft que la çhargë & f axe de là roue doivent être de
niêfne hâütéut que ia puilïàrtce ; & qué lë tirage, autant qu’il eft pomme, doit
fe faire horizontalement au rayon d’appui de la roue ; les grandes roues ,
( oh appelle ainfi Celles qui ont y à 6 pieds de diâmetré ) ,ùu celles d une gran-, '
deut moyenne ( i ) , répondent à ce que l’on doit chercher à cet égard, c eft-
à-diffi, pfévienftèttt én partie lés difficultés provenantes des inégalités du chemin
, & des inégalités .des roüès, qui nè font jamais exactement rondes.
Lë poitrail dü cheval d’on fé fait le tirage, fe trouve un peu au-deflus du
Cfentte dé féffièü, & pâr Cbnféquerif le tirage toujours fuppofé parallèle âu
loi à pÔUf lëvlër fout lë rayon de la roué. ••
L*âVâfîiâgê dés grandes roues dans toutes fortes de vqitÿres eft cqnftaté par
les ëXpérféàc'èi fffiyünïéè'qti'S uuüsayoïlü communiquer$qiKaqu’elles
ayènt rappori^jxvditûres à quatre mués”, elles fe rapportent affez à notre
ftjët pour iès faire connôître.
ï°. Quatre rôüês de ƒ - pouces de Haut, c eft-à-dire, de moitié plus petites
que'celles qu’on emploie otdinaîtëment dans les charriots , ont tiré un poids de-
y o i livrés -Avcr âu poids Ç 2 )’ fur un plan incline, âvëc une puiffitncé moindre
de fiX OfiCèS, que deux des mêmes roues employées'■avec deux plus petite®^
doht la hàütëtir ii’étdit qüè de 4 1 de pouces de haut. '
2°. Toütè voiture eft tirée avec plus de facilité dans les chemins rabotteux-^
lorfque les roüès de devant foht auffi hautes que celles de derrieic, & que le
timbh èft placé fous l’èffieu.
3e. Qu’il èn èft dè même dans les chemins d’unè terre greffe, ou dans ceux
dè fable.
4°. Que les grandes roüès ne font pas des ornières G profondes que les
petites,
j a. Que tes petites roues foiitmeilleures lorlquil s’agit de tourner dans un
pëilt ^ S e e .
Après avoir confidéré d’une manière générale le charroyage de la Mine à l'embarquement
, ïln e refte plus qu’à marrêter à une circonftance particulière,'
qiii pôûrroît lé rendre autrement difficile ; c eft celle qui réfulteroit d’une
colline à defoendre avèc ünfe voiture chargée, pour aller à l'embarquement^).
( 1 ) Les plus grandes doivent avoir 6 à 7
pieds de diamètre.
(2) ;3?©ids valait 1 q. onces liÿ. de Paris.
0 J^çïjpfteurDéfagu]iers , dans fa Phvficjue
éxpériipentaîe , «.^approuve pas Pufagè bu l’on
éft généralement -içl’eîTî^loyer des bêtes de îbm-
me au tranfporc du Charbon, attendu la pàfttion
des parties du corps de Phomme, tnidix
fituées pour grimper que celles d’un cheval. Co
Pftyficien prétend que trois hommes feroienti
mieux pour tirer au haut de cette colline, qu’un
cheval > iû la Colline èft efcarpéè : chaque nommé
grimpe en haut plus vite, étant chargé de
zoo livres j qu’un cheval chargé de 309 livres.
E T D E S E S M Î M E S . I f . P a *. f i 86;
' La difficulté qtfeffiderbit "4 ' cet égard lè tranïpoît du tnagafin ,
fera la moins ènibâraffihïê, KsîKraèxôfi voudra ; il bre s’agira qüé H’imiter cô
qui fe pratique dans lijs Minés dè Wo'rfcingtoir, à 8 milles de Wittéifâÿelï eit
Angleterre', pour ronaüïïd en' tpieléfciê fàifoÜ'cjüe bê' fait l ^ ’êhâibon darf» les
msgaixns qflïi&fit ait bord de la mer: ïéfetfl ébtfp d’toèil fur la^’là^We XXXIV ,
N*. 3 , donne une idée précife dü dh^rilb/dotït dn ‘fe fèrt à* cfe't dü
jnéchanifme ingéfüêûX imaginé' pour fâiléntîr fort1 ihdüt'éffiètîc ptogreflif,
lorfqu’il defeend chargé Gît ’ limé8 pente inclinéè ‘ 'àr'tîiftëhiffiii pl'àttènéïéë^‘'''
La dffiréhëe èflhütielle de Ce fiHânScît 'a^èd les Vbitûïds drdinàifes, confîflë
en un bras de levier D , dirigé Obliquement "ftft unè‘ des rduéS ad tieffiété ( dfe‘
Ippi, ) C ( t ) , & doht l’extrémité eft foûtêiîue^pàt ùrih cbrdfe Ou pat un crochet
de fer, poti'r'qïtè Cébras de levier tf^tèilCne' là robe qu’à vohohté.
Il y a de vcfeV ifhârriots qui‘ont de chaque bâté üh dè tes Dras'Se' Ifeviffi',
Tranls-®fêibDié"a leur extrémité par un rffûrééâù dèferntrdpbols^qe'ftlaipere
qrfun’feul' homme peut faite àgir ‘ ces dëiïx"l^ietS1' f e rtrêttiê-temps ; adü
cette voituie Ippjlpè>-bleirs’«ippSÜer’QhUfï
Les mvéknofisjutiles ne fauroient être décrites d’uné m^fi'èée'lircip clra’nP
tàhfclée : l’oûvcàge' de feu M. Jars , publié depuis notretroifiertîê S&ftiü'n mé
met à portée de fâirê tôünoitre ^ i? de nouveaux détails fut lès iMes- dé''ce
çharriot, St bji particulier fur lê chemin qui fê-ceüftrüitpotit'feâtfter cé fchar-
roy^gè.; c’eft de lffi qüb.noÜS avons emprunté les trois figurés ab':c 'qtié'ndus
UyonS'Spjoùtées à la Planche LVII.
Quoique la tonftruéHôn de tous ces charriots foie la ifi'èüSë1/ ' étant Uniquement
diftlrèritè par les! dimensions, à railon des grandeurs ebirimè dans tbüte
’elpeçe dè véitür.è,* félon la diftance que ces charriots ont à pareburit; les roue«
fobt dè même plus bu moins hautes félon le plu S ou.moins de pente du chemin ■
tïes parties du charrfôt^ àrievier font en bois, comme la “rcSe’c ,\ou’ en
Jfej coulé d’une feule piece , comlllfia roue B .
Celles qui font de fer coulé, font à jour , afin de leur donner de la légèreté j
elles ont en dedans un rêbord d’un pouce ou 'i?ün pbüce & detni " c é rébôïd
fort à diriger lès rohès fot le s pièces de bois (forït lê chemin’ èft irévêtu ; ■& à
les empêcher de forcir de la route E , repréfentée en plan,. lettre a , Planche
LVII.
Il y a toujours '-deux roués plus hautes que les deux autres, en' propfiàfba.
de la pente du chemin ; par Cé ïnoyèri la partie fopêrieure'du çharriot èft aüffi
horizontale qù’il eft poïfiblë, & fo chârîSlfeiB fe perd pas én ’tffiffiun.’j »
Il ïjbûtei’êfi cettt remarque,
uc ceux qui ont cru tirer un grand avantage
u pôjlssâlüaÆeyal, en .'l’âppnHpc^à^SS
machine, n’ont pas trouvé dans l’exécution ce
que le calcurdu'coids'de cet antni^\ntur ayoït
»IpmiSj'pariiequ^feliaque pas, le.®hefal'gtiî5>||ei
réellement une élévation, lorfqu’on fait ufage
| de fon poids, »1 Va plus’lèni
jiàtremçntc, oe^eipanagM^ lîgdve partie de
devant ^oM^MeSte^roue^; n i roue de aefe
rierç que dans le voyage eq defaendant.