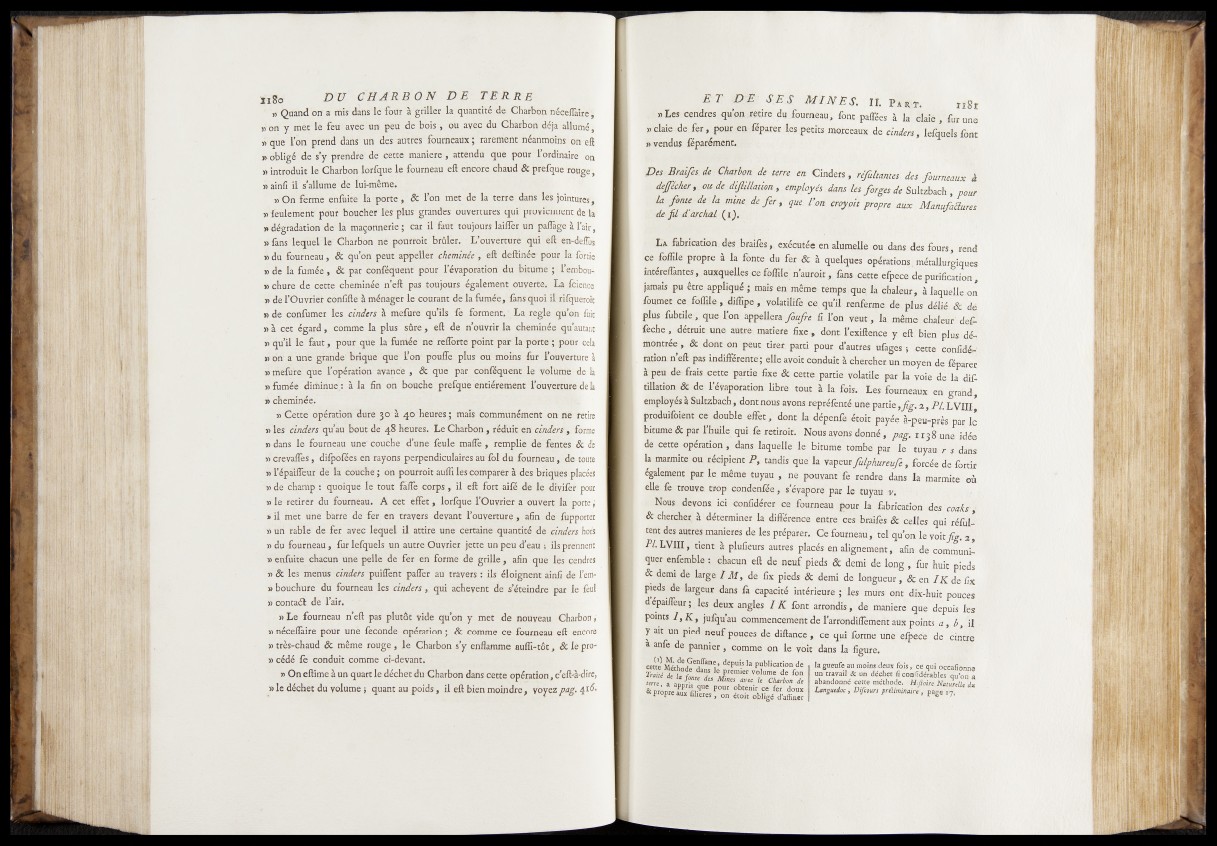
* i g o D U ' C H A R B O N D E T E R R
' » Quand on arriris dansfè 'fortr'^grillcr/la quantité dé -Ghafobh -néceflatre,
*rorr y iliétHè fiù'UVeb-urt peu ;‘(É\j^S£~'ou avec du Çhkrbon déjà‘allumé;
»que lofl prend dafts un dès':a&tréV fourneaux; rarement'néanmoins on eft
»obligé'de s’y prendre de cette mariieîê.,4 attendù que pour|Èpjrdinatre \oti
» introduit le Charbon lprfque le fourneau eft-encore, chaud & prefque'rùüge',
»ainfi il / allume de lui-même.
‘ '»"Oh ferme enfuiië'jia'pdrte, & l’on met de la terre dans le^ jointure,
»‘feulement'pour Boudièr’ lès‘‘plus'grandes ouvertures qUifprliViêtment de la
»"dégraSMoiï’de là mâçoiinerie; Car il faut toujours lâiffer un paflàge à l f e
» finis leqüëble' ChârBbft rie potirràitbfûler. L’ouverture qui ' ®®®i-de(Tus
» dù fourrieah, qu%l pèùt appéller : éftîdjrh'|e‘j eft dèftihéê' pour jllt fortie
» de la fumée', & par conféquerit' pour1 l’évaporation du bitume ; l^mbou-
» chùre déj ;ç S - chemiriée o’eft pas toujours .également ouverte., La|fcience
» de TOuVriëf ebhfifte à ménager le courant de"la fumée, fàrisqUoi il-roeueroit
»d&confomer les cinders à mefure qlfilk fe, &merit,^ La réglé qu’onjpit'
» à cçt égard, comme la plus sûre^ eft de nQUvrirJk çhemjjné^mautant
» qu’il le faut, pour que la fùrtiée ne;rëffôrte point par la porte ;;p o u rie |
Pdn' a une grande' brique qUe lfonJ pouffe plus- ommoins- for Pbuyerture à
» mêfure qûè l’opéraaon avanc’e , & que par conséquent le volurrié de là
» fumée dithimie/. a la fin on bouche prefqueentièrement l’buyerture delà
» chenfinée,
» Cette opération^ duie 3 0 'à 40 heures; mals'çc^c&niînément on ri§S^rètire
» lè s cinders^ fro -co tit’de 48 bÇûtes. Le Charbony rédbit en crWrvs, forme
» dans le fourneau une* Couche" d’une fetale maflfe , remplie lâe’ fentes & de
»■'crevaffes, difpofées en rayons perpendiculaires au fol du fourrieau*, de-toute
» i’épauïfèur dé la couché; on pourrqit aüffi les comparer algébriques .placées
» dé champ : quoique lé tout faflè corps , il eft fort aifé d e ’le. dî\.ifor pbiir
» le retirêr dü fourneau. Â cet e ffe tlo rfq ü e l’Ouvrier a ouvert larporte ;
jf K; îùtâi -mes barre .f e en travers devant Pouvemirç , afin dgf|§pportei
»üfi rable d é fe f avec lequel if attire:une Cériamêî,quaot^^
» du fourneau, fur lefquels un autre Ouvrier .„jette un peu d’eau:,;f |H :rënnent
» énfuite chacun une pelle de fer en forme de grille, afin que les^cendreî
» & les mentis ciÆets puiffent paffèr au travers i ils éloignent ainfi rde l'enl-
» bouchure du fourneau les cinders,; qui achèvent ae s’éteindre par le pfèul
» ÈontaP de l'air. •
» Le fourneau neft pas plutôt vide qu’on y met de nouveau Charbon ,
» nécçflàire pour une féconde opération ; & comme ce fourneau eft encor®
» très-chaud & même rouge, le Charbon s’y enflamme auffi-tôt, & lelro-
» çédéfè conduit comme ci-devant. ■
» Oneftîme à un quart le déchét du Charbon dans cette opération, c’eft-à-dir®»
» le déchet du volume ; quant au poids , il efobien moindre, voyez pag. 41&
D T : D E S jE :S M i.JV E 'S , ÏL P a r -i-, u g r
» claie ,d e tf|p pour R é p a r e r fes:pj:cit^ ra9iceaux&(w3| le f q ^ f d n t
» vendus feputémCRt* -
Des R r a ifa de Charbon de terre en Cinders ^KfulhmesX des,p a r tie » J ‘2 *
dejp{çfor,f o uM d^ lk iM n ,, è ^ y é s . dpns Mi M g e s ^ ^ k ^ h , p b È
la fente de'fa mini, dp fe r t qupvd%orî, erpypit à p p r^ è x ; t M ânuficlarji
: d e f ,ld ’MçhAk ( f ) i .
La fabrication. des^raifes:,. exécutée en alumelle ou dans : des-fours,, rend
ce foffile propre à la fonte duïjgr & à quelquèr^atio^m^aili/rgiques
intéreffantes, auxquelles .ce foffile niauroit^/farjs. c,Qtfe^e%ëce,deÿtîrïficaM'o,n,
jamais pu être ^»pliqué ;.ttpài$ eri.n^ême- temps-que la chaleur, ^Jaqyèllë^on
fbumet ce. fqffilfe, dilfipe, î volÿtilifé >çe^ qju’jjf renferme, de, plus délié» & 'dé
plus fùbtijeque - Pon- appellerafi. l’on véuti- hCm&he |halèuf;idefr'
feche, détruit- unft autre- matière fixe, dont» l’exiftence ^eft'bierT 'pluWde-'
montrée-, & dont on peut tirer parti pour d’autres ufages } cette co'nfiffé^ ration n’eff pas indifférente; elleayoipconduk.àchércher»un^mpÿén„de fépa'rer
à:peu de-frais.cette partie fixe & çette partie volaille par k-voië'tde'll^lifJ''
tillation & de l’évaporation libre ‘tout à fa. fok Les''fourneaux eni^ra'hà,
employés à Sultzbach , dont nous avons repréfénté une partie. £ÏY. LVIII
produifo-ient-ce double effet, dont la dépenfeiétoit payée';%eu^fès,pâr;le
bitume & par l’hiiile qui fe retiroit. Nous avon's donné, pag. i^funè^dée
de.cette opération, dans laquelle^Éiàm^tombés dans
la marmite ou. récipient P, tan^^la vap.eur 'CdÈphireuk jMM M j
également par b. même tuyau ^.pe pouvant’fe rendre dans la ipàrjwte'où
I elle fe trouve: aop'.:cpndeqfge, s.eyapbré par le tuyau >» É
- ÎÜqus; devons ici eonfidérer ce fourneau pour la fabrication des conkstk
• & che* ^ ' ^déterminer la différence entre ces braifes & icelles' q u rréfti^
f tent des autres maniérés de les préparer. Cë fdumëàâi
j PL LVI11 > tien# plufieurs autres placés en alignement ,Wfin; de* communii^
[ <îuer'.ecfemble : , chacun eft de neuf pieds & .demi de long,, fui hutf piids
& demi de large IM , de fix pieds & demi df'lbn^uêiif , '&‘en iK'de fix
pieds de »largeur dans fa capacité intérieure ; les mûrs: oja* dïx^huit poùçei^
d épaiffeut î /les deux angles / K font arrondis,, de iqanierè’ 4 u iS ü i s 1^
points J,K, t jufqu’aù commencement de l’arrondiliement aux points , | l •
y ri^vun pied neuf pouces de diftance , ce qui forme uneteipecé cjntee
a, anfe de pannier, comme on le voit dans la -figure.
ce« 2 6 JGe5 ffane » dePuis Ja- publication de
m m m diIîS le ™ volume de fon
& nrnnm.^r^ci^U^ Pour 0^Cen*r ce fer doux propre au* filièresott étoïc àbligé d’affiner
la gaeufe.au
un- travail * uü dHchettfi cotted<érab]'^fa'uioâ a
abandonné cette ’d«
Languedoc , Oifours préliminaire , page 17,