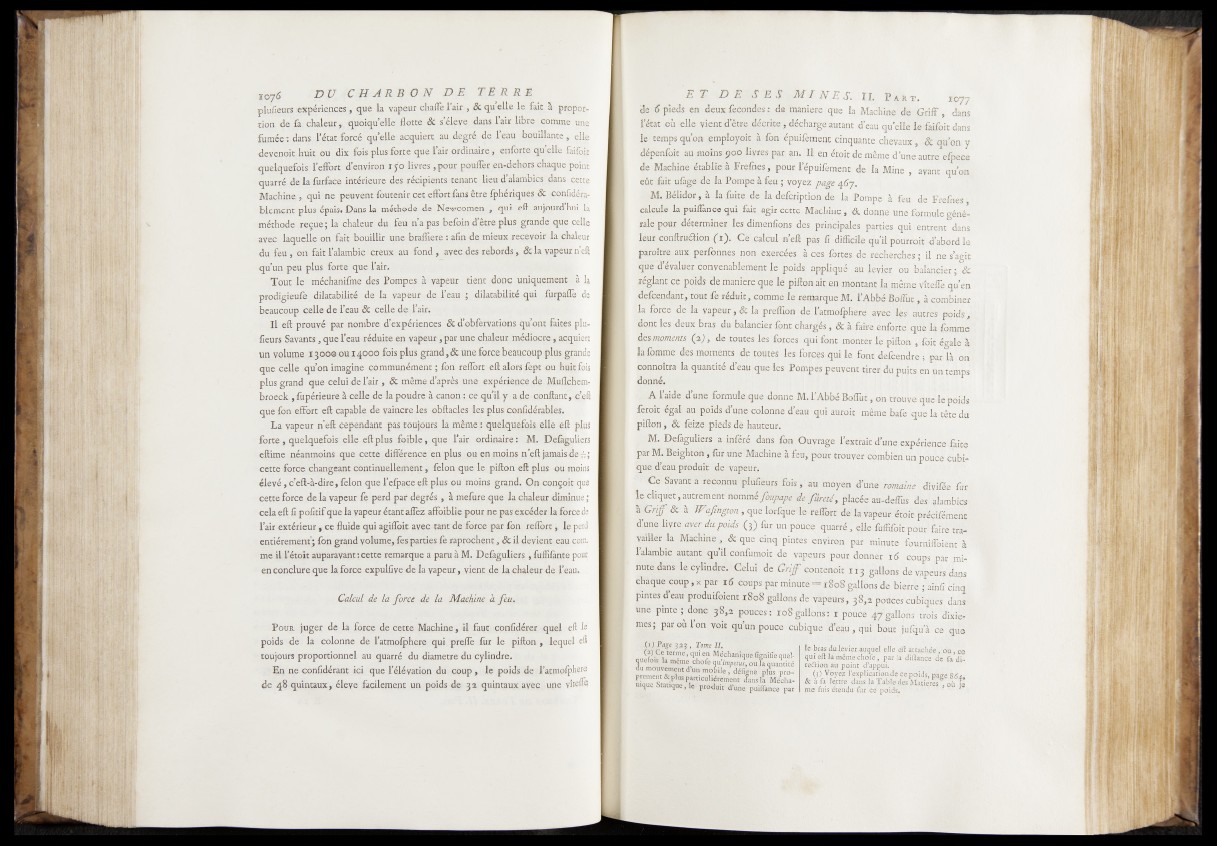
rond D U C H A R B O N D E T E R R E
plufieurs expériences, que la vapeur ehaflel'âll'/j & quqlfoie fait à proportion
de fa chaleur, quoiqu’elle flotte & s’élève dans l’air libre comme une
fumée: dans l’état forcé quelle acquiert au degré de l’eau bouillante., ellp
nn dix enfonce quelle feifo^
quelquefois’ l’effort d’environ iyV;foree>s ,pour poqflçren-dehors chaque point
■quarré ..dje'ia fo^ç^i.tttériétme dfts J'éfcâpieht?-teqafit lieu d’alambics dans, cette
Machine, .cmifoe. peuvent foutenir cet .effort ffos être ,fph4 ri que? dCjgphfidéra-
Memeflt glus épais. Dans la méthode .,^e Newçortien , qui e f t ^ y g ^ ’hui la
méthQde-.regug..;. la chaleur du feu n’a.pas befoin d’être plus grande qui celle
« .^quelle on fait jbaUiÜir unefotgflforp} afin de mieux recevoir la » le u r
du feu , on fait l’alambic creux au fond, avec des rebords , &la
qu’un'peu .plus fprte que flair.
ifouttie méchanifine des Pompes à vapeur tiefo^dàpjj uniquement % la
^rpdig^ufè^latabiU^irjie la vapeur-dp. l’eau Jjajahil^d-»qui .forpafle^ds
beaucoup celle de-icau ékcelfodçi.l’air.
Il eft prouvé par nombre d’expériçqces & d’o ljfe ^ g o ^ .q u q n j ^i|ps, plu,
fleurs Savants, que l’eau réduite en vapeur, paftUjEjej^ÿcleur méfoopre * acquiert
un v o lum e X.Joo» t>u 1400a foj§j>lus grand, & une force beatipqup.plusg|apde
que celle.qu’on imagine communément jfoqVrpjfort'.pf^fors |hpt ân|hûitjfois
plus grand que cej^i^deluir, & ^ ^ ÿ ’après q r i^ sexpérienge)d e,^i|^he in-
broeck-jfupérieure à celle de la poudre à canon : ce qu’il y-4
que fon «effort eft capable de vaincre les §bft|cLe^es îgfoifgogjJdlrgbfos.
La vapeur n’eft cependant pas toujours la même : quelquefois elle efl; plus
forte , quelquefois elle-gftplys foible, que .fojr ordinaire: Mh-Mêfoguliers
eftime néanmoins que jgq^J^^^^r^qq^his^aftU
cefte force changeant continuellement, félon que'l’g^ifton eft plus o&noins
élèyé, c’eft4 vdi*e , félon que l’efpaee ç ft plus ou Q&x&ntfck. fus
cette force de la vapeur fe perd par :dpgipgtj;<l meforp-q^q î
cela eft fi pofitif que la vapeur étant aflêz affoibliç pouç np pas excéder la force de
l’air extérieur ( ce fluide qui ggiffoit avec tant fon( reflôrt,, le perd
entièrement ; fon grand volume, fesparties fe raprochent, & fl;dtvlfnSse&cpmi
me il l’étoit auparavant : cette remarque a paru à M. Defiguliers, fuffifànte pour
en conclure que la force expulfive de la vapeur, vient de la chaleur de l’eau.
y. .; Galctil 4/Ç la- 'fwMrAç la ■Mçtëhinfi àffm. '
Pour juger de la force decette Machine, U faut: confidérex quel eft le
poids de la colonne de l’atmoïphere qui prejîè for le piftôn , pequel eft
toujours proportionnel au qüarré du diamètre du cylindre.
En ne confidérant ici que l’élévation du coup , le poids de i’atmofpliere
de 48 quintaux, éfoye facilement un poids de 3a quintaux ayep une vhe^
E T D E S E S M I N E S , IL P a r t . io 77
de S pieds en deux fécondés : de maniéré que la Machiné de Griff, dans
l’état ,c.ù elle vient d’être décrite, décharge autant d’eau qu’elle le faifoit dans
le temps qu’on etnployok à fon épuifêment cinquante chevaux, & qu’on y
dépenfoit au moins 5)00 livres par an. Il en étoit de même d’une autreVpece
de Machine établie à Frefnes, pour l’épuifement de la Mine , avant qu’on
eût fait ufige de la Pompe à feu ; voyez page 4.67.
„ M. Bélidor, à la fuite de la defeription de la Pompe à feu de * Frefnes , >
Çpyi^ia.puifl'ancequi, f?it fgîr^étte,, Machine), «St donne une formule géné^
raie pour déterminer les dimenfions des principales parties qui1 entrent dans
Iç p ^ q ^ ftru ^ io n ji5 |^ ^ p a lc u l n’eft pas ^difficile qu’fl pouraoit dab'ord le
piroitre. am pfrlonn,cs non xxcrqées à' ces. fort^flörquhcrdie : ; U , ne s)ïgic
que d’évaluer convenablement le poids, appliqué au levier ou balancier ; &
l a ^ i ê t e ^ ^ l q u ’en î
defcéhdant, t03|ffo réduit,çômmëfVremairque M. fAbbé'BoffiitMfe&nUp&r
e *a Vîft>£ur > & ia-|>Jreffioh'de fotmôfohèrtf
dont les deux bras du balancier font chargés, & à faire enforte que la fomme I
dp|ÿqfips,les fonces qp|fon|>,monphr l'e pifton ,.foit qgklielà
la fomme des moments de toutes les forces qui le font defeendre ; par là on
connoîtra la quantité d’eau que les Pompes peuvent tirer du puits en un t e r i ||!
donné. .
■ : A l’aide d’une formule que donne M. l’Abbé Boffut, on trouve que le poids
fdfoiÈit^akaii; goîds.d’un^çqlonne d’eau qqi.afjroit même bafe que la tête du
pifton, &4feiÿa|p,icds de hauteur.
I M* M a s a f e i a ^ a t e v ^ B Ouvrage l’extrait d’une expériemeeffaite
ffnë’Machine à feu,-pour trouvers<!Bm|i|i'hhppuce cubi^
que cf eau produit ,‘deiyapeur.
Ce Savant a reconnu plulîeurs fois, au moyen d’une romaine divifée fur
le. cliquet, autrement nommé foupape de fârèté, placée au-deifus des alambics
\ Griff 8c à Wafington, que lorfque'le reiTort de la vapeur étoit précifément
d’une livre aver dupoids (3) fur un pouce quarré, elle fuffifoit pour faire travailler
la Machine | & que cinq pintes environ par minute fourniflbient à
1 alambic autant qu’il confumoit de vapeurs pour donner 16 coups par minuté
dans le cylindre. Celui de Griff Contenait 113 gallons de vapeurs dans
chaque coup, x par 16 coups par minute = 1808 gallons de bierre ; aiftfî cinq
pintes d’eau produifoient 1808 gallons de vapeurs, 38,2 pouces cubiques dans
fine pinte ; donc 38,2 pouces: 10Sgallons: 1 pouce 4 7 gallons trois dixief'
mes; par où l’on voit qu’un pouce étÜ'Êiquè d’eau, qui bóut jufqu’à ce qua '
(O P«gc 3?? . Tome II.
(2) Ce terme, qui en Médiatique CgriiGe quel-
nuetois la même 1 quantité
du mouvement d’un mobile, déGgne plus pro-
prement& plus pamcnliérement dans la Mécha-
| nique Statique. le- -produit d’une puiffance par
le bras du levier auquel elle éfl: attachée .qu,,ce
qui eft la même ebofe, par la diftance de fa di-
reifHon an point d’appui. % .
(5) Voyez l’explication de çe pû/dsfoage 8d«.,-
& à fa lettre dans la Table des Matières , où Te
me fuis étendu fut 'ce poids;'• J