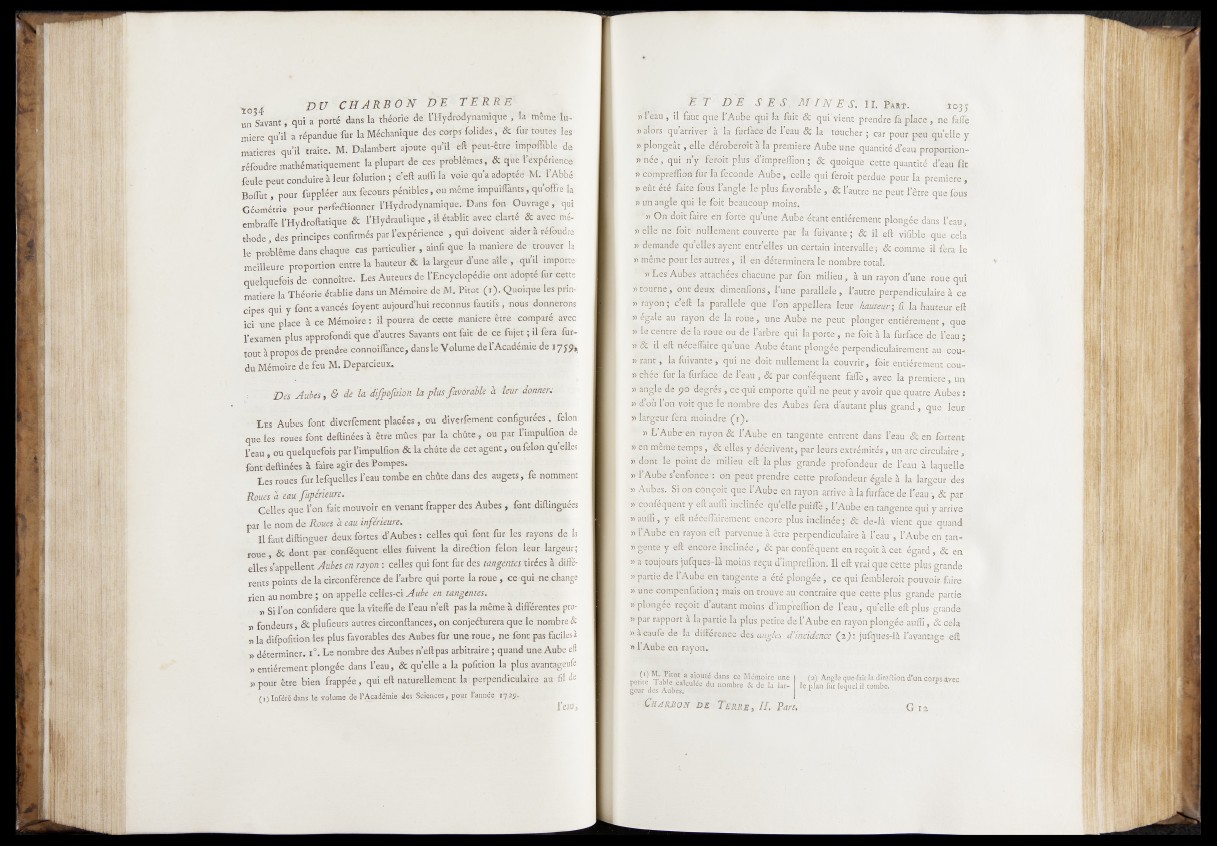
t>.U - CÈ AR S O ÏÏ &%' T ErRÉSW
«n Savant | qui'a £rift£ dans la-tbéürie de*, l’-Hf<îfô'c(ynàmiqïïè
miere^qu’il a répandue fur la Méchaftiquè ld b m p s ^ L id ^ /& - ^ ^ t ê s 'le s
matières"qu’iljfijflfl»*. Dâlambert-ajkte* qu'il ' el' peut-êtrè*î$p8ble -de
réfout^ mathématiquement la plupart de ces’ p lu m e s , & qîfè fepérienfck'
i M H W i B i M a folüt&fi fe'eftlauffisîà' voié-qu'a afe]ft«6‘ftK ^AbU'
Boffht, pour fuppléer aux feconrs pénibles',^ même impùiffateqrquWre la
embraffe i’Hydroftaîique & l’Hydraulique , il'établit- avec Clarté & atàlMné-
M des principes co'nftrmés par l’expérience ^tffffoiyenf Jriderit-rSfcudre
W È tàiïm dans N | cas particulier, ainfi-que'la manière de'trouver la
■ 1 propoïti-on entre la hauteur & la lttfgeür dune aile, tq gM g brte
1 W m ê ê ê ë Les H f f l i B I p ad°p®é m m &
kfïèîfedà Thétirie établie dans un Mémoire de M, Ktot (r). Quoique les pfin-
cipàiqpi!y fcWt avancés foÿent aujourd’hui recôfintepfeutifs, tioasidonpbons
iGi pirie place à 'ëe Mémoire' : il pourra de cett-e maniéré être comparé J e c
l’eixëftiétf fltts appi»fondi que d'autres Sayants-ontfait? d e ^ f e j ^ l l f è r a p t -
«out à propos.de pren d s feonnoxffîncéi dansb^olsunedel’Âcadérniëdè J7j%
du Mémoire de l u M. Depfçieux. _
' Dès AüUs^ê -âè l^dlffôpmlà féwféifÔrkkE &Mr-JônnëK.
- fe s ^ u b e s font diveTfemertt placées , ou diverfement configurées^ ^ o n
quales roues font deftinëes à être mâes'par lanchâtè^ ou p a teU r^ lfi^ de
l’eau ,<ra quelquefois par l’imptdfion &la chute de cet agent ,'oufelan. qu’fies
fent'deftinées à faire agïr'des Pompes.
L e s lS S 'fer I c e l l e s l ’eau tomïe;enchite dans des aagets, -p ti^ n e n t
Memes la-veuefuféncure. ...—
Celles que l’on fait mouvoir en Venant frapper des Aubes,-* f ë n ^ |p u é e s
, parole oom de Roues ù eau- inférieure* ' ~
T fi f t t^ K g t ê r f e a K fortes ItfAubes : celles qui font ftnla» ra,y®»sl# la
roues & dont, par 'eafiféquent eUes fuivent hr’diM&ion fofonvlëur.^rgeur;
elles s’appellent Anhesertreè^ni-Ncelles qui font fur des râa^snfaiti^estâi^iiFé-
rents points de lareiièonférence de l'arbre qui porte la roue * ce-qui -ne^iange
rien au nombre ; ‘bn'-appeüe celles-ci Aube en-tangentes. |
• ty Sifon’confidere'que la-vîteffe deTeau m’eft pas la même:à.différentes pro-
» fondeurs, & plufipursiautres circonftances, on conjecturera que le npfhbre Se
d la difpofitïon les plus faVorableis des -Aubes fur une-roiie* neffont pas faciles à
:n-déterminer; i°. Le nombredeSAubes n’éffpas arbitraire ; quand u n e ^ b e eflI
« entièrement plongée dans l’eau, & quelle a la pofition la plusutyantageufe
» pour être bien frappée, qui eft naturellement la-perpendiculaire au fil de
J' Üij:
E T D È S E S . A I I N E S . 11. Part. 103 y
» 1,eau > il faut que l’Aube qui la fuit & qui vient prendre fa place , ne falll
»'alors■ qu’arriver à la furface de l’eau & la toucher ; car pour peu quelle y
« plongeât, elle déroberoit à la première Aube une quantité d’eau proportion-
» née, qui n’y feroic plus d’impreffion ; & quoique cette quantité d’eau fît
» compreffion fur la fécondé Aube, celle qui ferait perdue pour la première ,
« eût été faite fous l’angle le plus favorable , & l’autre ne peut l’être que fous
» un angle qui le foit beaucoup moins. &
» On doic faire en forte qu’une Aube étant entièrement plongée dans l’eau ^
» elle ne foit nullement couverte par la fuivante ; & il eft vifible- que cela
» demande quelles ayent entr elles un certain intervalle; & comme il fera le •
» ineme pour les autres, il en déterminera le nombre total.
» Les Aubes attachées chacune par fon milieu, à un rayon d’une roue qui
»tourne, ont deux dimenfions, l’une parallèle, l’autre perpendiculaire à ce
irràyon ; c’eft la parallèle que l’on appellera leur hauteur; fi la hauteur eft
roufe^î u|i e - p eSI'plot^^^^^SÆm ent ,‘ficm©
» le centre de la roue ou de l’arbre qui la portes ne foit à la furface de i’eau ;
» & il eft nécefl tire q l’une Aube étant plongée perpendiculairement au cou’
» rant , la fuivante , qui ne doic-nullement la couvrir, foit entièrement cou-
» chée fur la furface de l’eau , & par conféquent faflè, avec la première, un
» angle de 90 degrés , ce qui emporte qu’il ne peut y avoir que quatre Aubes :
» d’où l'on voit que le nombre des Aubes fera d’autant plus grand, que leur
» largeur fera moindre ( r ) .
” L Aube*en rayon & 1 Aube en tangente entrent dans l’eau Sc en fortent
» en me me temps, & elles y décrivent, par leurs extrémités, un arc circulaire %
» dont le point de'milieu eft la plus grande profondeur de l’eau à laquelle
» l’Aubë's’cnfonce : on peut prendre cette profondeur égale à la largeur des
&> Aubes. Si on conçoit que l’Aube en rayon arrive à la furface de l’eau & par
» conféquent y eftauffi inclinée quelle pui/Te, l ’Aube en tangente qui y arrive
» auffi, y èjnéecfîkircmcnt encore plus inclinée; & de-ià vient que quand
» l’Aube en rayon eft parvenue à être perpendiculaire à l’eaü ., l’Aube en tan-
inclinée, & par conféquent en reçoit à cet égard, Sc en
» a toujours jufques-là moins reçu d’impreflîon. Il eft vrai que cette plus grande
» Par'tie de l’Aube en tangente a été plongée, ce qui fembieroic pouvoir faire
» une compenfation ; mais on trouve au contraire que cette plus grande partie
» plongée reçoit d’autant moins d’imprelfion de l’eau, qu’elle eft plus grande
» par rapport a la partie la plus petite de l’Aube en rayon plongée auffi, & cela
».à caufe de la différence des angles d’incidence (2 ): jufques-là l’avantage eft
» l’Aube en rayon. v>t
S r irT r tM 1È° C f a,'?utf ci?ns ce Mémoire une 1 'if%i Angle que-fait la direaion.d’un corps avec
Ja lar- [ le plan fur lequel ü tombe. 1 _ S
Ch a r bo n d e 'Te r r e , IL Tan. G ia