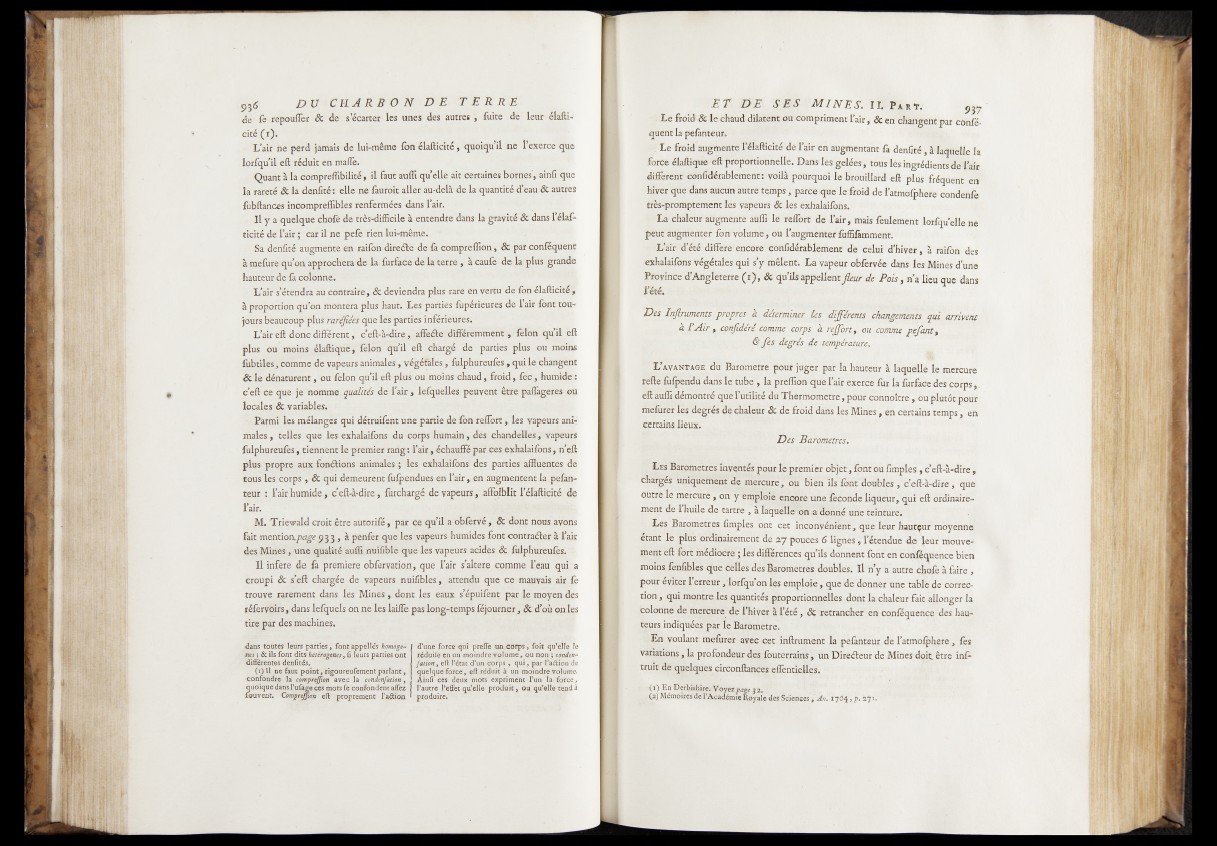
n g D U C H A R B O N D E T E R R E
de fe* repouffer & de s’écarter Ibs unes des autres ,• fuite dé’ leur élafti-
«afé’^ï^. '
• L’air- be perd jamais de lui-même fin élaftidté, quoiqu’il ne l’exerce que
lorfqu’il eft rêduitprl'çiàne^'’ ‘
Quant à là oQriiprëffibilité , il faut auffi qu’ellef àit'certaines bornes', ainfi que
la rareté & la denfité': elle ne fauroit aller au-defi-de la" quantité dJfeau & autres
fubftances incompreffibles renfermées dans l’air.
11 y a quelque chofè de très-difficile à entendre dans la gravité & dans l’élafi
ticité de la it ; caril ne pefè rie»lui-même.' •
■'* Sa denfité augmente,en raifon direéle de fi eompreffion,, & par conféquent
.â^tnefure'quon approchera de la furface de la te rre , à’caüfè'’ deda^pLüs, grande
hauteur-déVÊ eôlonftei
L’ai^ét%!ndrà’'âu contraire, & deviendra plus rare en vertu de fon'élafticiféjÇ
»proportion qïdon montera plus haut; Les-parties fupérieures de 1 air font toujours
beaucoup plus raréfiées que les parties infénélffca^ff
L’air eft donc différent, ceft-à-dire, affeâe dîfférêmméh^j'' filon ‘qu’ilp%fl
plus ou moins élafüque fTeloh- qu’il e f f ^ n ^ é 'f'de’*J'p^'Ffi^>!plus'l ou ^hioins
Subtiles, comme de vapeurs animales, végéflles, fulphureufes, qj|Me changent
& le dénaturent, ou filon qu’il eft plus ou* moins chaud, îfroid fa®?,“ humide :
c’eft»ce que je nomme qualités de l’a ir, lefquelles 'peuventlétreipaffageres-1 oU
locales & variables.
Banni les mélangés qui détruifënt une partie de fin-report",'les vapeurs anir
males, telles que les exhalaifins du corps -humain, dés çhandëües,--vapeurs
ftilphureufis, tiennent le premier rang: l’air,,échauffé par 'Ces-exhalaifons, n’eft
plus propice aux fonélions animales ; les exffdâifin^'d^pa|t^es!^lùenjtes de
tous les corps, & qui demeurent filpendues en l’air ,• en.augmentent la,.pèlgrl-
teur : l’air humide-j-c eft-à-dire, firchargé de vapeurs, affiîbyt l'éi'àfticiçérde
l’air. -f
M. T rieW ff erojtjstre autorifé, par ce qu’il arô3§>fitvé /. & dorit nous âtfpris
fait •mentipm^Mg'e ,933, à penfir que les vapeurs humides font contraéler à l’air
des Mines, une qualité auflj nuifible-que-les vapeurs acides & fttlphùreufis.
Il inféré de fi première obfiryation, que l’air s’altere çqrnm'ô' l’eau qui a
Croupi & seft chargée de vapeurs nuifibles,. attendu que ce mauvais aijçffe
.trouve satpment dans les Mines, dont les „eaux s’épuifept par.le-moyen des
réferyôirs, dans lelquëls oruie les laiffè pas longtemps {éjourûér> Sc d’où opjgs
' tire par des machines.
dans tontes lénra parties, font appelles homàgêe t d’ope forcé- qiii preffe ;pii,corps, foit qifëllé le
JK! ; & ils font dits hétérpgttixs t fi leurs parties ont 1 réduife en un moindre volume, ou non $ cpnden-
flififérentes derifités. - , ' .;*■ ‘ ftUÏotr, eft l’état tfumfo/ps , qui, par l’aétion de
. (i) U ne faut point, rigoureufement parlant, 1 quclqueforce, eCitédeit àtfn moindre volume,
confondre la eompreffion avec la corit^içfajp-, J Ainfi ces deux mots expriment l’un la -force ,
quoique dans l’ufage ces mots fe confondent alTez l’autre l’elfét qu’elle produit, Ou qu’elle tepid à
•fouvent. Comfrj0 an eip ptoprement l’adion * produire.’-”! ” ;
- E T D E S E S M I N E S . II. P a r t . m
• Le froid & lé» chaud dilatent OiS Compriment l’air, & en changent par cOnfé-
qtientla péfitïleWï 4 -
■. Le froid augmenté Mlafticité de l ’air en augmentant-fi denfité'*, à laquelle la
IbfCfc élaftfque eft pfôjfirtioMellê. Dans les-gelées-, tous lés ingrédient® l’air
diffèrent ëânmférablemenn : ïvdilà*pcrôrqùoidel brouillard' eft plus1’ fréquent* In
hiver^fé'dkns aucun-du tre temps j pansé que le froid de fatmofphere condèttfè
frès-promptement les vapeurs & lès è&halàififts. îï
La dhafeür atigmentë atfffi'lërtfe'iïbfÈ’de l’airs mais fiùlement loffqu’elle ne
p d l t f i n voldme ,'ëù l’-augmenter fiffifimment.
K "L’ait-d’été'diffilr^dncore^confidérablêment de celui d’hiver, ‘à-’-ràifin des
exhalaifins végétalësqùi ÿyJmêlent. La vapeur.obièrvée dans les è la e s d’îia^
Province d’Èhgièïetre ( t ) , & qu’ilSâppelient fie n t de jPoir* n’a lieu que dans
l’été» H ■ - -
Des changements qii) arrivent
$jjM-4ir * fBfifiiéfltÇ.Çimme comLà Jj&QfifUpu‘■tomme pefamy
X' L,AVAjNfÂ&E> du Baromètre pour juger par la hauteur à laquelle le mercure
réfjétufflndù^ T s l# tu b e , la preffià^quel’airpxerce'ïur là furface deS corps,,
eft àuflmemjDMre que futilité dû 'Thermomètre, pôur connoître, ou plutôt pour
mefurer les' 'degrés de chaleur & de froid dans’fis IVlines, en certains temps , en
^eftâirfsjlieux.. - -,
D es Baromètres.
^ ES ^fhônietrë’s' inventés pour le premier objet, font où jlinples, c’eft-à^dire,
fcntugés' Bruquel^^^de mercure ^ o ^ bien ils fonT'àoubles^^^eft-à-dire, quô
4 ^tr? ° ° y ethp*ioie encore uhe ïèconde liqueur,' quieft ordinairement
dé 1 f i l e de tartre , a IaqueFf^on a donné une teinture, '
cet ïpconva^oe^ qjié?leur hauteur mbyënrièr :
étant le plus ^ordinairement de ay ponces 6 lignél^ l’étendue de jeur moùve-'
^ n t ëft fort médiocre ; les différences qu’ils donnent font'encoi^quence bien
moins fenfibles que èëuès des Baromètres doubles. Il n’y à autre chofc à faire,
pour éviter 1 erreur i jorlqu on lçs emploie , qüe :dè donne/une table de correc-
tion, qui montre les quantité? .proportionnelles dont la chaleur fait allonger la
colonne dé mercure^ dë l’hiyer à Tété, 3ç retrancher en- confêquencé- des hauteurs
indiquées par le Baromètre.
||n voulant! mefirer avec cet inftrutnént la pefanteur de l’atmofphfte., fis
variations , 1» profondeur des fouterrains, un Directeur de Mines dqit être instruit
de quelques circonftanceselfèntielles.
(i) En Derbishire. V o y e z j 2. 7
C2) Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, An. 1 7 0 . 2 7 1 . ""