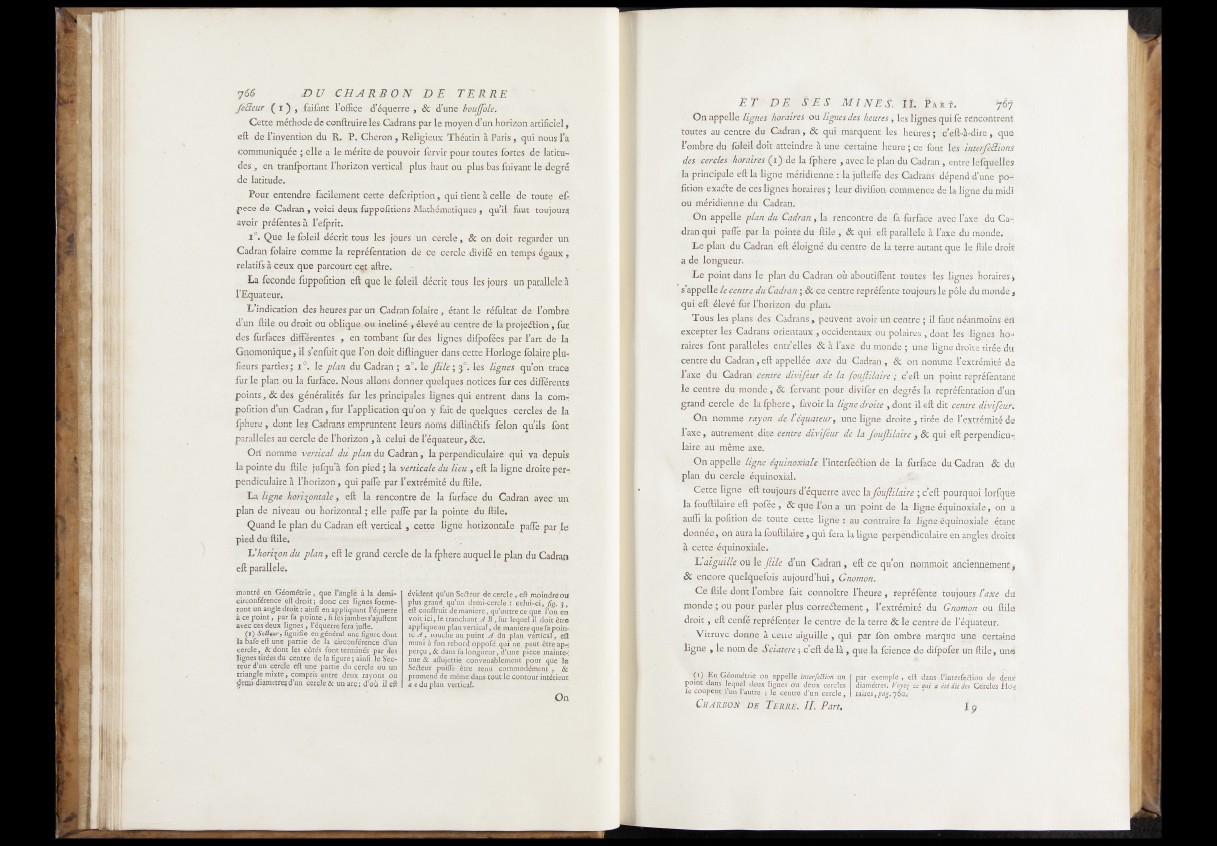
7 66 D U C H A R S O m D E T E R R E -
Jêclcicrfiï ) ,-xfaHànt- l’office d;équerre , & Hune Poujfole.
Cette méthdderie conft'ruirë les Cadrans- par le trioyen'd’unhorizorrartificleïj,
■eft de,l’in\?eneioh du R, î . Chéron , Religieux Théatiruà .l’aris, ■ qui1 tïoifs-’l'h
communiquée ;.ellë^ -le-mériterie pouvoir.,fervir pour iôüt'es fortes dé latituù
des ? en-tranïportant l’horizon vertical plus haut ©ir.plus bas foivant le degré
de latitude, '
Pour entendre fedlement Bette defcriptionj rient à celle de touîe; ef-
pecede Cadran, yelc!-deuxfoppofoions-MàthénJadques , qu’il-faut toujours
.ayoir préfentes à l’elprit. '
» :i°* Que le foleil décrit tous les jours 'un cerclé, & on doit regarder un
Cadran folaire comme la repréfentation -de -ce -cercle divtfé en temps égaux j;
relatifs -èeeux que parcourt qsfaftre»
t a féconde foppofitioft eft que le foleil décrit tous-des jours;sun-parallele I
l ’Equateur. .,
L indication ;des heures par un Cadran folaire, étant rie réfoltat ;.de.' i’pmbré
d un ftÜe. OU droit -ou
des forfàcçs j^ ^ ren të s , en tombant for des lignes"di{ppfées pard^fi.trvde la
Gnomonique,ils’enfoit'que l’on doit diftinguer dans cette Horloge/folaire plusieurs
parties; i°. le plan du Cadran ; ®°. le f i ih ; 3?,.’-les~é£gneSj.îqû’on trace
fur ie plan qu lafori&ce. Nous allons dqnnaç quelques .n^pes for éps.différents
points, & des généralités fur ; les principales lignes.qui.-entcenc- dans la.com-
ppiitiond^ïjCadcan.r |ù r l’application‘q uQ n ^ j|îjt:de
JÉjAere ,/fdont, lejy Cadrans.empruntent leuts nomsi^i^dj^gs felqp qu’jlss font;
paralleles.au cercle de l’h o rizo n à celui de l’équateur, &c. 0
Orî aom&e verdc^ du^ppin du Cadfom;* la perpendiculaire qui va depuis
la pointe du foie jufqu’à fon pied^ la verticale du Heu >,'$§; la lignejdroite fèï:^
pendiculai^eià ,^ o t|zo n ^ guipaflè par rextréuiité dufole.:
t a ligmghdri^cfntale, eft la rencontre de, la; forface jdu,. Cadràn».avep( un
plan de niveau ou horizontal; elïè^pafïè par la point^dL^ileS®?U
Quand le plan du Cadran eft vertical, cette Iig$e horizontale paftè.par lé
pied du‘f o l e , H f c H j lMN iMp f
Idhorizon du plan, eftle grand cercle de la fphere auquel le plan du Cadran
eft parallèle.
-montré en^Géométrie, que Fanglê à la demi-
■ circonî&éniæl eft_dtoit; doncces .lignes, formeront.
un angle,droit : ainfi en applîqiianti’équerre
à,ce point, par j ï pointe, B tes jambes s’ajüftent
avec cès deux Higqés J’ l’équerre fefo jurfe. ,.
(a) 5efif«r,fignifie en générât une fîgure"dont
la baie eff ifin^pâMe; d^W pvcônféKnçé '«Éan
cercle, & dont les côtés font terminés par des
flu'éfcntfé ielkJfeiife
" jbçf 'd’tftr éercïê' bfame partie 'jdq'çêiçîe ‘$\i, up
triangle mixte j cdmgijs_ egtre „deux. rayons ,'ou
^eai-jjiametrefo’un cerçie & ùüarc; a’dù il eft
pliif griàd:.,qùpin
eft conftruit de-maniere, qu’outre ce que l’on en
volt.ici, le tranchant ^ B , fur lequel il .doit être
applique au p'ianyertical, de maniéré quefa pois,-
,ts4 ;..Àqqqlie,au point^ 'd i i .pi^ yfeijça l, e®
muni a l’on rebord oppofé qui ne peut être ap-j
perçu, 8c dans fa.longneur, 1 "n pièce mainte-;
nue & affujettie convenablement pour que le
Seâeur .puUTë ' être tenu commodément ; &
.p.rpmenéfte m^ççdàns tOuélft$®JÏ®IïîrttéfieuE
«edupiàn yéaiçàl...
On
È Y t D E & ‘E S M I N E ' S . IL ËÀk ï .
On appelle lignes ■tâpÊées iaulîjgralihiieàhettx.es, les lignes quife réncoûtrénS
toutes a#centre du' Cadran ,i&-qlj^niàrquent les - heures'; /C-eft-à-dire, quë
l’omltre du foleil doit atteindre à u'pQ ,çëf taimé h>urç;ce font iès,dm$ftclionè
desÿceteles‘fhoraires (ïE^Ie la fphere ^âv’é^foïplanîdü. Cadran, entre lefqüelles
^¥p'rmci^aléJéftlædigrié-Wriffiénrid^dgljfitgfferdes Cadrans dépend d’une pb-».
.fition- eka<Ste>'de;êès -lignésrhoiaires ; leUl' diviii^h? cdrfiinenoe de la ligne dü pjidi
ou méridieHqë du jCadrani <t
r oOn appellepyZtn^Ms'Cp^/a^^Ia^reqcohtré/dei’fôforfàce Jaxé.'idu Ga^,
diranqjii '.paffe.* parfk ‘poirile^u^folej; & s.fuh'llhparallèle à l’axe-du mondqj
Le.-plan du.CaSdran eft/éfoigné du centra- de.!la,ttaijé’|Utapit.qne le ftile droif
a de;,longueur.. n-
Le pointfoaris'le plan du Cadran où-aJ?ouriffient joutes les lignés horaîrés,
sappell^Æ centre du Cndràh ; A,ce centre tepjjéfente Épujqurs4eipôle,du mondes
qiHc eft jêlçVéHusl-Kdrîzé'iï- du plarïî
TojflsJLesiplaosiîdésÿCadranspeüvènt ; il faut héanmciins ëdi
e-xcépter,fosiÊ-adrans ‘.orientaux , oceidentâüx^lpoiairebf, J o l i e s jl}gnéS,;h(3;-‘
foires font parallèles éntrielles & à; l’axé du ‘nîbnde ^ungt.M'gji'e droite tiféè dk
^^tredü^àdtârïiiefifappéllee axe du Cadran, 8c on nârfitried’extjérrjité de
îl’axp'du Gadran centre .divifejer-,'de^îu .Jgu0Mré;fJ çjeJJ un^puint repréfentant
.fo.qentrei dü- mOnde^,1. & .fe^vant .po.üÿ^diyifof enfo^gtésflafrepiifentation d’ün
grand- cercle de^£^foh|^%Jj&voifi!laÆ^72a droite;^ d . ' o l î
. On .nqmme-fÆ^o/zr de l’é ^ ^ a r , Jcune,liggâ;^qke, tirée de* fexttémitéde
J ^ x e ,- auti;enieh.tïditeijeeiître_ f'^ifl'-hÿjlilacrelp & qui êft perpendicu-;
Jdnü^au-Smême axe,
î .Qft appelé' ligne, équinoxiale 'Hnterfeéiion de la forface du Cadran & du
oelâfe du.cerçlg^üuinpxiaL t
^ ’Cet!ern g t^ ,'lft touj&urgd’équerre ^ ^ p fh ^ ^ a à ir e po'ur^üp^rorfoüé
>â^i|^iBil%éje|t-p'Qfé.e, àt’^rle l’dn a-ijUn^peBi'fcrde.. lat -Kgrié,.équipoxiale-„
^§PjSjîiig P°^|i<^ ï4 é ‘ toute 'MgîKau?pdntraîréstla ligme"éq^lntgiale .étant
dennee,, on,avfeglgfoufol^re-^uirfera La ligne petp^jdiçulaire en angles droits
L aiguille; o ^ e fille d’un Cadran , eft cfe, qü*ôl|^nS)mmoit. ancienngpienÉia
«St tenggre quëfôuefois auj'oprd'>h,üiT,|Q^putop:. ,
. ; Gë ftile donHIqmbrej-fait; Gônnoîtrht l’heure ,|regrlfontp toujours l’oeùeiddii
monde-; ou PS^»Rarler;pluSjCqireélemenfc, ^1,’extrémité .du$G4OT<3« ou ftitd
1 eft cenfoïepréfenter lëphtre dBla terré &
jlfej^itruyè donnedJycj|çte aiguille;,, qui par ÿ©nV®lnbrs„ rharque mie - certaind
Jàgne >4?^ nom dLSciatere ; c’eft de lâlequ^W feienoe de difpojÇer un^ftile-, uné
IpJ) En Géométrie oh appelle interfeSlion un I par exemple ÿ eft dans ,rintërjfeftion de deüi?
point dans Jeq>uèl^de!ùx lignes o'u deux cercles ce àui a été die des Cerclés HoV
■?@ coupent l’un l’aiitre ; le c'entre d’un c e r é le ( raires,
^^C H jR B c ïïr fie Ter re. Æ Parti % l ÿ