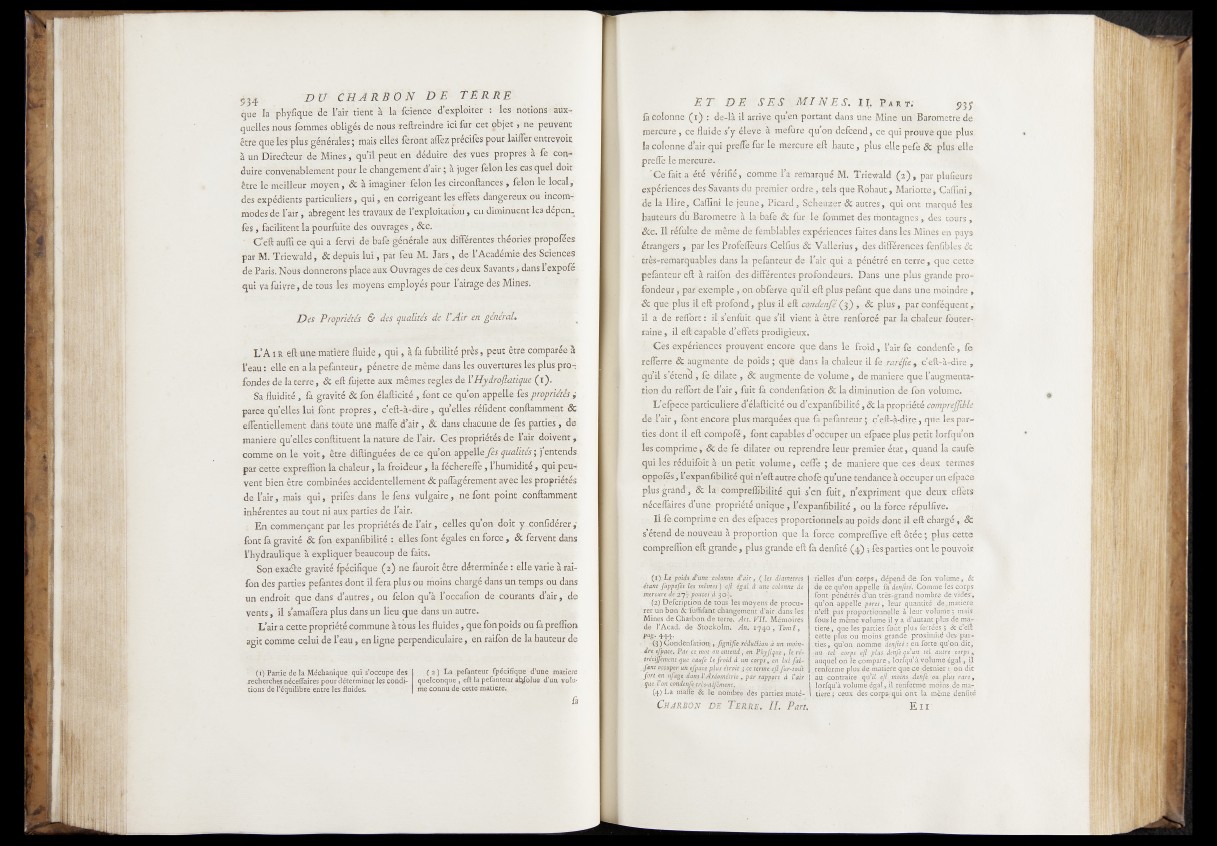
5 53 "B C H A R R CÎ4 ï D E T E R R E
que la '-’phÿfique î- des,-nôtiois4%uxquelles
nous fônjmes obliges de nous ïeftreindredci furreed ^b]fet 'ji!ne peuvent
être qué^s^plùs générales;'mâis’fèlltes feront aflez-précifespour laifler*entrevit
à un©ireaeMde%ine'sS qu’il’^eut en dédüire’^ësî-V'to.és/propresià fe.'cori*
duire cohvènâblemfent pour le’changenrént d’air-; à: 'ju'geij feloridësi 'eas'.quel doit
êcrele'fneilleur moyen-, & à imaginer félon les circonftances^ felon le local,
des expédienfs particuliers, qui, en corrigëanPhSteflhts dangereuxtp.uèincommodes
Hè-4’air, abrègent les travaux de*l’ex’plïîitlïÜi1ori',s en diminuent les<dépen.
fes ,"fâcilîtent la 'pdürlùité^dës ouvrages, &c. -
auffi-cè-qui a fer'vi‘ de-bafe^riêrale -aux -différentes hdi#flriesipropofées
par M.-fMëwald, & depuis l^ p â t''f ë u%M: Jâirsc,,' de^4.cadéWe-àesiSé^#s-
dryParis:'N6las"dônnëïont^lace aux Ouvragesfldcesi.ddux Savants è*dans lfexpôfé
qui vafuivre*, â ^ t^ s 'le s m'oyensifemployes'pour^f^a'ge^eS.iViiCes^.,
Dés jPfopnétés & ^^qùaBte^W'T^ït 'çrFv^rcuê
L’AiR eftufte-^nSfîSfeflûide, q u i%àj|ajfubtili$4 P ^ sîj®fut ê treqomparéëià
l’eau: elle en a-lapefanteur,- pénetre-de,njême^djp^Iê§.ip,uyeç-tiW^1lçs' plùs.pÿcjp
fondes de là terre., & efi/uj,ette aux, rnêpaes regies, i-£
Sa. fluidité, fà gravité & jx>n élaflicité ,/a p t c e ^ u sn-jappeJi^fès.^lo^lfAji
parce qu!elles lpi font propres, (s’efl-à^dire, qu elle^re^dejrvt^onflarnment Sc
eflentiellemeftt dans toute une maiTe ,fl5’a k , 8c dans c.h^ûn£,fle- fo^mmes», As
maniéré qu’elles conflituent la nature de,raff.:j ÇIes;p.fo^ri^^ &flèrÿlaff doivent','
comme on le voit, être diftinguées de,ce qu on^appcll^y^yy^^^irg^ ; j entends
par cette pxpreffion k chaleur, la froideur la feSjejeffe, l’humidfle, .qj&lBgùJ--
vent bien être combi'nées^gccidqntellemeçt ëc p|flâgéî^entOTèçJéstprqpçi«és
de l’a it, mais qui, prifesdans J e jTens. Vûdgaire1,at]^ onti3TQmt.,,cbnftamment
inhérentes autour ni-.aux-parties
En, commençant par les propriét^^e^^r^, ..celles qu on* doit ^ç.qnfidéxer j
font fa.grayicé & fon expanfibilité :tgllqs,font égales en^^ijé,,' & feryebt Jafls
l’hydraulique â expliquer beaucoup défaits.
Son exaéte gfayité fpécifique (a), ne fauroit être déterminée : elle varie à-rài-
fbn des.parties pefàntesdont il fera-plus ou moins.chargé dans un temps^pu fljuas
un endrpit ,ique dans d’apprqs , pu; fehpji qu’à^l’occaflon de courants d»air } jis
vents, il s’amaflèra plus dans un lieu que dans,un„autre. ,
L’air a çettepropriété commune.à tc^s-les'fluidçs , que fori poids ou fa preflîion
agit comme cflui.de Ueaq, pp ligne perpendiculaire,, ejn-.raifon dp la hauteur de
ï (i) Partie de laMéiÆadqueqÜ^ . : 2 ) La ;pefante.ur lÿéeifiqup'dhifijt, pào'ere
rechercfi&oécefîàtres pour déterminer les Condi- I quelconque )( eft la pefantéur aijfolue ttuà wilu-:
H8W l61^ ^ ^ ^ 'i t o â é f è 8SoiidSî 'h. v v ;1 ■ j nie edanu-décrite matière^ pj
■ f a
E T D M ^ S W m ^ m % j - IL P art ; 53 y,
fà Colonne il aoe ^ q slen ^ q rtan t flans upe'Mml^Majpmetfeidp,
.•pfffcurte, c a flmdç^^élejçra h isp re qüïpSïdefcend,,’cq qui prouvu^fle plus;
i 1 Æ plfl^'elle
gféfle le meMuà°S^
ÎÊê.fait^été térifîé, comme l’a rcm^rquetM. Tridvfald ,£2),, pat, plulieurs^
expériences des Savants du premier ordre, tels que Rohaut, Mafiotte, Cafllni %
:®re^^afliftiJJeifêiine,'; PMilfel'Sgheùà.er marqué les
lïajüçëurs. di^Bâtqpjecrei à ^ tours,
ëcc. U réfpoej®^Rmé,qg^ïnblah|es,iexgéi^^^fs fuites dans les^üflinê&gn pay%
étrangers , par TWEntB"^ ^ Vallerius, des différences fenfibles &
t-rès-i emarquablCj flâii^da; pofàtiteur de l’air-quJ^qAgéjïgtvq^ en, terief, qucjtvtte:
^fenteur'fefUÿrài^flfcde^flîff^encés^profmideuts. D.ans ^ime^Mus gqjan.flq.'pro-;
fondeur .maÆ^mpltes ÿ jaobieÆVe;qutil eftnluap'^f e BkateulanS)une moindre ,
& qu e jftii^ I^ll profond ^i^LuAil ’dkSÇÿifoifo
s!fl viont, àrjflïrc'frèntcg:c^^dafoïïàISûç<fbu ter->
j^ n ^ ’jiÿl efl^apabl^fl,;efle^pjodigiê,ûx, E ;
^jjjÇès lexpé^nGesjpiouyffE^^^e^qiu è ;® si>ld'^frdy^,|iiï^fç c,onflenfe-, fh
reflerre ^àbgmqrAei. .d^bflkis ; qiÆ dans^ te ,;
qtf’fl- s’étmAl .& augmente^ivolumeL^d^jjiânicrej qn^Ka^@hepÿa-.
{ion du'-trêlTort--Mal:^.i %,-jfuir fà.lcéridenfàtâ&ni & la flînj^mrigmileifoh ;v©Jufnei' --
Ij cfp’dce particuh.ereflélaftiuté pu.d’t\pan(ibilité, & la p; opyeté aohipidfjibk
jfleVl’ a i r r, yf^n t^fln c 0ri^p lus ffttaÉqu é e s qn&fà-tpefànteur ^o^fl-à^diief, qilejfles.par-
•^icS'.dontt i;lrefll.qoiflpcip’, ^fohtïgâ^blesflpccuperiUn efp^.qpl.gapeyt lotfM'on
K^eqtlîpri^a'A'.fl'ef^ »dilater oii^reprendre leur <prem|et état , jquanji la caûfq.
iAjg r^Mf«Mfe^RM10aBbàftüBplgrae, pefl^^fle 'maniéré 'qq^qes^dfux pQgpt&à
iqpfeo'C®s 1 l>fixpa^fî|ilité''qui-iî’eft autre, chgsfèqu’une tendance à.iSppuperiun e/gaop
Côm^efl^^té teùi, n»eXprimenfrique deux; dJeg^f
^écêflÀrrës^ape,.propricté ii?fl^#|l?eÿpàaCbilité, ou là forcehépulfi^e. 3
If fe|oe!U;pr^giÇ'Ç|l fe ft|&aGes proportimmâs>a^tpôidsîd<ân&;il èft-shargé’," Sc
^ g é n d rd^nQUVeaUi.à pj^ps^ion que
fcomgreflioii.èfl grandie, plu^-grande efcfe flenlité (4) ;rfès^aEtiesàaM|^potçvoi|
(1) £e poù/î tl’tmErcoîotmi d’âir, ( les diamètres
. étant fuppofés les mêmes ) ,ejl égal, à une'holomè~cté.\
■'■meraire d^ ' 2 7 - ^ 0 ' -t
J. 1(2)’ Qe&ripffi^3gtous lês moyens de. procu-1
’ rer un bon & Tuffifant changement d’airidàris les,.
Mines de Charbon de terre. Art. Vil. Mémoires!
Me iEAcaây'Jde Stoeltolrn. .An,. 1740 , Toml, I
pag. 444.. 9 H H |
(' ^ të^ à af^W ^ \ :^ 0 .‘ sî(d^Biôn à un moin-
■ ^re. cfpacc. Par ce mot on entend, en Pltyfique ,, le, ré-
■ trécijfemenc que caufe le froid à un.corps, en luifaiiA
, -fitnt occuper-un efpice.plus, étroit ; ce terme ejl ftir-toùl
fort en ,uj.age dans .UAréométrie par rapport à l'air 11
: que-lion condenfe.très-aifêment. , j
(4) La marte & i e nombre efés parties maté- ’ I
P ^ C h a r b o n - d e T e r r e . I L P a rt.
rielles d’un cofps, dépend de fon volume, &
.de d^ffldon appelle fa detj^té. Comme les corps
jfdnt pénétrés d’un tîestgrand nombre devyides ,
qu’on ap[ elle pores, I ;ur quantité de, matiera
n’eft pas1 proportionnèlle à leur voluniè'; mais
fous le même volume, il y a d’autant plus de mar .
tiere, que les . parties font pli s fe rées ; & c’elt
cette plus au moir grand proximité des parties,
qu’on nomme denfitè : en-forte qu'on dit,
un . tel . corps,' eft,:p,lus 'denfe qu’un;.tel autre corps ,
auquel d i le compare, lorfqu’à volume égal, il
.renferme plus de matière que ce dernier : on dit
au contraire ,qjiil e l -moins ienfe-’ou.plus rare,
lorfqu’à volume égal, il renferme moins de matière
; ceux des corps qui ont la prêtqé.jfèpJ^
I !e i i