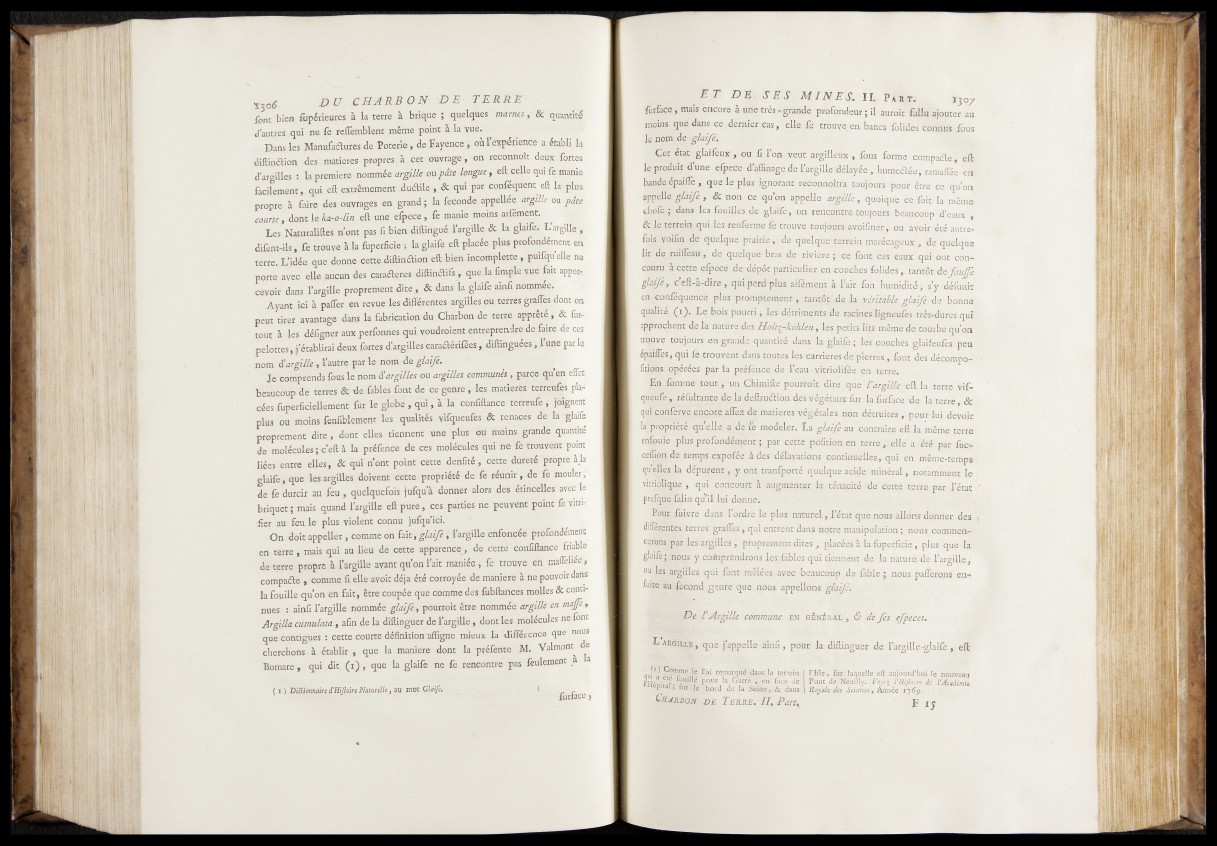
ïÆH l D C H A R B O N D T E R R E
font'bien ftpérieures. à la terre .a. brique1 ; ,queLqués;.>àrnes, & quantité
d’autres ..qui ne fe reflemblent même point :à la-vue,../.
. Dans lès Manuffiaures de Poterie, de Eayence J oùï’è^érience à!&àbli la
diftinaion, des matières propres, à ,cet ouvrage , on.recqnnoît dette «fortes
d’argilMj la première nommée argille ou .pâte longue, eft celle q u if| manie
facilement, qui.éft extrêmement-/duâile , & qui par conféqu^nt eft la'plus
propre 'à faire des ouvrages en grand* la.fécondé appelléo argille ou pâte
courte, dont le ka-o-lin eft une. efpece , fe manie moins, aifément.
Les Naturaliftes n’ont pas fi bien diftingué l’aTgille & la glaife. fcL argHI^
difent-ils-, fe trouve à la fupetficie s laglaife eft placée p ro fo n d ém e n t en
rçrre.X’idée que donne) cette;diftinaion;effibien incomplette, pjgfrellfene
porte avec elle aucun des caraéleres diftindifs^, que'la fimple vue .fait appert
eevoir dans fargille proprement dite., & dans la glaifè ainfi nommée.
^yant ici à pâffer en revue les différentes argillespu terres graffes dont on
peut tirer ayatjtage dans la; fabrication du Charbon de terre apprêté, g fur-
tout à-les défigner aux .perfonnes qui voudraient entreprendre de faireÈle'ces
pelottes, Rétablirai deux fortes d’argilles caradtérifées^ difttajguées,,.’l’une par le
nom $ argille, l’autre par le nom .glaife. ‘
j e comprends fous le nom d‘afgilles ou argilles communes , parce qu #,effec ,
beaucoup de terres & de fables font de ce genre, les. maueres-terreüfes plac
é e s -fuperficieUement fur le globe', qui ,1 ^^cOnfifcjnoe5tdrreufeVjSfen i:
plus ou moins fenfiblement les qualités vUqueufes & teteçf^'de lplaifa
'proprement dite, dont elles tiennent une plus Suf inoins -grartgÆantité
de molécules * c’eft à la préfence db ces molécules'qui në Tê^rduverit point
Mies entre elles, & qui hont point cette denfiîét cé&^dûïbté:^:opre |Ê
glaife, que lesargillés doivent cette-, propriété de fe.réüriir, de ® fouler;
de fe .durcir au feu , quelquefois jufqu’à donner- alors- des. eti^cTélles pvec le
briquet ; mais quand l’argille- eft pure, çes parties ne^êùVent'point l ' v | i :
fier au feu le plus violent connu jufqu’ici.’ *
On -doit appeller * comme on fait ^glaife', ftargille ebfônçéei.ïa|Êhdéfflent
en terre , mais qui au lieu de cette apparence , de- é'éttf 'cônfiftânce frij$e :
de terre propre-à i’argille avant quon l’air maniée ; & ttàüÿef erf maffeliée,
compacte * comme Eelle;avoit déjà été ÇoÊrôyéè-dqmanîerë-l^^ûyoir dafls
la fouille quon 'en.fait* êtfe-.coUpée.que comme des fubftancesfolles
nues : ainfi l’argille nommée .-pourrait être«nommée àrgiÛfe/i't0èr
Argilla cumulata, afin de la diftinguer de l’argille ■, dont leS. mtolécules ne font
que contiguës : cette.coutte définition affigne mieux la différence
cherchons..à. établir , - que^m an iere dont la ptéfente M. Valmont ,- e
Bomare , qui dit, (n) -, que la glaife ne fè rencontre' pas feulement . ~
( i ) Viftionnaire iHiJloire Naturelle, at» mot GUifit
lùrface ,
E T D E i S E S M I M E ‘S. 1 1 . Pa r t . ï 3o7
furfaee, maisfoncore à uîfe très -.grande profondeur ; ib aurait fallu ajouter au
moins que dans ce,dernier(cas, fyêlle* fei;ti;&Ye,en- bancs folidès corinL^bus
Jçinomfd\d$glqfèv-. •
Cet-était glaifeux , ou fi l’on, veut argilleùx , fous forme compaéte, eft
le produit d une efpece d’affinage de l’argille délayée| hume.àëe, ramaffée en
bande.épaiffe , que le plus ignorant reconnokra toujours pour être ce qu’on
appelle g l a i f e , & non ce qu’on appelle a r g i l l e , quoique ce foie la même
chofè ; dans les fouilles de glaife, on rencontre.toujours beaucoup deaux-,
& le terrein qui lés renferme fe trouve roûjour avoifiner, ou avoir été autre- i
fois, yoifin de quelque prairie, de quelque terrein marécageux, de quelque
lit de ruiflèau , de quelque bras de riviere ; ce font'ces eaux' qui onpç'ènë
couru à cette efpece de dépôt parriculier.cn couches, bolides, tantôt àz f a u f i l ,
g l a i f e , c’eft-à-dire, qui perd plus1 aifément à M l fon humidité , s’y défunic
en conféquence plus promptement É tantôt de la v é r i ta b l e g la i f e . de bonne,
qualité ( i ) . Le bois pourri, les détriments de racines.ligneufos très-dures qui
approchent de la nature des H o l c r f i k o h l e n , les pedts lits même de tourbe qu’on
trouve toujours en grande quantité dans la glaife ; les couches glaifeufes peu
épaiffies, qui fe trouvent dans toutes les. carrières de pierres ,. font des décompo-1
fitions « opérées par 'la préfonce de l’eau vitriolifée en terre.
; En fomme tout , un Chimifte pourroit dire que l ’a r g i l l e eft la terre vifo
queufe , réfultante delà deftruétion des végétaux fur la furfaee de la terre, &
qui coriforve encore affez de matières végétales non détruites, pour lui devoir
la propriété qufollc a de fe modeler. La g l a i f e au contraire eft la même terre
enfouie plus profondément ; par cette pqfirion en terre, elle a été par fuc- -
ceffion de temps expofée à des délayations continuelles, qui en même-temps -
quelles.la dépurent, y ont tranfporté quelque acide minéral, notamment le
vitriolique , qui concourt à augmenter la ténacité de cette terre par l’état ’
prefque falin qu il lui donné;"
Boin fuivre dans l ordre le plus naturel, l’état que nous allons donner des >■
^ fférentès terres gralfes, qui entrent d ms notre m mipulation ; * nous commencerons,
par les argilles , proprement dites , placées à la fuperficie, plus que. laglaife;
nous y comprendrons les fables qui tiennent de la nature de l’argiile
ourles argilles qui. font mêlées avec beaucoup de fab len o u s, pafferons en?
luilàgu.-sfeqond genre que nous appelions g l a i f e .
D e l ' A r g i l l e c o m m u n e en général , & d e f i s e fp e c c s .
L akgille , .que j’appelle ainfi, pour la. diftinguer de l’argiSgBife , eft
fouillé pdtir l a Garre fi m face
opiical * fur Je bord r«àe la 'Steine , 8c d
Ch a r b o n d e T e r r e . T I . P a
l’Ide, fur.laquelle eft .aujourd’hui le nouveau
Pont de Neuilly. 'Toyéç l’Hiftalre de VAcadémie
Royale des Sciences - Année i j 69.
I m