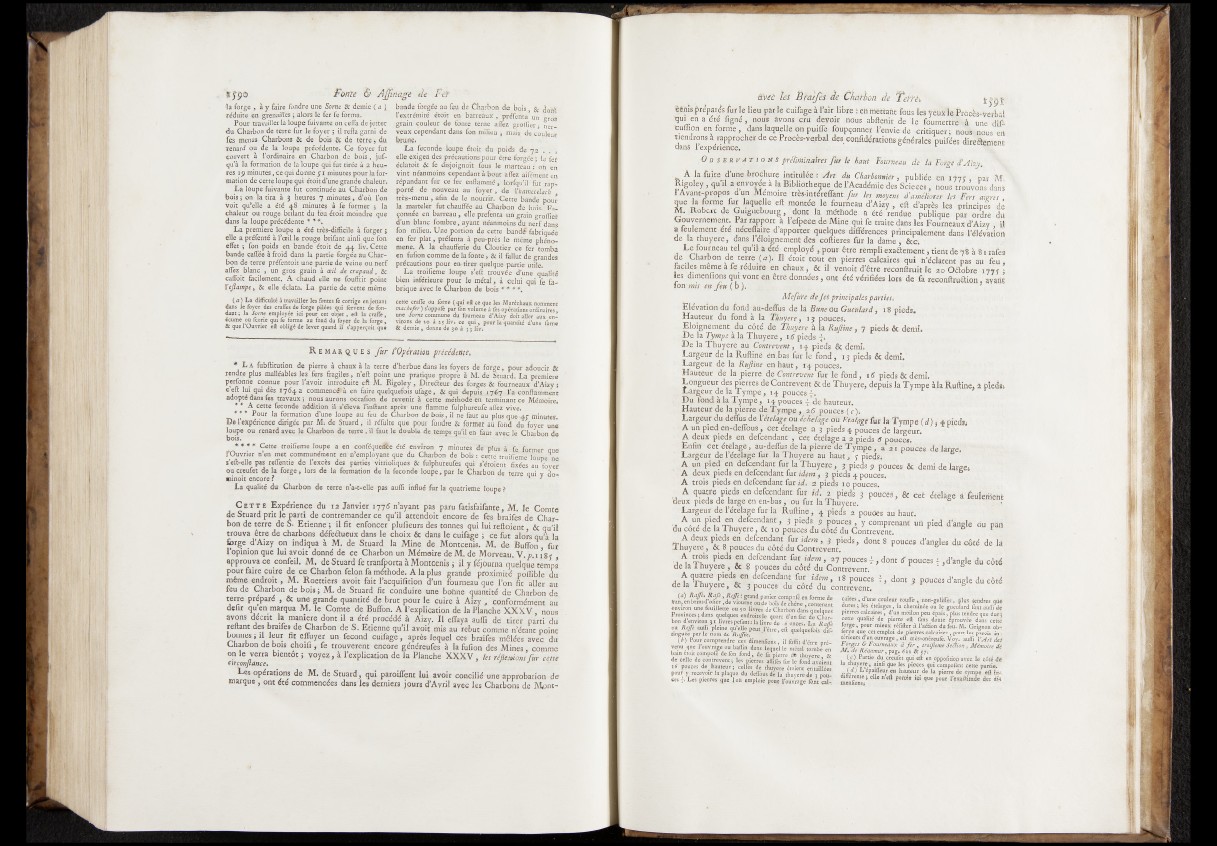
4a forge , à y faire fondre une S’orne 8c xiëfeie < & l
fédùite en grenailles} alors le fer ’
Pour travailler là loupe fuiyante rîn, ce Ja^de|et£er
du Ckarbon de terre fur le foyer \ îfré^a.-garm de
fes. fflenus- Charbons & de pois :& de tdrreY du
ïenard ou de là .lohge ^précédente* Ce foyer fut
•couvert à l'ordinaire en Charb,on£id.e, bois , jijf-
<quà la formation de la loupe qjLji fyjt tirée à 2. heu«»
res 19 minutes, ce qui donpe j ' ï minutes pour fôfof^
mation de çette loupe qui étoicd’unetgrande chaleur«
La loupe fuiyante fut continuée au Charbon de
bois ; on la tira à 3 heures 7 minutes » ^’qù l’pn
Voit q.u’èjle a été 48 nûnutes à fe former 5 la
chaleur ou rouge brifant du feu étoit moindre que
dans la loupé précédente * *.
La première loupe a été trés^difficile à forger j
elle a préfenté à faille rougç; hrifaut:ainfi que fon»
effet 5 fon- poids1 eù bande étoit de 44. liv. Çette
bande çaffée à frpid dans la: partie forgée au Charbon
de terre préfentpit une. partie de veiné QUiperf
affez blanc , un gros grain à oeil de crapaud, &
caffoit, facilement. A'chaud, elle ne fouffrit point
ïejfampe éclata. La partie de cette même
(a) La difficulté à travailler les fbntes le corrige en jettant
dans le foyer des craftes de forge pilées qui fervent de fondant
i la Soms employé® ici pour eet objet, eft la craflè,
écume ou fcorie qui fe forme au fond du foyer de la forge,
& que l’Ouvrier eft obligé de lever quand il s'aperçoit que
bande forgée au feü de CWioh^de hols, & dg»î
l’extrémité étoit en barreaux .préfenta’ un ïg jj
igrainfie'oij^P''de:. fonte
veux cependant dans fon milieu » mais de couleur
bfuné»
La fécondé loupe étoit du poids de 72 . .
elle exigea des précautions.pour être forgée; le fef
éclatent & fe disjoignoit fous' le marteau./. oh en ■
vint -néawooios, ceperrdantifcbout affez .ifêmèïtt e»
répandant fur ce fer enflqmmfeteifeuffiS'jfit xâpî
porté: de nouveau au foyer , tfe'<# aM tilach ,
trèi-iûenu ) afin de le nourrir. Gette Bffi'dê'- pouf
la marteler fut chauffée au GhSrboh dç qaBsîjîFa,-
çonnée en. barreau'l’’:® prefï®ta^'giaîh’;:gfQ®ëi
d%n blanc fombrei ayant néanmoins dd herftlatis
fon ■ milieu. Une pqrtion de cette band® fabriquée
en fer plat,, préfenta à péù-près le ritéflie pjjüno-
mene. A la : chaufferie du Cloutier ce fer tomba
Oh fuliqn comme de la fonte, Sfciï filljitf de grande'«
précautions pour eo-tireiv'quèlqtte-partie* utile. B
La troiGeme loûpe s^ft trouvée d’une dualité
bien inférieure pour le métal , à celui qui ^ f a brique,
avec le Charbon, de bbls*** •
cette crafTe ou iôrrr ( qui efl ce que les Marççî'.^ujï nomment
macfie/èrjtfôÿpéiç par lùn volumeàies opérations ordinaires,
une Soms commune du'fùutbaaq 'd'Aizy é^t aller aux en*
virons de 1Q à z J;liv. ce qui , pour la quantité d’utie Çacpa
St demie * doftne de go àr'33. Iivï
R e m a s I jjir l ’Q p é jtà f iô ^ ,p r i j0 ^ e ,i } ;
* L A fubftitution de pierre à chaux î la terre d’herbue dans les fôyérs 'tÉ* fofgd 5’ pmi âàoncîtA
rendte plus malléables la. fers fragiles, n’eft pofor une pratique propre a M..dst «mardi’Là Wéraierd
P“ ! 5 »? c?ünue. P-S“.? î’sXÇir. introduite eft M. Bigoley, Directeur-, des forges & foumeaux*d’Ahjy 5'
SK,** 17 <s4 a commencéte eu foire quelquefois ufage, ,& qui' depuii-jt7%'.d’a»«oiiffamment
adopté dam fes travaux i nous aurons occafioii de' revenir’ à çette méthode en terminant ce lgqfll©rea
* A cette féconde addition, il s’éleva l’inftant àprès* une flâmmeiulpiuf eufe affezFvivel ■
*** P°Vt la fonnation d’une loupe au ifen de Charbon de bois, jl ne faut gu plus ijlinüfeS.
De l’expérience dirigée par M, de Stuard, il. réfûlte g ® u n s
foup* pu renard avec Je Charbpn de terte, il feut le double de.temps qarl en faut avec le Charbon de
bois.
, Cette troiffeme loupe a en confe'que®e été environ ÿ mmufts^fe'pluj- ÿ k.fnt^w rt„a
l’QuyriOf n’ea met communément en'n’employant que du Chai ban
s’eft-ells pas «flsntie de l’excès des parties vitriolujues & fulphureufé5_ qui fixées auforct*
Oi) creufet dois forge, lors de la formation de iafeeonde loupe, par le£haibbn'de içrrenirj'ÿ » S ”
minpît ençoro? f . -< ’ r.'il.dii1.fci-. >• '.
La qualité du Charbon de terre nVt-elle pas auffi influé for la ^üatriemé?TOÿoif; '
C e t t e Expérience du 12 Janvier 177^ n’ayant pas paru fatisfairpté, AÎ. ]é Comté
dé Stuatd prit Je parti de contremander ce qu’U attçndpit encore de fes' braifes.de Char-»
bon de terre de S. Etienne ; il fit enfoncer plufieurs des tonnes^Æi lui regojent, & n u il
trouva être de charbons défeaueiix dans le choix & dans le cuifage ; ce'Fut alors qu^ la
fcr^e d'Aizy on indiqua à M, de Stùard la Mine de Montcenis, Mi de Suffori- fui
l’opinion qüê îni avoit donné de ce Charbon un Mémoire de M. de Moryeau, V.kiigf
approuva ce confeil. M. de Stuard fe tranfporta à Montcenis ; il y fêjùuma quelque temps
pour feire cuire de ce Charbon fclon fa méthode. A la plus grande proximité p'offible du
même endroit, M. Roettiers avoit fait l’açqmfifitih^^d’i m I Î S k'-au
de b:pjs;j M. de Stuard fit conduire mné bohnè quantité de Cbàrb&h det
terre, préparé , & une grande quantité de brut pour le cuire à AixV j conformément au
defu qu en marqua M. le Comte de Buffon. A l’explication de la Planche XXXV, nous
avons décrit la maniéré-dont U a été: procédé à .Aizy. Ileffaya auffi. detirer paxtidu
reftant des braifes de Charbon de Si Etîenné qu’il avoit mis au rebut comme n’étant- point
bpnnea; il leur fit efluyer un fécond cuifage, après lequel des braifes mêlées avec du
Charbon de bois ehoifiT;fe trouvèrent encore généreufes à lafufïon des Mines , comme
on le verra bientôt; voyez, à l’explicatioa de la Planche XXXV, ■M r/fiwonsfur cent
eirconftance* - . ; L ■ ... ■ ; ; m : J J
Les opérations de M. dé Stuard*, guj paroiflent lui avoir concillé une appfobatiôn de
marque, ont été commencées dans les derniers jours d’Avril avec les Charbons de Mpnc-
Svec les Bfalfés de Chathùn de Teftè% ! -.
têÇw £réf«iiyùjftelieu p « le eulfagé'-àl’aifîlibrfe i eWfiiÊHafif.rôüs fe& y g® sffrô c ^ # e fb â t
a été figné^poidr(âvonalcrii dfeÿoir nü.us de île fOumértMà» une dîA
j ' W t , # is,kquellabff puiÇe^pqonrteï l’envie de Crmquet, n o lë o u s en
“ “ J® )* à,r?PEJ0Ç » de de Pïoéès-varbal %jeoididériei00s'générâlëS#u'»s^
danà 1 expérience.
1 11 v ?4 a ‘ 0-$*s t ar m ^ 'dè;'fe-poigi ê A î i fa w ?
A ladiutOr d;g^*b*taGhure intitdléet -An du ChrirbètmUï j ip u b ll'e -rén '-i-ty t, - pat fM i l
rÀg'0M â iâ } ^ ' nV0| Ê ' a ^ WîWl<ifbeque,deljAcadémie-des
1 A v a n t ^ t o £ ^ «M ém m r e :!ttès;ioféréf&nh^ !
M- sRflbert d e C uigneb ourg , dont 16 Méthode a é té ir e ,d d im .û { iS b 'liq a e u ^ « fd r ê ,d L
■ S ouye rd em c|t. Par rapport
a- feulqmqnt é té M e e f e * -d apportét quelques : différences pâncipalëmënt daqs ^élévation
ue ra thuy.eré, dans 1 éloignement desîiçoffiifereé) la-dhtlid p ;& c ; :
5e , ^ 4 “ i l te*îr'e 4 i‘2^i 1 étoit jo u t eh ‘ pieftps calcaires1 qui /h’éclatent Ipâs au feu »
fe c lfes.roê/neàfç;réduiîe éh ch au x , & ilpvertoif d’être reCoriftru'it le 20 © S ob re 1 7 7 1 ;
les dimerifions^ui vont en êtr^données j onq é«é vérifiêêsi tors de fa1 reeoüûrüàion , aval»
• • t i .... -i ..! r i 1 .
R MeJùfb^pL^nnvtpaks partiesi
Èlévatiqn.'d'arfdrtd an-de^us de H Su » eOU Gueulard, 18 pieds.
Hauteur mi|idhü à 16 'rtuyerè, 1 j ‘ pcmcî;si"s
* ^ o i g i ^ m e j » î | ; c a t é de à la -Rufiine, 7 pieds & deuil.
D e pi^s.>^i
"D e la Th uye re Çi>ipevents>\\ h.piedq*« dç&jjtj'j;-
: L z rg eq r^ g â .R u n lfle » ed f,b .’.s fur-’lc rtiùd* ’î^ '^ îe Js & éfethi.
L a rg ëu t déi la»#^éé>'îêB!hMt?;5
Hàuteur de lâ p i& r^ d ê ^ re r r fu f^V fu i le fo n d , 18 pieds & dettif, \
Longueur des pierres de Côfltr'everit & de Vhuyere, deph?s i Tympe à la Ruftine, â bleds.
L a rgeur de la T y mp e , M J S • m ‘f s : ? S
,. Hauteur de la bfeHaadèÆisnM^Tt ^ ^ ^<w»«^'^,i. .
L a rgeur du deffim fe * kÆyffl'pé C-d) i 4 pieds.
A-.un pied en-deflbus, cet étalage à ^ oe d r ^ p ô 'f f âM è T a ^ e u r . ’ • '
A deux pied#^nj-aefcêndanf eet étalage a a nieH. j p o u c a .
‘'gËnfeï** Cet étëlagë a
'E a rg ’èür' d e l^ fielave fu k la rfnffverè au “
A v t t - # a Sm f e e n d a n t fu l la T n u y e r e , ^ i e d s 9 pouces ôç demi de large»
A v de^x.pieds en d^cerîd^nt
ÂyttQisvpieds en dëfeençlànt fur ;Wî:,s* pieds îè ^ o ifé e s i
i'eyx- pieds feijrhuyeré* B ., , u v > . ^
oDârgeüPde l’ëtëfo|è fuW p RdfBni; ', V f f i e d à L ppuô^4~
■a Àl * f TeïrdefCen.danï pieW a lJ s s> y C o m p ïe ^ H ^ piqd. d’angle oWlpâd '
dfi | Æ M a .T h u y « e J ^.iâ-igouce s'd u g èté du Contrevent 6 • *1“ ' ’
defcendahpDr p ied s, d o n t8 pouces d’angles du côté de W
D h u y e r e ^ & ^ ^ s e s d u o ^ & w .p é it iæ s s ê n t ., v . • ,
il defeeftl ^ s% ^ ‘ ^ ?" î . 'a 7 t S # :f i f i ^ ^ ^ 6 ü e ê ^ â # p l d u côté
d e ^ ^ h u y e r e , & f potusa d r u c A r f » n P s V v V -/-*) *ir :
â e & Jb n tB y è iiç . ■ W D H H B h H
dCa) , Aàjfe i grand panieDCQirig,ol|, ®n forme de
^ î ra, f T Î 5 ? , de vipurne onde bSÿdëchêne »contenant
environ; une fèùUlettè ou ÿo livres de -Êh aYb ^d àW d elq ^è ?
Provinces ; dans,quelques endroitsle quart ê u & m de Char- •
b o n d environ 31 livrés pefant :1a livre de f o n c e s . La -Rato
ou M auffii, pleine qu elle ^ « î r è ^efl quelquefois Æ
tinguée paf le nom dë RÀ(fifk3 çfGm\ 1 : ■ “ ■\
I p | Po*og|rehdre ces dimehfîbns, if fïftt»dJëtre pré^'
Venu^qiaéïlIouŸra^e ou baflln dans, lequel le' m'é^l^tbrnbe-ën'
bain ecoat compole deion fond, de fa pierre d® tjiuyere, •&
i de celle de contrevent ; les pierres nffifes’fur le; fond'avoieiit
t6 pouces de ^ hauteur ; cëlles dë fMere étoient'éritaiÜées
£ouf y recevoir la^raque du' deflbus de la thuyere de 3 pou-
«es T. Les pierres que loi! emploie pour fàûvifag® ï8nt çal-'
q^ itçs, d’une cçfüleur tp^^îë jj|i6tt-gfel^jQ^s•< '^ îijs tendres qüç
I ’ % 4teî?g®s j l.R c'heminéesou le gueulard: fërjÉ auffi de
t 'Pgrces calcaires, ■d’im rà'&ilon peu épais, plus tendre que dura
cette qualité' de pierre’ eft f^ns .doutèi éjifbuVêè "dans eë'éô
forgea pour mieux réfîfter d-l^éSon du feu. M.'Çfignon ob^
^ rye 1ue eëit einploi; de pierres ëâteaices ^ pour les parois m-»
térièurs d’un, ouvragé „.eft irèsionérçüfè. ,Vo,y. auffi Y A r t def
■ ■ B H i i fcrz •
M* ae-Redümiit$ pagt 6zi Si fji ■
( ^»Part^^dq çréufèt. qu^ eft en-^g|é|.£io|i .avec té $èii\iê
1» thuyere- ainfî qqe lès pieqes qpj compofènç cèttè partie.
1,1/) L’épaiflêUr en hauteur de la pierre dé M l M u
différente,; elle n eft poftée iei que pour meplîonsq l’exà&itudé des dk