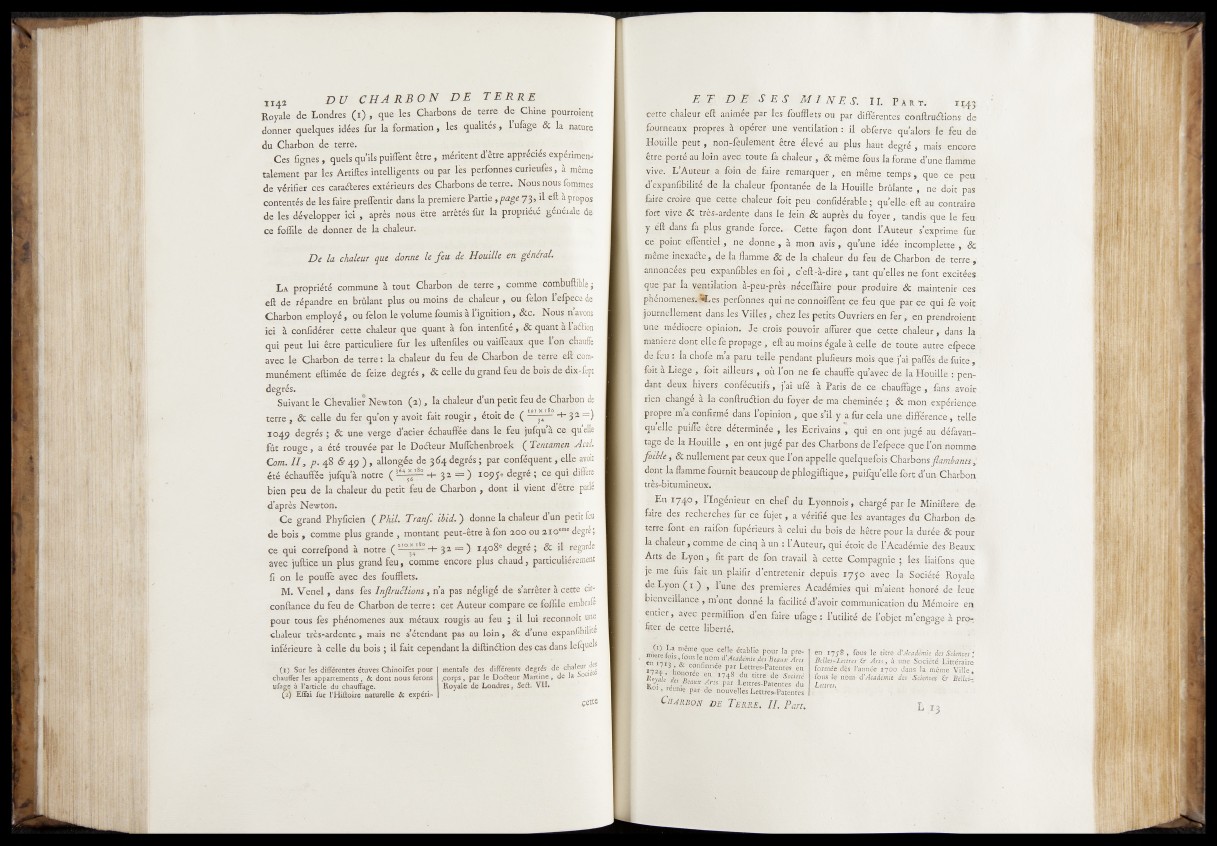
I I 4 i D W C H A R B O N D E T E R R E
ftpyale de Londres ( l> ,,.^ u e a e ^ ^ r b p » s (k,;-terra de Chine pourroîent
donner quelques jtjléfSifjfqr la" formation ,l^s qualités3i ,j..uîàge & ^a ^pture
du ChatbçA de teyre. . ^ j t.,
,Ces, % pe$, que^s q u ÿ p^üftnt être, mériten* jfetre $prfctfc expéqmenJ
talement par le» Artiftes inteUigçpts. ou par le? perfonne? Qtfiçpfcs » à' Hpme
d e s S ^ g q s caraéleres extérieurs d*s Ç^a^ops^de terre,
contenté» de les faire preffentir dans la premjprç Partie, page 7%,^ ^ProP ft
de les développer ici , après npus. être, arrêtés fut la > P ^ ï ^ ïM p M e^
çe foffile. de donner, de la . chaleur. -
De la chaleur que donne le feui de, B < p ittc ,e n ^ fraU
La propriété commune à tput Charbon ;d.e, tçjrte » . ^ ^ # | 9 H p ible >
eft de répandre en brûlant plus .QJJ moins jfes^clÿle.ur , ou, Jg
Charbomemplayé, ou félon le_volutq%fqq|ÿ&i l’gûlùqn , ;&c. ;.M©U| .Javasa
ici à cqnhdérej cette pâleur que quant à f o n ^ in te ^ ^ .& quapt à -^ lo n
qui peut lui être*particulière fur.les-uftenfiles çut^aiflian^qyeJ^Æauffs
ayqq le Charbon de l^.cha|eur dq^ feu de. Chatbanif e ^ ^agÆcotn -
munéoeent eftimée de feize degrés, &.çelle du grand feu p ^ i s ^ Ê - f e p t
degrés. .
Suivant le Chevalier Nev#9pt,(a), la chakpi4 \ ^ g ^ $ K ^ ^
terre , & celle du fer quon-ÿ-ayoît- fait rougir , étoit de = )
1049 degrés ; & une verge dacigr échauffée dans le>feu|^£quà cesBiell»
fut rouge, a été trouvée par le EJoéteur MpUchenbroek^^WeritâmethAcûL
Çam. I l , pi 48 6 4 9 ) , allongée de 364 degrés ; paç conféqusnt ,<el§' aypit j
été échauffée jufquà notre 3 2 1Q9 S* d e g r é s ^ qulpffsie
bien peu de la chaleur du petit-feu de Charbon , dont il yient detsj: parlé
d’après Newton.
Ce grand Phyfîcien ( PhiL Tranf. ikid.} donnela.phaleuçd’r^ ^ titfe ü ;
de bois, comme plus grande, montant peut-être a fon aooou 2 io ?f|degré j
ce qui correfpond à. notre J» “ J '1408e degré ; & tfnfepde
avec juftice un plus grand;fen*.comme-erurore plus chaud, partiggdÜremenc
fi :m$lè pouffe avec des feufBeçs.
M. Ven e l, dans fes ItifimcbiQm , na pas négligé de;-^arrètef fee^te 0 ^‘
confiance du feu de Charbon de» terre; éét Auteur compàte ce -feiïile llskrafii
pour tous fes phénomènes ans njétaux rougis au feu j il lu^ecannoît S^p
çbafeur t i ^ ^ d e a t e -,-mais né »étendant pas aw lo » , & d’tM M jfeabhhilit
inférieure à. celle du b p s ; il fait cependant la diflânétion des
Yfijtp; Sur Tes différentes étûvëS'CI&rnbiïeS pàHe
chauffer les appartements, 6c donc nous ferons
ufage à l’article du chauffage. .
(2) Effai fur l’Hiftoire naturelle Si expérim
en tale dés-différents degf<&
.corps, par.le Doéteyr Martine, de ||AûC1
•Royale'dfe Londres-, 8éft,"VïI.
E T H S. I I . P a r t .
c«te ^ K 4 aniple^par le s /^ jg e c j oti par rdiffér^tés%nftfUnions de
fourneaux prop^es4à a |p r e r unva> ventilaéiq^ ty, iU q^fervé-- qu aîb'rSë Iç feu da
feûUl&- ljM^ a ^ m fement au1-.plus degré j- .malf.-encore
B E 3 | forme'-dunf flamme
L’Autgug 4 ?feiu'4W-f/»ir%rqtnai;quer ..-.en»même, temps- qUe ce peu
d g ^ f i b i h ^ l e la |||L e u r fpontanée de lfelîoddr&-'br$knte ne doit pas
% ^ ^ § v q f l |. '!^ râ ^ tch^ieur f0i>peu..cor^cjérable; qu.’ellè»efl: au contrâiU’
, le feinf & auprès; duede^e^,; t a q ^ q u a l é fêth
fiç’dm dont fAu^eUp »exprime fut.
^pygfe^éâÆkllÛqé'al ^ î f c df alviS-^qu’une ridérifrinpomplpt-rp-} &
^ © e<| ^ ^ i % > |® % ^ ^ 1'dM|i:è%?J?aleurtdu feq., dfe Charbon de terre.,
onAUes ne font excitées
f l^ ia r^ la pou'r,,produire & maintenir-ces I
^ P i ^ ^ e ^ L e s pe^q^S^a^^qpnnoifréyiE.ce;feu^qhetipar çe-qu» fa voit
illest-^l^g^lff^iSÆs<iOuvriels en' fe^lîedl^érèiipieini I
pquyoir,- ^re^q'ua'.oe.të^ chaléun^j dans la I
ef,l'au moins,égale à celle de toute, autre efpcqel]
p.in^,tdle.,piqïd^ntspiple,ursj m^is,- qûelj^paffés dUfint^
^ 5A^d£SS'ÿ*ity1I:t*yytil!?s'»/ q ^ lo n ne-f^ehqufFajqt^a^ec, dâ la^Pk>,pâi^i'ÿ|)e[1_ I
à .^ariÿ^e^^èlauifâge '., ^fend. a^oxr
^ S ^ S I 'g ^ ^ ^ f e ^ g l d ^ ^ e r ^ fm a i ïG h e m i n é e ; ; & mon .expérience I
propre jtn’^ ^ ^ gm é jdaps4 |o g i |io ^ que,s’iby a fur.celafturiej.dipfencej, ttell» I
9u( ^ ieèS ^ -rè^®â^ tf^m ^ é^ ,£ le.s-Eçriivains.^qili en-ori^Tg^^n.
â e4 :^ ^iA i?Ç i1f ^ n».t ilg é^ ï ï d e ^ ;®harbonside!l’eïp'e^qüeil’on|ndînm,et
È lW.'h ^ J ^ ^ u ^ ^ a ^ G ^ x - ^ ^ ’o^apgel^qMq^fQi^ChaFbons ftambam&d I
b.e&ucoup dp.phl©g|ftique ^ puilqu’elldfbrt.d’un/chàrbùn
utA-bitr miireua, £ "
ï 7 4 ^>s l ï P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d u I^ag b j^ ^ çh a fg é îp y rje Minifleïq, d&
fairq vérifié que|lè^av4Rt%'ës dt? GfiarSon é h
à a # u i düTbàiâ^§|t§a,uh;Ia> durée. & pour
k -cf e # u r ^ ^ ^ d e - . c i n | ^ ^ ; rAuce4^quii^o^:â'|.ilipadçmie' dès*Beausj
Arts de Lygn^^M>|iJ de^fqn trayaii I
je-me|füjs„faitffp|^pkifir,vd;eg^s{eni|il depuis, e^ o ,aye© J^-Spié.cé.dRoyalq
dA&ygn;;iiv)i»|*i’jiinei des, premières Apadéipies, quilm’aienl' hionoréde leujâ. I
bifert.vèdlgnqàfj-mnnt^qp^Ja %c4|t^d'a^r^(M3.muni,Ga(tj(bn dh Mémoire en
i . avec; p_®rmjffipn d>n faifë u%e,: l ’utilité de K©hjet m’engage à prçg
% r ;de çetm libet|é. t
La n ême ’-qje, celle établie pour la'pVfe^
mierc fois, fous A arfc'mie ,ieJ ,
•*!! jgt^M . W
'¥>" » 74$ :da' titei.tfsi.tf'oàteé1:
'du'
en I7^S , fous le titre d'Académie da Sciences *
Belles-Lettres & Ans, à une Soçiété.Iiitréràire
formée 'dès l’année 1700 dans la même Ville,
fous le nem d’Æ«démie des Sciences & ’BtlUîz
hé|Mh |