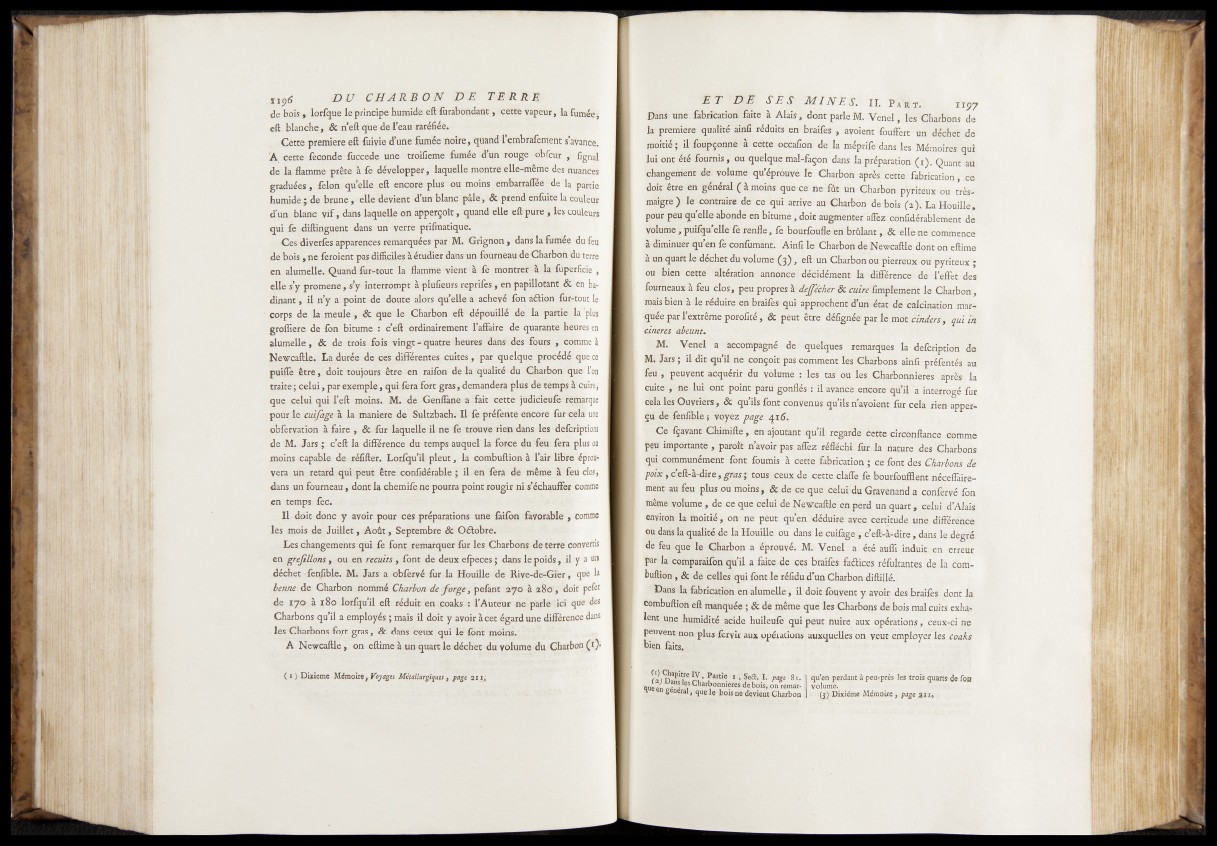
I ï9g D U' C H A R B O N D E T E R R E
de bols., lorfque le principe humide eft furabondant ‘cette vapeur, la fumée,-
eft blanche., & n’eft que de l’eau raréfiée.
Gette première eft fuivie d’une fumée noire, quandfetabrafèment s’aVance.
A cette féconde fùccede une troifietne fumée dmn rouge-‘obfctîr i \ fignal
de la flamme prête à fe développer, laquelle montre’elle-même des iufànces
graduées, félon qu’elle eft encore plus ou moins embarraffée de la partie
humide ; de brune, elle devient d’un blanc pâle, & prend enfuite la couleur
& n hlane v i f , dans laquelle onapperçoit, quand elle eft pure ; llpscouleurs
qui fe diftinguent dans un verre prifmatique.
,, Ces diverfés apparences remarquées par M. Grignon,, dans là fumée sdu fou
de bots ,n e féroient pas diffîciles'à étudier dans un fourneau de Charbon <fu terre
en alumélle. Quand fur-tout la flamme vient à fe montrer -âp%^%erficie ,
elle s’y promene, s’y interrompt à«plûfieurs reprifes, en papillotant &jjbn badinant,
il n’y a point de doute alërs quelleà* achevé :fon a®îon^^^tout le
corps de ,1a meule, & que le Charbon eft dépouillé de la partie fe plus
groffiere de fbn bitume : c eft ordinairement l’affaire de quarante'heures en
alumellé, & de trois fois vingt-quatre heures dans des fojurç; à
Newcaftle. La durée de ces (Jifférentes cuites , par quelque procédé pue ce
puiffe être.,'doit toujours être en raifon' de la qualité du Charbon qBe l’on
traite ; celui, par exemple, qui fera fort gras, demandera plus de temps ^cuire;
que celui q u rl’eft moins. M. de Genflànea fait Getté jüdideûfë-'re^uarqiie
pour le: cuifage à la maniéré de Sultzbach. Il fe préfente encore fur qëla une
obfervation à faire , & fur laquelle il ne fe trouve rien dans lës-defbriptions
de M. Jars ; c eft la différence dutemps auqüélllâ force du 'fèù fera ||lus on
moins capable:de réfifter. Lorfqu’il pleut, la Combuftion à l’air libre éprou*
vera un retard,qui peut être confidérable ; il en fera de même à feu clos,
dans un fourneau , dont la chemifone pourra point rougir ni s’échauffer ;Comme
en temps fée. b
I l doit donc ÿ avoir pour ces préparations une faifon favorable , comme
les :mois de Ju ille t,.A o û t, Septembre & Oétebre. -
Les changements qui fé font remarquer fur les Charbo>n$-de terfe convertis
en grefillons , ou en recuits , font de deux efpeces ; dans le poids|ul -y a un
déchet -fenjGble. M; Jars a obfervé fur la Houille de Rive-de-Gier, que la
benne de Charbon, iiommé Charbon de forge, pefant 270 à aSô'^feoit pefer
de 17 ^ à 18 0 lorfqu’il eft réduit en çoaks : l’Auteur-ne-pafhl'iidi:'que dès
Charbons qu’il a employés ; mais il doit y avoir à cet égard une différence dans
les Charbons fort gras, & dans beux qui le font moins/ f;
A Newcaftle, on eftime à un quart le déchet du volume du Charbon ( 0 ‘
( 1 ) Dixième Mémoire, Voyages Métallurgiques, page s u ;
E T D Ê S E S II. Part. xrp7
©ans une fabricatiori/faite à Alais*, dont parle M. .Vénel , les Charbbns de
la première qualité'ainfî réduits en braifes , avoient fouffert5 un déchet de
moitié ; i l foupçonnè. à cette, occafion de la mépiife dans les Mémoires 'qui
lui ont été fournis,.ou quelque mal-façon dans la.préparation ( 1 ) . Quant àù
changement de; volume qii’éprôuve le Charbon aprèS ' cette ; fabrication, ce
doir être-en général ( à moins; que ce ne. fht un Charbon pyVitéux-ou très-
maigre.) le contraire de ce >qui arrive amtéharbbn de bois.-(a). La Houille;,
pour peu qa’eHe-abonde en bitume , doit augmenter affe?:cdnfidérkblemcnt de
volume ,puifqu’elle fe renfle, fe bourfouflebn frô lan t, &'.élli*.ne Commencé
à diminuer qu’en fe confemanti. Ainfi le Charbon de NeVcaftle dontohteftrme
à' un quaMe déchet du volume (3 ) , eftiun Charbon ou pierreux .off.pyriteug ;
ou bien cette altération: annonce.’ décidément la différence- d e l’effet■ des
fourneaù^à'ffpu clos, peu propres à\d^ker^cüire!Ûm plem ent le. Charbon,,
mais blenîàfle réduire en bfàifestfqui âpprochent'd'un-état de calcïnaÜôn mifff
f | f t extrême poroüté*, & pèut être déhgnée par le mog;cinders ,jq u i in
Cffieressabéuhti, > •
; «M'. Vend' à accompagné d e ^quelques remarques la defcriptiôn de
M* Jars; ihdit qu’il ne conçoit pas comment lesïGhârbons ânfi'préferités au
feffj. *-feuyentiacquérir du volume : les tas' ou les Çfiarbonnieres' après- la
cuite , ne-luiront point paru gonflés&iliaVarice enfcore qu il a interrog|ifût
cela les Ouvriers, & -qu’ils font convenus; qu’ils navoient fur cela rien appèr-
çu de fenfible ; ypY.éz page 4 1 5 .
Ce fçayant -Ghimifte, en ajoutant aquil regarde cette, circonftance comme
peu importante, paroît n’avoir pas aflèz réfléchi fur la nature ,des Charbons
<|m communément foht fournis à cette fabrication ; ce’font des Charbons de
poiX'; ''c’eft-â-dire, gras} tous cenx.de«eette claffe fe bourfoüfllent Aéceflaire-
ment au feu plus ou'moins, & de ccsquç defoi du Gravenand a conferyé ,fon
même volume, de ce que celui de Newcaftle en perd un;quart , celhi id’Alajs
ênviro%;la#ioitiér, on,-ne peut qu’eaff déduire avec certitude, une différèneq
ou dans la qualité de la' Houille du dans le cuifige;, c eft-à-dire, dans , le degré,
de feu-!qqe le Charbon a éprouvé. M. Venel : a; été aufli induiti^n erreur
pan la/comparaifon qu’il a faite-de ces braifes fabticés réfultantes de la .combuftion
, & de celles qui font le réfidu d’un Charbon diftillé. :
Dans la fabrication en alumelle, il doit fouvent y avoir des braifès. donc la
Combuftion eft manquée ; & de même que les Charbons de bois mal cuits exha*
font nne hqqïidité acide huileufè qui peut nuire aux opérations, ceux-<à ne
peuvent non plus fervir aux opérations auxquelles on veut employer les coaks
bien faits,
■ g JK-'Se& I. pagi St.
bul i ‘es Charbonnières de bois, on remar-
S en général, que le bois ne devient Charbon
I qu’en perdant à peu-près les trois quarts de fou
| volume.
I : (3 Y Dixiéme Mémoire, page an»