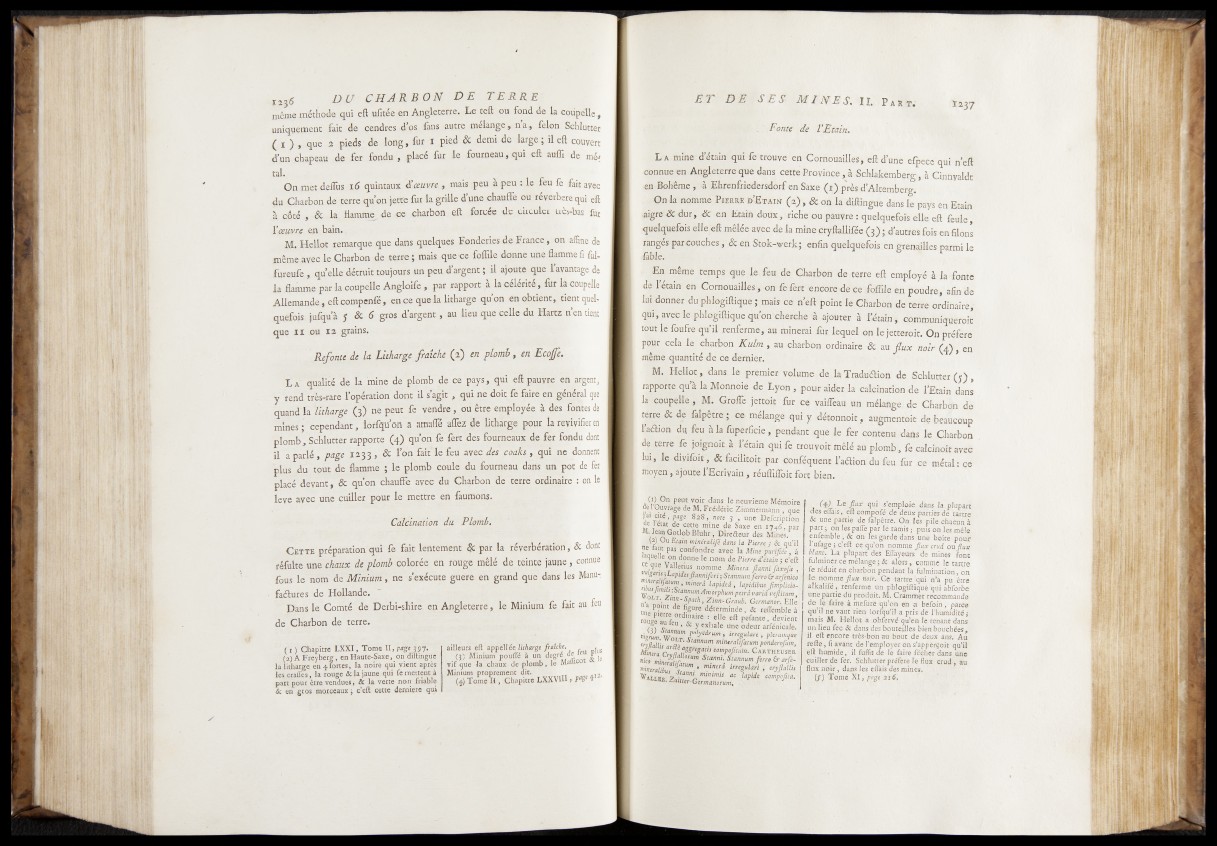
r J D U C H A R R O M D E T E R R E
n»êroe méthode .qui eft uficée-en Angleterre. Le teft ou fond de la conpéHe,
uniquement fait de cendres «d’os, fan? ^ t r e mélange,■ ma, feloni'SËhlutter
( i ) , q u e 2 ;pie.ds ; de - long, fur i pied & demi de large ; il eft couvert
d’un .chapeau .de fer fpndu , placé % le fourneau, qui. eft auffi de mé*
tal. - J r if, * '
©nmet deffos %6 qufotpux mais peu à peu; le feu fe fait avec
du fiharbon.de terre qu'on jette fur la gélle dune-chauffe o^foforberequi eft
.à çâté , & la flamme, de «e .charbon- eft fo rcée de circuler tiès-bas fut
Xoey&re en bain..
M. IfoUot remarque .que dans quelques Konderies de France,, on affine fo
«nême^spc le Charhc»',de.:ter*e;; mais que-ce foffile donne uhe^ammefi fui,
fureufe..* qu’elle détruit toujours un peu d’argent ; il ajoute que Avantage de
la flamme parlaÆQUpéfo Afiigiaîfe-», jp* «W»ort g g j célérit^ »■fur
Allemande., eft compenfé, en.ce quela liàarge qu’on en obtient, fient quelquefois.
jniqua f & 6 gros .d’argent, au ifouque celle du Hartz n’eu tient
que x i nu l a grains. .
Refonte .de la. Utharge fraîche (a ) en plomb t en E c o fi.
L a q u a lité ^ la mine de p lom F& ^ S |^ sV .q u i eft pauyre ^&gent,
y rend très-rare l’opération dont il s’agit , qui ne doitfe faire que
quand la ‘îitkarge peut fe verïdre, ou êtrp employée à desjontes de
m i n e s -1; ' cependant,"lorfqu’on a amafle affez J e fcfoârge pour lar||||f:e reu
-^forné'Schfotter rapporte (4 ) qupn'fê fert'des fourneaux dofo rfo ndu dont
il a parlé, page 1233 , & fon Tait le feu .avec > qüïi Bi d onnent
plus du tout de flamme ; le plomb copie du fourneau d a ^ un'potKe^fet
placé devant, & q ^m c h a u ffi’OTe'p du ÊÉarbon Bè fotre^or g ^ i r e | | | la
levé avec une cuiller pour le mettre en faumons.
Calcination du Plofnb.
Cette préparation qui fe fait lentement & pair la réverbération, & dont
réfulte uns chaux de plomb colorée en rouge mêlé de te iam jp n e , Ipnntis
fous le hbm Aq Minium t ne s'exécute guere en grand que dans les Manufactures
de Hollande. 1
v 'î 3Éuw Derbi-shire, ^A n g le te rre , le Minium^ fe
de Charbon de terre*
*"* ( r fOE p î t t é IX X I , Tome
Freyberg, en Haute-Saxe,_onf:^ihgfle.“
la litharge en 4 fortes, la noire quivient après
les craffes, la rouge & la jaune qui fe mettent à
part bout être vendues, & la verte non friable
& en . gros morceaux ; c’eft cette detniere qui
illeurs eft appellce litharge fraîche. .
(z) Minium pouffé à un degré oc « r
if. que 4a chaux de plomb .0e MaÆcot
linium proprement oit. ■ _ , , ,
y Tome I I , Chapitre LXXVffi j 41*
E T D E S E S M I M E S . I L P artv Ï 2 3 7
’, Fonte de VE tain.
L a , mine d’étain qui fe trouve en Cornouailles, eft d’une efpece qui n’eff
connue -en Angleterre que dans cette.Rrovince^^chlakèmberg, à Cinnyaldt.
en Bohême, à Çhrenfrkidersdorf en Saxe (x^ p'rèsd’Altcmberg.
On la nomme P®RR® d’E tain (a) , & arfkTdlftibgue dfty le .pays en Etain
4 gre S t duri S t an Etait) doux, fciphe'/w-pauvre : quelquefois elle eft feuler
quelquefois allejeftmèlée^ëc dp-la mrnepryftaUifée.(3)f;-d’autresfeis enfilons
fangâ parfais ches, & en Stok-werk; enfin quelquefois en grenailles parmi le
0 $ è ..■ S
. En même d i s q u e leffeu de Charbon de^erre-eft empfoyé4 la-fonte
depfl’ésain1 en €6rWuâiM^w^<e ièçt''encoÉè<lè-pe'fc®Ie en poédre^'-afinde
I» Crfdu ce n’e l% in t-le OE u b ô a de teàe ordinaire*
avefe fë,pWo|iftfouequ’o |y h ^ le« !à -.làjoutel- à fiéatm* qpmmràiqiieroic
l^ lC T d ü frc 'q u ’il renfefme^.au minerai for-foqueh.qp flfeffofmifonpréféré
pE r c c la ÿ .çharbon XuÈi,, auâéËarbpn'ordinaire en
n ^ q . qUantité«de-ce Setmor. ’ ' •'
M. ^ d l o t , dans,le premier volume;^de^làfratkaion de -Sqhlutter ( 5 ) ,
r ipporte qij a. la Monnoie de Êyon , pour dcfer-la -ealcibation de -l’Etain dans
llfcoûpelie, M. Gïoffe jettoit for ce vaiffeau un taéknge de Charbon de
terre. &;de filpêtré; mélange qui'y défcnnok, augmentek de beaucoup
l’aélion du ftu à la feie /pendant que le fer contenu dans le Charbon
de terre fe iolgn01[: à- l’étain qui fe trouvoit mêlé au plomb, fe calcinoit avec
lm’ fo divifoxt, & facilitoit par conféquent l’aétion du feu for ce métal: ce
mo© j ‘‘jbutèl’Ecrivain, réufllfToitfoftbien. '
m On peut voir dans le neuvième Mémoire
de 1 Ouvragé de M. Frédéric Zimmermann , que
j31 ,?ié ' pas* 8aS’ note 3 » une Defcription
de 1 état de cette mine de Saxe en 1746. par
I M. Jean Godob Bluhr, Diïedeur dés Minés.
. IWSÉIM mineralifé Mns U Pierre j 6c qu’il
P ne Faut pas confondre Ivec la Mmÿipjiiÿce. a
laquelle on.donne le nom de.Pierre d'éum ; c’eft
e,T ? Y?'Merlus nomme ‘Minera Jlami ïaxofa
mine^ > laptdibust ftmplicio-
^ R mS ^ ^ I u^^°rphump(trâvand»>ifiitéA,-
ow. Zmn-Spath, Zinn-Graub., Germaner. Elle
’ I B i M W i W & reffemble à '
elle eft pefante. devient
rf) v CU ’ & y «athale dhe ûdedr ârfériièaiê. ;
4 1 1 ;w™“mMJ**?»> J î p S I ?lin^
crilfülùt .a |T" ^ annum mineralifaium ponderofum,
lliira Crîffaif— C 1 ! j «Si tànni. Stannurri ferro & àrfk- i
™ ™ S u f fs T - ’ * imri imêulaH i'E y p u h
w k t e s z m ? i l i »
f4i>^ Le ƒ«*■ ' qui s’emploie dans la plupart
des eftàis, eft compofé dé deux parties de tartre
& une partie de falpêtre On lt® pile chacun à
part ; on les paffe par le tamis ; puis on les mêle
énfethble ; Sc on 1er gàrde dahlî-nné' boîte pou^
, I ux c.rud ou flux
ïiiant. L a plüpaft des Efthÿeürs '3e mute font
> & alors, comme le tartre
Je nomme /ter noir. Ce tartre qui n’a pu être
alkalifé, xenferme un phlogiftique qui abforbe
flhè partie du produit. M. Crtfthnjér recommande
de le faire à mefure qu’on en a bëfoin, parce
qu’il ne vaut rien lofftju’îl a pris de l’humidité ;
mais M. HeJlbt-â obfervé qu’en le tenant dans
un lieu fec & dans d.esbouteilles biénbouchées,
il eft encore très-bon au bout de deux ans. Au
refte, C avant dé l’8t6plbyèr ôn s’appetgoit qu’il
eft humide, il iuffit dé lé faire féçher dans une
cuiller de fer. Schlutter préféré lé flux crud, au
flux, noir, dans les eifais des mines, T
(y) Tome X I, p«gé 2 iS,