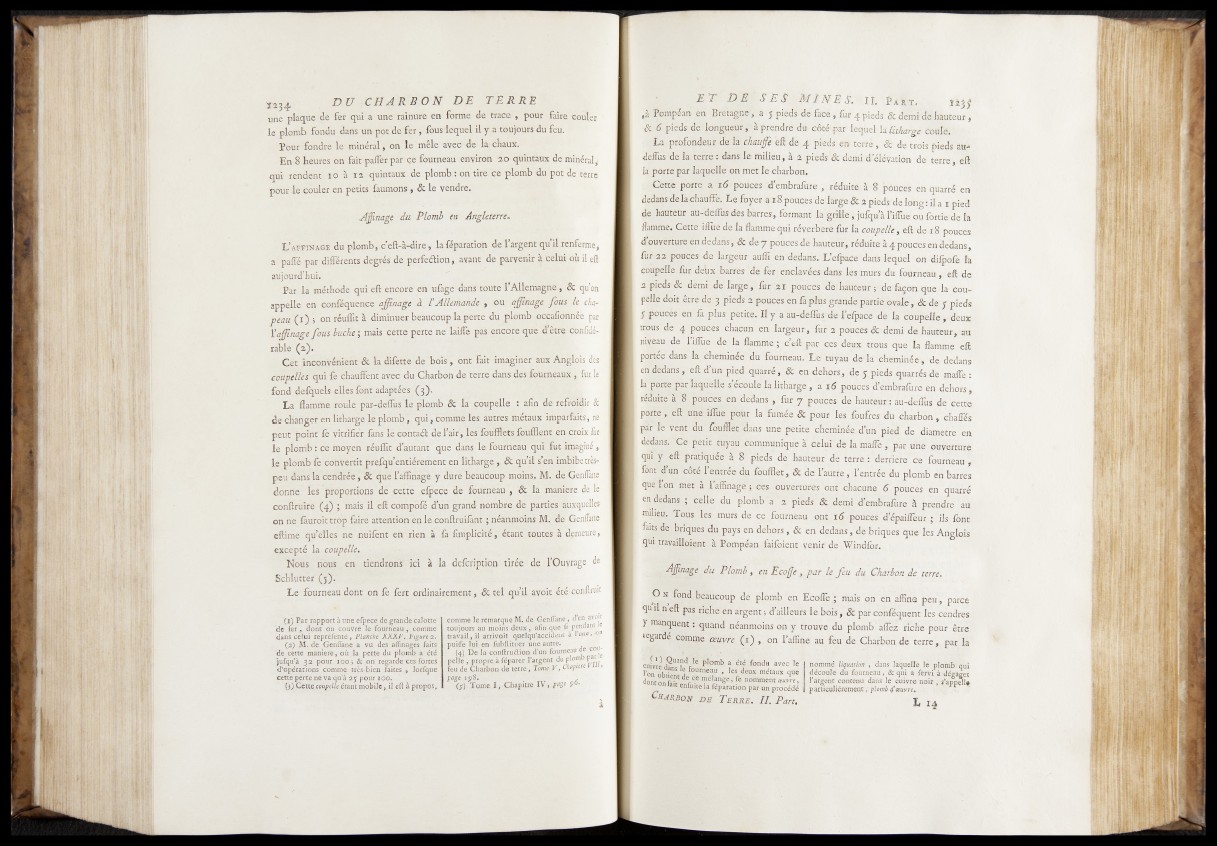
* 2 3 4 D Ü fCH A R B O N D E T E R R E
Üiàp plaque de fer qukà'■firflirtinure en forme de'trace-, 'pour ffairë"’$Qt!jïer
le plomb fondu dans un pot de fer,;~fous»l^ufe}».iLy-a-toujours d f feu.
, Pour fondre le- minéral ; o n 'ie mêl'e avec de la-chaux.
En-8 heures 'o’fofffltpaffer parce fourneau environ a o ' quintaux Whiïhéral ,<
qui rendent -io â i a quiritaux^de plomb.: on* tire »ce plomb du pot de terre
pour le couler en petits faumons, & le vendre,"
A ffinagt 'da Plomb en '■ Angleterre*
L’affinage du plomb, cefl-à-diro, la réparation de l’argent:qu.il renferme,
a paffé par différents degrés d%erfe£fion, avant de parvenir à cêfoi dp il eft
aujourd’hui.
Par la méthode qui eflrenéoré' eh: ufage dans touteTAllemagne-, & qu’otf
appelle en conféqu'ence affinage à t Allemandes» •PPÎ affinage chapeau
( i ) ; Ton réuffit à diminuer ferucoupla perte du^lonil^o^ffionnêe par
Y affinage'fous bucKc ; mais cette perte ne laiffe pas encore que d’e ® (^tiidé-'
rable (à)'.
Cet inconvénient & la d ife tte 'd e ^ d l^ ^m f â t^m ^ in ê r aux J a ffo is des'!
coupelles qui fe chauffent avec du Charbon de terre dans des fourneaux, fur le
fond defquels elles.fopt adaptées ify),
La flamme‘réule-par-deffusle plomb & li^ ç ^ p |l|e , :^ ïïh “de refiofdir &
de changer en litHarge’le plomb\ 'q u i, cbmmeies auk^piétaux. im'ESui:-., ne
peut poinfle v itrie r làns'lê contaçl de l’ai r rets. fouffl en t |||||o ix fuir
le pîomb : ce moyen 'réuffit .d’aytânt ‘que dans 1 g ’é »
le plomb le convertit prefou’entièrement enlifo^®e^&(qiul sjen'ffi^ibe très*
peu dans la cendrée, &."que l’affinage’y dure b.ë'aüfàuri’moins, tü ••-flffen^ane
donhe les proportions dé .cette e q E e l’çle fourneau, la maniéré défe;
conftruire (4 ) ; mais il eft compofé d’un grand nombre de parties: auxquelles
on rie fauroit trop faire attention en le conftruilknt ; néanmoins M. de- GenlTane
eftime qu elles ne nuifent en rien à fa fimplieité, étant toutes à demeure,
excepté la coupelle. .<
' Nous nous, .en tiendront ici à la defori.ptiq.rii" tirée *' dè .'l’ouvrage oe
ScHluSep Çy). -
Lé fourneau dqrit’ on fe fort ordinairement, & tpfoqu’ij^ypit p é eofiftruit
(1) Par rapport à une efpeee de grande calotte
'de fer, dont .on couvre le- fourneau comme
dans celui repiéfenté, Planche X X X jM Figure 2..
I (2) M. de GenlTane a vu des affinages faits
de cette maniéré, où Ja perte du plomb,a’.été
jufqu’à 32 pour t-O-dji*. dt'iOO' regarde çés-fortes
d opérations cou me tr l ien faites , lorfque
cette perte ne va qu’à 2 y pour 100.
fj) Cette coupelle étant mobile, il eft à propos.
arque M. de GenlTane, d’en avoir
oins deux, afin-,que fi pendant le
comme le rema
toujours au moins
travail, il arrivoit quelqu’accident ajgn?!, "
pùifTe lui en fubftituei' 'une autre. "SE,.
(4) De la conffiruffioii' d’un, fourneau “e c01
pelle , propre, à fépàrer l’argent du .plomb par
feu de Charbon de terre, Tome V , Chapitre V 1
fageirtÿSwéÛ ■ " r
Cf) Tome I , Chapitre IV, p?Se 96 -
E T D E S E S M ï N E s . I l Pa rt .
,à Pompéan en Bretagne , a 5 pieds de face, fur 4 pieds & demi de hauteur ,
& 6 pieds de longueur, à prendre dû côté1 par lequel- la Echange coule.
La profondeur de la chauffe eft de 4 pieds en. terré , & de trois pieds âu-
deffus de la terre : dans le milieu, à 2 pieds & demi d ’élévation de terre, eft
la porte par laquelle on met le charbon.
Cette porte a 16 pouces, d’embrafure , réduite à 8 pouces en quaft# en
dedans‘re |^ |li^ è j,E ^ fo ^ é ?% i8 pWce^de4 rge & ip fë d 'fd é io ig ^ ila i pied
de ha'ï^ùrfap-’dciïus d&sj&rres j &irfan^la’|riMe-iijufq^|iffu&oufo|ti^ÿe la
ferorije qui réverbere fur la eft de 18 pouces
dipuyefoutefl dedans / 8c di^p(Tûct,s'dérhauteur^|^41a/ t.^:a.4fpp'0Ces' en dedhns,
fij^Sjfp'ôuccs de largeur auffi eh^ejtà.VL’a l^ c e 'ddrfsfdleqüél,mn-difpofê l'a
cbügeHé fin delix Iaifos*dq fer enclavées'ida» llAïulÿs - dtp folrif^fka eft de
a-ppds5&! dëmii. dej ïa| | | , 1 * fü r 'q ii^M c ê s1 (3li|hpi te H r , t e ^ g ô ril?qu& fa 'Cou-
fclle'drii^étre'd'âfn'pfcds^püuCesptfaplTÉisgfande.parcie oyale, & de y-pied»
yE u c Js em.li plusîJpaitoMIl v a* a u d d ^ sfd ^ fe% ^W la * lô ü p ’ellâ^deifx,
‘S T i .6 d ^ ^ ^ e ^ |^ m ^ é i ^ ,d àg iéiiP,,vlur f ^ S s ^ f e d e m i ’de haVteur^du
H de lijiiie de eft
W ^ ^ f e i n ^ d u WSSÊÊ '?d ^ £ | ^ ï i | iW j *de 'dedans^
^ Fr * ^ < dc y. pieds quarq&idfe -foaffe :
l« P . a r -Iaq^jellè.sjecqule llfjtKmoÉI a A’cmbrafore eu dehors,
’ ^ ur^Z|Pouce^.'dê;Muteyr^?au-ïeiîus de^clrf©
rjliPdl la ptî-' Ie -v e ^m i^ ^ ffle t^ a n s u ^ p ç t i t e | } é î ' d© aàmenre e^
P:t'i^ tü y â ^ p n |fo tq u e à pelui d’e %mâtfe’^Varfunt; ouverture
i ® r ^ r'‘t ^ f ^ ’ a ^ F^ds1'1 de .liameif^.dè t m f l f f ^ r n e a u
ISliL^d uS jCoté’l entrée d.u fouffl^ , &, deâ^flire/'Een^qe'du plomb e^^arres
affina^; C é ^ ^ y e r t.u re s ^ ^ ^ r ^ à c ^ ^ ^ pouêes en quafré
ci dJdans 5ifeclle dù> p l o i tm f ^ piecfs & d e^ itd^ln^ra^re% i>ienfdre; au;
” mur^ . jjj
^ ^fo riq u e s.d u .p ay ^ en ^ eh o rs, & èh d e d aM / d l p ^ f s que les Anglois.
.^V^^i^gient à fejmpéan-^fàifoient.veriiij db^'^intlfQr.
’ en îh§af^ f& l dûfkaçbon de terre.
ƒ■?^ ,^% p% ic o u p çje plomb en Ècolfo^jj’majis 9,n‘en affîne peu, parce
quil n eft paï Hpie en argent 5 (d’ailleurs le bôis,'&par amïéqrient les cendres
y manquent : quand néanmoins on y trouve dù''plomb’allez riche pour être
sgar è cornue cewvre on l’affine aü^feu de Chafoon.de terre,, pat la
a:..feg0lh.'.ave1à'lis:'
j’on . •ns :™ fonmeaa , lés .deux métaux que
dontn r “ d e °e '"élarige; fe nomment ccuL,
nfe'it.enfiiicelafcpaiacion par un procédé'
nommé liquation , dans laquelle le plomb qui
découle du fourneau, 8c qui a fervi à dégager
l’argent.contenu dans le cuîvrfe'iêlisft^éffit
particuliérement, plomb 4'oeuvre, ..c: