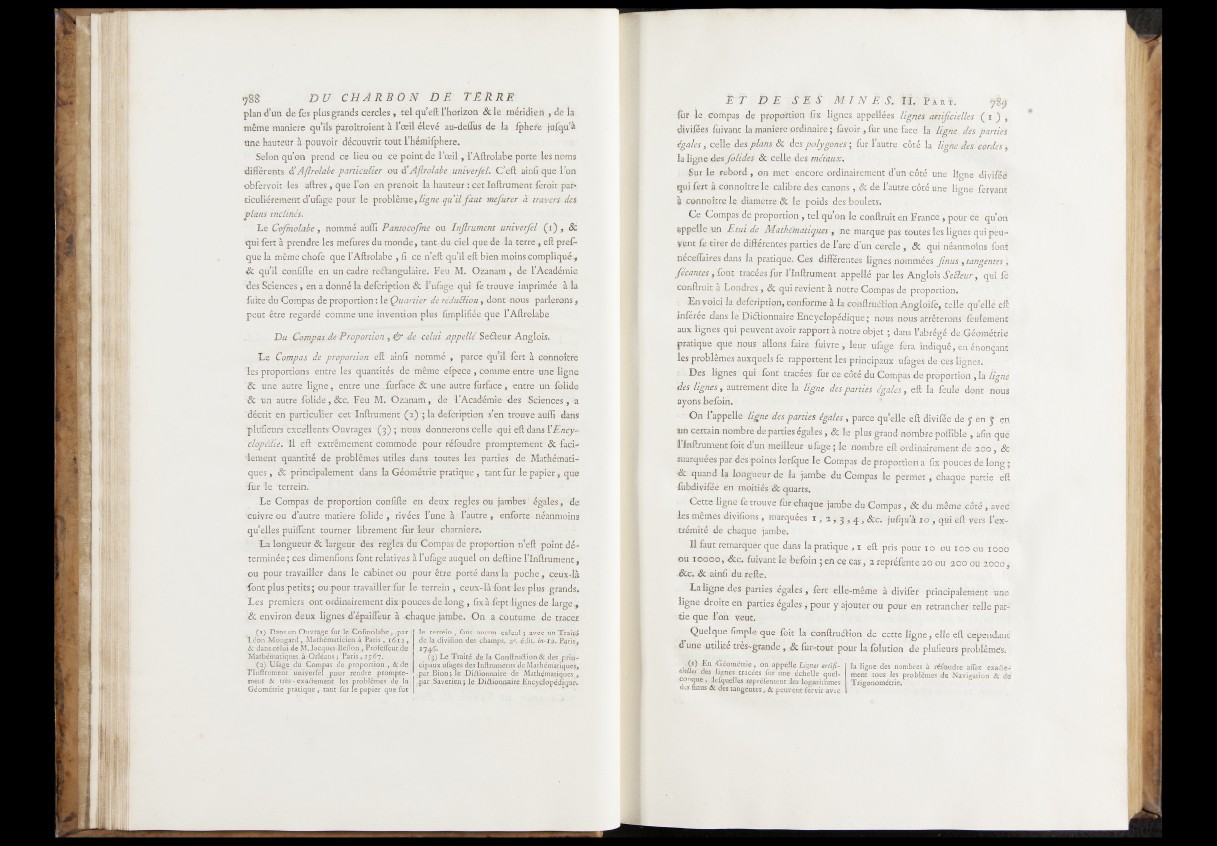
7S8 D U C R A R È O M D B TB R R B
pian d’un de lès plas grands cercles , & le méridie n V*w » .
même manière qu’ils paroîtroient à l’oeil élevé au-deflùs de la fpfee/e rjufojSitl
«ne hauteur à.piüv’oir découvrir tout l’hémifphere.
■ Séwtf.qjfà»; prendce tietafljjElseé pointde- l ’tîeil ij t’Aflmlat* pûïiûe .lél iübmft
différents ; êiÀftpid&be-particulier tin ynâ qiue l ’on
■qblèryoit -les affres vque i’on-«eaa p-rensk la hauteur.! çet lnftrurneot lèrQicrpaï";
tteulïéremeisÊ'd’üfôge pour le problème,ligne quil faut mefiiàertM:tmàateéB;afri
plans iïttIMesi
■ Le Vofrrtolabe, nommé auffi Poextobojftie ©U- Injlrumeht -lüMivxrjiL ? &
qui fort 1 prendre les me fores du mondetant-du-ckl-que-dè ; la terre 4 eftprsefo
que la même choie que l’Aftrolabe , £ j|e n’eft. qu’il eft bieàMojiègbmpliqué,,
& qujl confifte en umcad.re feâalâguLùçç. Peu M. Ozanarti , ;de>. l’Acadérnfo
^es KdfençeL» en à doïtoé la-deforî^on-éfc 4’uïàgè‘qvii fe trouve imprimée'à-la
fuite du GtimpaS déproborsoB i \c Quartier de réduction >.4offt«npHS parlerons*
peut être regardé comme «une invention plus fonplifiée^que ■l’;^rolàb,e. •
Du Compas de Proportion,& de celui appelleSeâeurjeApglqîs, r
Le Compas E 'l'pfipqrtiôn efft aitrïi trfbrrrmé / ’“parce q u ’îbfèrt-à cotinolafe
mssproportions ei&fer les quantités de rdètae efpece /cemàiîS'entrè une’ligne
& tmè adiré ligne, entre'runbïforfaEe-<St-une‘'autreftface1; .etffekin-foliâe
& tin àutré fôiidë ^ &c. Peu M ., dé 1 Académie des &rencesy%
'décrit -en particulier cet Inftrument (a )'; la derariptiond’en'tî^uve-auffi dans
^nffièûrt*'faà5Sfenisi3 h ¥ ï^ ^* ,!8 i5 ir4 l ^ dbntïerdns^Ke qsii eïbdans î ’Enc^-
' tliijffîlie. ‘H e ft 'extrêmement cbmtnode ■pour réfoudre 'prb'rrrptenrent & foef-
«lémeuft quantité de problèmes rntlles dans toutes leÿ'^pitftfes' ‘ dë‘fMat?hémati-
ques, âc prindipâletheiit‘ dans Ta Géométrie pratique“/ iant fÙTv-le'pipîèîÇ qiüs
te rrâh ; ’
Le Compas ■âe^ÆpSStforttSànlîfte' 'én deux iéglès^üu 'jambes' égales-,: &e
Suivre -ou d’antre matière ifbfiSé ,• riVëes T’bne a l’autre , enîbrte î néanmoins
qu’elles puiffent tourner librement 'for Teur ëharrîiere;
Ci La longueur & uaigettr dés' réglés au'Compasdè proportion tréft •pdrnt dé-^
terminée; ces dimenfions font relatives à l’ulage auquel* on dejranp l’Ipftrùmentÿ
ou pour travailler dans le clbinet,ou (pour être porté dans'la* poche, Ceux-là
dont plus petits ; ou pour travaiM'eï fur l e ’terrein- j-ceux-LàfontTes-plus grands*
Les premiers ont ordinairement dix-pqucesvde.long, .fixà-.i^tdignîe&ide -larges
J& envJron deux -Ljgnes d’.épaifleur.‘à -.chaque^jambe. iOn ;a-cPflâMè’.de ,cracèr
y (1) Dans an Ouvrage fur le CoTmôlàbe,, (par il le terrein , fans aucun calcul-; avec un Traite
Léon "Mongatd,.Mathématiciens Paris ,;iô i2 ,,' .de.la.divifion des champs.^0'. éclic. in-12. EacisV
.& dans celui de M. J.acquesiBeffon.,.PcôféfféûiJle jl 174-?. ' ...-,
Mathématiques.à-:Orléans ; 'Paris,,.1,767. I (3) Le Traité de la Conrtru'âiqnl&.cIes;prin’-
.(2) Ufage du Compas i.de^.proportion,, 8c de I cipaux ùfages des Inftruments dé Mathématiques,'
Tlnftrutnent univerfel .pour rendre .prompte- j .par.Bion; le DiSionnaire de Mathématiques ,
ment & très - exaftement les pr'ôBJémes "dè la j .,par.Sav.erien; le.Diaionnaire,Ençj[çIopé,cliqpè.
Géométrie pratique, tant fur le papier que fur |
È ~T P È J M S R f M N J U v I t } r ï. ÿ-%
§ir ie , 0;fop^4dè &X';lig0S«l‘^ppeHfi®fi lign&r.artificielles iT j
’dlvifoes foivaàt la riiRnicre ordinaire ; lavoir , for une facé la ligne des paniéi
‘ fu5^Jfc#*é «i Itghs.dtSjiyôrdes$
la ligne des filides & celle des métaux.
«à»J*\|ïÎMowi» jfrâinMJKBWit S*Hflîpdté uhe' lfgne d}vïliè"
qui fort à'fiflnnsltBele calibresd^s’x|nons' ,-Si de une'i iignd 'forWpi ‘
S l§tdiâtnptrÆ>dE>le' poids Idesîjsqèfofeï ; ■r
çelqa^oiï le éonftruit én Bïânb&^pour ieS^qu’èd
«PfM.le yn E tu i de Mathébiààqme ',mte^arqile pas tOulës les lignés-qûl^lu-
yfenf fo'rifor deVdjfoéiienîes parties de l'aretdWtegt^è ,' ,êc qui-néàriinôiiis Î Æ
bécedâtres dans la ^pratique.. Cas diffé tentas iïgn*es-ndmjtaées fir^s^tâkgentes \
f é m e S j font traces for flnffimment appelle par léS Anglais''dW^rS*’ q%lS
v à HjUK-WÂ-ffc à'nofi'ôrCiompas dé'^rapottion|!;
tt ^nyolci la'defaiptjaâi epnfeohe à la léonÇmâian^iigloïfe, teMe- mfëllé elî
foforée daqs l^Çiél&nnaÎKî1 E6éyÆl®|i'édîqua^^Sitffl|!fflÉrf'lM‘^iîiëmfen t
aUX-"ll^ ^ ^ Py!?%nt: JV,0iï ' “W0“ 1 objet M H Iftb 'i^ ré feb « fn e ttïe
pratique qiie nous; allons-faicê «foivre^ leur üfage.’ifoïâ 4ndiqu|,- <Li>’dSôïiftn(f',
es^ i l ^ le^ aux^n-el^ raPPoltt®a ^les principaux -îifggés âe!t e f l i|È & “k:
t.j Dns, lignes qm font tracées for oeidotéjcfo GoInpSs'H-ë-pr^pO'ftioq '$S.'dïghi
'{çttPlignes, mtrement^iie l a | ^ r ‘dt pintes \ h l l , ell la %i^Üofte"4<ouâ
ayons befoin. '
' r" 0x1 lV P eliô ligne ides parties égales, parce q^âlfetè^diviféédeJi èn f en
im certain'ribnsbr-e départies égales f
l ’in frum e h tfo k d?un meilleur u fà g e jle rièimbrê eft ordinairement de 2 0 0 , &
ànarquées pat dês-péîfflts lorique le’ Cpmpa's .de proppVtioMa^fiÿf^èHGësfdeian'g^
■& -quand la longueur de fo •ja'kibe duidëtnpàs.1 fo p’ifFHet. ^ I t j& v 'partie dft
fobdivlfoé en moitiés & quares. .
‘ Ce^digOë'fèttduvelrchaque jan^edutCamp^,’•& du.insnîe$âêé|avec
les K^nfosd^iflotis , ma rq u é e s^ , a! ^ 4 , &ù> Jaffiéit&f, q&i envers t<sx^
dxémité dé çhaquq jatr&e; jîl
iilblàüt remarquer que dans^É^if^^é-, i eït polir i S^d^i'dqiduff îso-0
fflü toà®ffl, &c.--fuivant le -befoin $,oû ée cas ^ i-repréfonté net m 'aeé'cm’aooOV.
Sec. & ainfi du refte.
Laijgpeàlçs'parties -égaies, fort ’ eî4@-même àbdiVifo^ prinâpa’léide’fft fone
ligne droite eti^p'frties égales /pour ^^Sùtiér cfu poM én'i|è’|rahclî%r^!ellë par-"
atie què l ’/on veut.
. jQue%ue^ P ^ q u ^ T o l t l^l^ftruâiori-'-de cëiie ligne/'elie.eff Cependant
â upe #l;ilke tics-grande 9 JSc for-Æow, pouw la folution de plafieura problèmes.
. (j ) En -Géqàiétr-iÉ ; On appeHè. Lignes aràfir
çiellis .désalignés racées iur unê .échelle que'ides
huus & des tangences
ft|l^^'<^ai8mMes:,‘à, .id^üdïÉ aâsx exaâê-
-ment -cousî-l^ff ipçoblêmSsfJiie Navigâàotf &r dé
•Ttigonométrici H