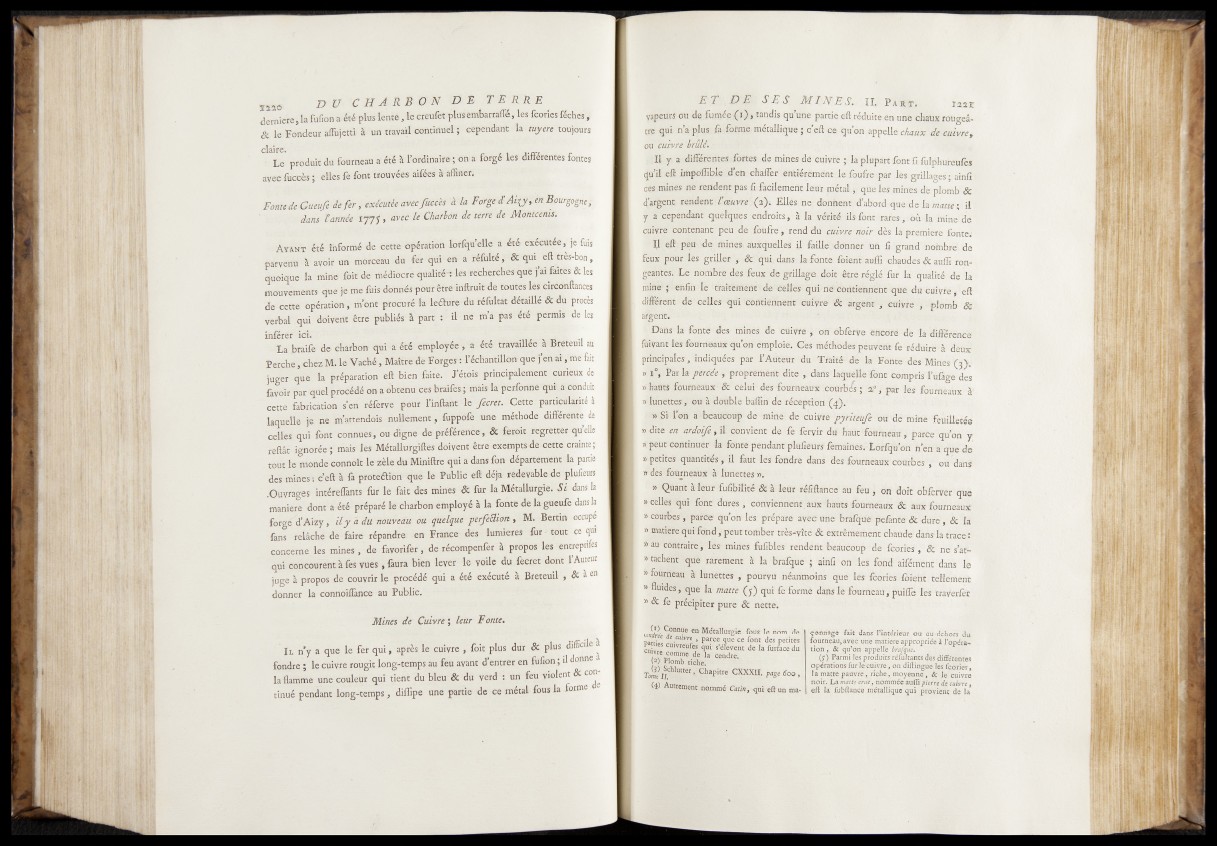
Maei D V C 'a A R É & :ÿf-, '}Ü- R t e r R iE
derniereslafufiona été plus lente, le creufët plu*embarraffé, les fcories{Schesy
3c le Eondeur aflbjèttl t un tpavad1’continuel ; eëpemfca* ■ k tuyère toujours
r t o pfMüiii dû-feürneau a été à-l’ordinaf^; ô^â- fo/gé kà-différentes fontes
<wæ fooeès. p ë f e fofon« troatvéÊs aifêes aafflm&S $
Fonte de‘GiïêuJè-defit ïZxieWè&avècfkêe'h Forge ÆAizy$é,Roürgogne,
dans Caftnà 177 ƒ , W & W M M dé toHê de -M m c é A k .
Ayant été fhformé de cfe’ttfe-dpérâtierfïloéfqu’elle i été» e ieü â té ep e fuis
farveriu a'ayèif un morceau du fer qui en a réfuh'é,- & qui e^É r ès-U ,
quoique la mine foie dè- t&É&orë q u a lif é ^ s ^ è bM ÿ q u e j J f t f ic ë s & les
mouvements que jë irfe fuis dontiés pour êeréudftruifdè -ïoUiés ièjgohflances
de cette opération-j- m’ont procuré la ‘leéïufe-du réfultat détaillé & def procès
verbal qui doivterit être publiés a part : il né m’a -pas fèW lf ë r i tiî§ ‘ de les
in fé re r'-i^r ^ .1
-La jbraife de charbon- qui-a été employée-,1©’'été travaillée a « ê te u il au
Perche, chezM. le Vache,-Maîtré'dè'Pdigès-i'^échàn'tHlôffqueq’ë h ^ ^ e bit
juger que la préparation ‘eflflllm’Â u e . ^
faWir par -qu-él.procédé on a «fenuê&sbfaifës;; mais la'pegS)'iînë^uiV»nduit
“ cette fabrication sien réferve pour ]& & * '% fti,A . ’G&tc\* p M ^ n t i 1
m’artendois nutiêfoenVj foppofe «une-méthode d i ^ îp f e de
celles qui font connues, o u digne de préférence, &«-£eïok ^ r ’etter quelle
reftât- ignorée';1 niais' les MétaLhTrgiftes d&iv'ehf etre exempts de cette, orainte;
. tout lé monde connoît le zèle du Miniftre qiai â dans fon d'épattetaïentfe partie
des mines; c’effà fa proteéfiôri que le Public e'ft--4 éÿa^ ^â^abledtfjlufieurs
| .Ouvrages intéreflânts for le fait des mines & fur k Métallurgie. S i dans la
maniéré dont a^étf préparé le charbon employé à la fonte de la-gUeufo dansla
fbrgé'd’Aizy, d -y a du nouveau ôte quelque-perfeclien'» M* Bertirâ oecnpé
fois relâche de faire répandre en France des- lumières fur - Æôut ce qui
concerne les mines, de favorifer, de réeompenférà propos l&»*treprifes
quî concourent à fes vues , fiura bièfi lever - le yéile du foerfet dont; l’A«eut
juge à propos de couvrir le procédé qui a été exécuté à.Éreteuil- , & à en
donner la connoiflànee au Publie.
Mines de Çmvtè\letir Fente.
Ii. n’y a que le fer q u i, après le cuivre , foit plus dur & plus difficile à
fondre ; le cuivre juugic long-temps au feu avant d entrer en fëfion; d donne a
la flatntne une c o u l e ü r qui tient du bleu & dp verd : un feu violent & con-
t-ihué pendant long-temps, diffipe une partie de ce métal fous la .-forme
E T D E S E S M I N E S . IL P a r t . xnttz
vapeurs ou de fumée .( i ) , tandis qu’une partie eft réduite en une chaux rougeâtre
qui n’a plus fa forme métallique ; e’eft ce qu’on appelle chaûkpdpcfivre,
owTuhre brûlé.
Il y. a différentes fortes de mines dé cuivre p la plupart foiat fi.fiflphureufef
qu’il eft- i*p«Cibk-d’otit'el5ÿSri*ÿni)iéFSmdnr;lelfe^(fi;e>pai' lès-grillages; ainfi
ces mines ne rendent pas fi facilement leur métal, que les mines de plomb' 3c
d’argent rendent l’oeuvre (2). Elles ne donnent d’abord que de la maire ; il
y a^'pendâni 'quélqigsl®}foits>,i -a k vérité- 'Ms» font, -rares , t oit r fo 'faine1 de
cuivre contenant peu de foufre, rend du «u* /â%o£r?d®% première -fontel!
^1 (eft: peu-, de -mines- auxquelles U fa ilf^ d ^ n é r.M fi .'grand' riofcVe^de
fe&}?pbur dans k^fqnte' foienfcuæflj »obudes'&kûffi fofti
^eameT L Jn S ’ftBfc des feux ■de’ù;nllage>t'Uoit -être Jte£lolfuE la? 'qualité de'la
mise* ffetifiit le tfeîte'IfleiÇrvde^eèlle's'-qiîî'iiS'eërititefinent qùes- du côfyre ,^-eft
(MPerdïft • dl'•G#éï»Sqfi icëâTiëiïnferït enivre ’Ss àrgêfiî’,. eifîVre j jÉ É p g &
wKfoÿ l a - ' jëüiV¥e , ^ ô b f e r ÿ a MfcSfe* âb la différence
fixant- reS'#ôfifr?Miïÿ'qé’^ éiiîpldië. ^ rmétfedês'péûvéiîGffe^éai& ^ à | jeux
dü TraSêîltfe' k Eonee-dès-Mines
» A -P * là /^ •e ÿ < p fê p r‘êffiêfft-'dite ,/dàris-làqdélié-foht fcèmp'risT#êge'des
» hauts fourneaux & eêlui des fourneaux courbées ; a 0, par les fourneaux à'
» lunettes, ou à double baffin de réception! (4). 1
©'bS-l-ofl' ^ b e a im p de-immé <te*cùiUtefyHeeù/é bû^dé' mirrè Feih'Iîeèéd
>» 3 it-e ^ /^ -^ ^ p if-c p y ife n t de Te foryir du haut‘foûtPeau1, pâtee'qu’on ÿ
>e|^tfébngfltrér?'4 '.fohte pe»dai#plafiëurSi fèmàiriés.-Eorfqti’on h’étfb-que de
»petite qâ^nSîfes,. il faut 'lès fondre d'ani dès fourhéàiix,cfiefbds'/-ou danS
*’des'-fG'àrhe‘auX‘ â? lïmettés tf.
Quant- à;feu¥’fu-fibat'iré-!Ss à- leur réffftânce au feu ■ oft doit obfervtr que
» celfês -qui- foftt' dorés , conviennent aux ’haWts fôurfieatfx & âSX-ïoirfnèàuÉ'
» courbes, parce qu’on les prépare ayèe une bralqué pelante & dure, & la
» maüèîë-qwfônd ,•* peut-tomber tfès-vîte' & extrêmeAént'Chaude daés^la trlc ef -
” au contraire, les. mines fufibles rendent beaucoup de fcories, & ne s’af-
» tachebt’ que rafement à la ^ b r^ ù é ; ^ ? e ^ i l e ï r : ^ i é le
» four^êau "âi lùnettes , pourvu néanmoins que lëis fëcrriè'flfiiieHï tellement
» fluides, que 1a rrtatte (y) qui fe formé dans le fournèâüypüiflé les irayerfet
*;f* & précipiter pure & nette.
. n.j y ----p, *uçi#uui-giB.aQw ac nom ae
^naree de cuivre g parce .que ce font des petit«
P tues çuivreufes qùv s’élèvent de la furfecédt
éé la" cendre;
(2) Plomb riche.
CXXXn. pagitoo,
i$ ) Autrement nommé C«t/n,.çpii eilun ma
çonriage fait d'ans l’intérienr on aü-dehors du
fourneau, avec une matière appropriée à l’opération
, & qu’on appelle lirafqitc.
(y) Parmi les produits réfultants des (différentes
opérations fur Je cuivré, on diftinguè ies fcories ,
la matte pauvre riche, moyenne, & le cuivre
rioir. Lamarre crue, noimmée audi pierre dé cuivre,
eft la' fuBftance métallique qui provient de la