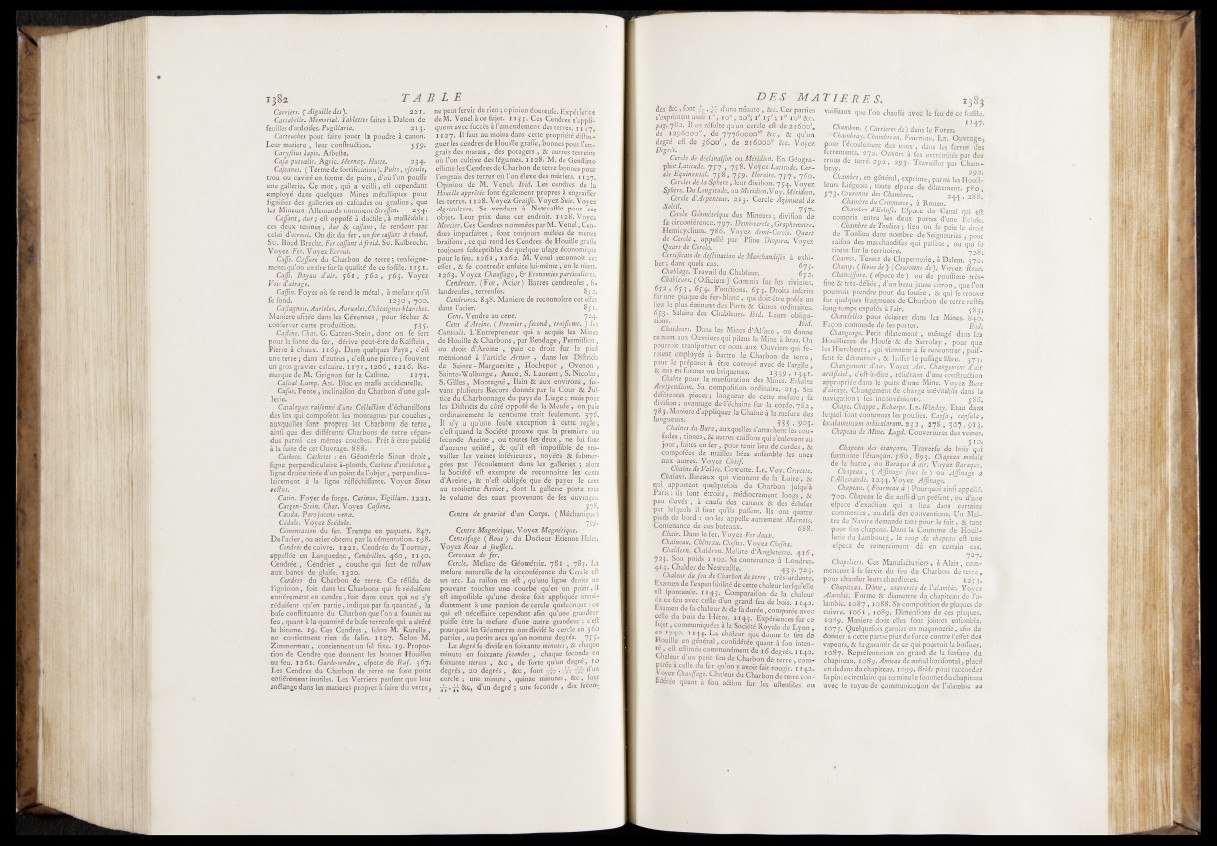
1 3 8 3 T A B L E
' Gartabellç. Memorial. faMMés faites à 1 Dale2mi, dl e* ' *~
feuilles>d’ardbifes'. Fugillaria. , |
- Cartouches pour faire' jouer la poudre à êàitf®#.-
Leur matière , leur conftru&ion. 339.
Caryftius lapis. Âftieftè;
- Cafa putealis. Agric; Her-na^. Hutte. 234.
Cafcanes. (Terme dé. fortification). Puits , efcoule', ’
trou ou cavité en forme de puics ,4 d’où Ton'pouffe ■'
une gallerie. Ce mot, qui a veilli,-'eft cependant
employé dans quelques Mines métalliques qpmr
Ægmfier des galleries en cafeades ou gradins., que
les Mineurs- Allemands nomment Stro/Tèn. 234.
: Gaffant, dur ; eft oppofé à du&ile , à malléable ;
ces deux termes , dur & caffant-, fe rendent par
celui dVcroui.- On dit du fer , ùnfer caffant à chaud.
Su. Bocd Brecht; Fer caffant à froid. Su. Kalbrecht.
Voyez Fer, Voyez Ecroui.
Caffe. éajfure du Charbon- de terre ; renfeigne-
ments quon en tire fur la ^qualité de ce>lb®ile. 11 3 I.
CaJJi. Boyau d'air. 5<$f j- 362 363. Voyez
Voie d'airage. -
- Cafjïn. Foyer#!; fë rend lé; métal}, à mefure q;u i|;
fe fond. 125 0 , ^7©q;
CàJîagmu. Aurioles. Auruoles. Châtaignes blanchesv
l^aniêre uitéé dans les- Céyennes, - pouf fécher-&
conferver cette pïoduâion. ' - i, f -?v ^333,
v', :0 afiine; <Chat: G. -Catzen-Stein, dont orr-fè fert
la fonte du fer, dérive peut-être deKalftetn ,
ne peut fervir de rien; opAftiOndfeèüfe. Éîfpérfê^cê
de‘M; Vènel à-eéffyij^ 3 y.^ S ^èhdre^s’applIs
■Cquent avec fuccès à l’amendement des terres, k 1
Æi'27. IlTâut/aVmpîp^dansKcètte'pfbpflSëcË^^^f
guer les cendres de Houille graffe, bonnes pour l’engrais
Pierre à chaux» 11(59. Dans quelquesTays,- ceft-
une terre ; dans d’autres ,c ’ëft une pierre î fouyênt '
un gros gravier calcaire, 1 1 7 5 ^1^2##^. I2*(L Èe^-
anarque.de M. Grignonfür la Caftinê. ; - 1 1 7 1 .
^CafualLümp. AnV Blociën mafle accidentelle; |
Ca fûs„ Pentély îdclmaifonMü^Qhar b pii' d’ un e gal-
■ - ' Catalogue raifonné d’une Colleftion d’échantillons '
des lits qui conîp©fênt4 es montagnes par couches ,
auxquelles font propres * les1* Chârbôns^ de- terre7,
ainfi que des différents Charbons de terre rép'àn^
dus parmi ces mêmes couches. Prêta être publié '
à la fuite de cet Ouvrage. 888.
Cathete. Cathetes : en Géométrie Sinus /droit-/
•ligne perpendïciilaire à-plomb.*Car/zete -à?incidence9
lignerdroite tirée d’un point de l'objet, perpendiculairement
à là 'ligne réfléchiflante. Voyéz Sinus
jre&iü*
Crnin. Foyer de forgé. Catinus.Tigillum. Tiiïziy
Catien-Stem. fjkat. V©|fi|B;: &fime. >- J1-
, Cauda. Parsjacens vence.
- - Cédule. Voyez Scédule. ?
‘Gêmmtau<m?àxï fer. Trempe en ■ paquets. 847.
De l’acier, omacier obtenu pat la cémentation. 198.
>J' Cendrée decuiVre; 12 2 r.-Cendrée déTo'ûtifày/
appeliée en Lànguedoc, Cendrilles. 460 , r i 301
Cendrée- % Cendrier , couche-qui fert de te&um
aux bancs de -glaife. 1320.
Cendré dif'Charbon dë7 terre. Ce réfidu de
l’ignition, foit dans les Char bons1 qui fe réduifent
^entiérement en cendre ,■ foit dans ceux, qui ne s’y
g Téduifèrit qu’en partie1, indique par-fa quantité , là
bafe conftituantë dû ' Charbon-qu^f pma fournis au
feu, quant à la quantité dé bafe terreufe qui a altéré
le • bitume; 1-9. Ges Cendres , félon M. Kurella
ne- contiennent rien, de falinv i 127. -Selon M.
Zimmerman , contiennent un- fef fixe. 19. Proportion
dé Cendre que donnent les bonnes Houilles
su feu. 1261^ Garde-cendré, efpeee de- Jkaff ywjk'
Des ipendres- du Charbon de rerre ne‘ ■ fotif-qjoinc
entièrement inutiles. Les' Vërriers penfent que leur
jnélange dans les matières propres-a fa,ire du verre 2
des marais, des potagers, &t autresi'terfêiî&
où l’on cultive desdégumes. 1128. M. de'GenlTanef '
èftime ies Cendres le Gharbèà de; terre bo.n©res. 0 ^
l’engrais des- terres 'bTOljn.éleve' dës;ïnûriers. 1127*
- de M. Venel. IfeiC Des cendres de îa
H.ouiiïlê. apprêtée font également propf està?- engraifler
les te'r'lesv 1,128. Voyez Crmff . Voyez ^«ie. Voy ea
Agriculture. Se vendent à Newcaftle pour cet
objet. Leur prix dans cet: «ndfbit. 1 128. Voyez
Mortier. Ces Cendres nomméesîparM^‘^epel,'Ce'ni-
dres imparfaites , font toujours mêlées de menus
braiforis , ce qui-iend lés Cendres' d&H'Ouille graffe
toujours fufceptibles de quelque ufage économique
pour lefeu. 12.61- i jM-.’ Vei^lIr^^noît cet
effet', & fe contredit enfuiteA^i-mêmé", en lé niant.
1263+ ‘V oyez Cliaiffag&yfr' Economies particulières.
*. T?éRrffèibr.'t(Fer, Acier ) Barres 'cendfeufes, f|#
landreufes, terreufes. 852,
. ^endrürci/’;8^^maniëre^de^ë^
dans1 l’a c i e r . -, v
Cent. Vendre au cent. 724.
Cens d'Areine. ( Premier, fécond , troijieinê. J Jus
Çamicudh ''LtEntîêprenëü'r., qu^^Facquis les Mines
de'ï|<âi>dMe &-Charb©ns, par Eendage, Permiffion,
ou droit d’Areine , paie ©endroit fur le pied
mentionné à l’article ^razer , dans les Diftrids
Mafgûefite’^^jpècËepMyM^ ^ n o n ,
- Sainte-W:alb^fg^j^AnG^#§^i’auren:t^'^^UGplas,
Montegné j^Ilain J& aux environ’s^fùi-
.vanr ■ plufieur-s^Rèfeo'fsMolm^f^^^^^ ^ ^ S ^
Liegé *. :ma|s:i|:o;;|r
' Jes- Diftrids dlfeé^é^Wdféxde^l^Mëûfe# M i #e
ordln^rement le, dedaem’e1 traitvfeul^m^ri^3'mw
c-eftqùand làt^eié^^gjwe 'qüe la première ou
Arfeine^ ou^^fbs^le^deux^^ ffiif font
.&* qifil eft ii^CM^^ide ’tr&«
. vaillergées
.pair/ l’eoeu'lèment1' Wn? lës^gaTléH'ês^^ lors
.^^S^'ëiété' ‘de cefp
îd^Areine’, - 8 ^ i’'ÿft-’‘ obligée"; qü.e “d ^p a y ^ l® cent
Iroifiëmë Arnier 3 "aorit la gailër^ ^ pe tout
le- volume des e a ^ TproVehrèîf He • jpSBBrages.1
^ ' " " " ' ' • ' 378*
1 Centre TJde- gravité dfan )
Centre Magnétique.- Voyex Magnétique.
rCçittnfugi ( Roue } di^ Doéfceûri \Etiéqtie Haies.
e^ àfbjufjleOE,: 9
’t ^s{C^éû]^0fde ferr.
'Cercle. Mefüre de- Géométrie. 781 j 7®|> La
mefure naturelle de la- circonférence dpiifÇercle- eft
un arc. La raifon ëh^eft’ qû\Une41^né; .d4è|II ne
pouvant toucher une ‘courbe- qu’enr :u)# polie, il '
éft idipoffiblé qu’üne dfoite1 foit:appliquée immédiatement
à une portion de çerde qtfelcônque : ce
qjûi eft néceflaire cependant afin^qu’une grandeur
puiffe être la' mefure d’une autre grandeur ; c’e'ft
poûrquol les-Géomètres ont divifé le cetfcle en 360
parties, ou petits- arcs q,u; on nommé degrés, *
r Le degré fè divife en’fbixafifè minutes , & chaque
- minute en foixante fecohdes y chaque' fécondé en
foixante tierces , &cc , de forte qu’un degré, ïo
’ degrés,, ■ » 'fegrés , &c , font 7^ ^’un
cerclé-; une minute , quinze minutes , &e , f» t
' 7t * H d’un degré 5 une fécondé , dix- feVôfy
D E S M'A
T 1 E R E S. ; 1383’
I ^ûhfeaux que ff&ü chauffé üVeê fe féti dë ce fofiHev
'dès &c î-Toai ~ . d’une -minute , &c. Ces p'artics
pàg$ $$2. Il ^|p|éfe^;qu’:uu æerMe: éft. dé/2'?è'6f©|)4 - »1
» & qu’un
C/iamio«-. ( Carrières de) dans le Forezt ’ ~
'Chambray.Chambreau. Fourneau. r .Ouvkge ».
pour 1 écoulement' des eaux , dans lés ferres^ des
»U|rfeiitS,'a 7* . , ® tlvert à-fes extrémités'pat des
M m L ' W ‘ - < -•'-.#2?'
• degré eft de 360c/ , de M jp êfeife &c. Voyez -
w p f i ;
Cercle defficlinajifdn ou Méridien. En Géographie
ÿyy 1 758. Voyez Latfcud&fmrA -
de Equinoxial. 798, - 75*9. Horaire, yy 7!1, 7^'Oi,
:Sfhere.,Be %'opg^ieiiommmkenèf05^ Méridien’.
I ffÂrppnmr« 2 13 . CerciesA{immal*dit
11 ‘'il ^ - r f i H r"’ ' .y
1 Cercle. Geomef^yiie des Mineurs ; divifion dé .
fa circonférence.797. Demi-cerc/e,Grap/zomeïre.
Hemicyclium. 7,8b. Voyez demi-Cerde. Qmæ;1
par Pline ZW jv. Vovez
I ' Quart de Cercle^,
WfyMhpmqicfarnuoni ié-Mdphaniifü âi.^ÈK
I 'CAflWajd Trayail'jd'u.Ghableuc. t i 6c2.
Chableurs. ( Officiers ) Commis fur les rivières!
I (’^2 > ^ 3 > ^ 4- FbjjéüonJi 6.f,^ Droits infcrits
fiElV! plaqjie de fer-blahc,,. qui doirêcré pofée au
lieu le plus éminent des Ports & G; „ s- ord i lire
Salaire des Chableurs. l ia i Leurs fefeiji|aw
| f -î I ! H • H H h b /
C/iflirfenn. Dans les Mines. d’Alface on donne
ceno® 11 x Ouvriers;qui pilen la fiî ne i br is. On
pourrait cranfporter ce nom aux Ouvriers qui fe-
roient employés à battre le Charbon de terre,
I P°U1 Pr®Parei; ^ être, eorr-ojîé avec de l’argile, I
I ÿ I
P h 1 l menfiiL-ation des Mines. ElMric I
4 i:vipradiiim. Sa compofition ordinaire. 214. Ses
I différentes p ece longi eur de çet't§^ef(&êliïS3
divifion ; avantage de 1 echaine fur la corde. 782,
783. Maniéré d'appliquer la Chaîne à la mefure des
W’o V
>duiBjn^ l^ icIlL lartaf Hcne lcStou?1
, t des, t unes autres caiffpns.qui s’enlevent-au
■ f e . faites en fer , pour tenir lieu de t ordes , &
compofées de mailles liées enfemble les unes
.irpi il m . llatc.ux 'qiitX\CnS=î8c la I oire , & I
qui ^ apportent, quelquefois, d 1 Charbon <p][qj||ij
êtrar-^j^vpiedtocrnK^'n.tS' &
Peu élevés ; à caufe- des canaux & des èclufes 1
Par le i j j j j r - jtpa'l-ntl Ils ont quatre
pieds de bord : on lesi appelle autrement Marrair.
Contenance de .ces bateaux. t l t ^gg.
C/iair. Bans le fer. Voyez Fer doux.
. Chaîneau., Chêneau. Chefna. Voyez Chefna.
À CAaWe™- Chaliron. Mefure d’Angleterre. 4 1 ^ !
i723- S0fl Poids 1102. Sa contenance à Londres. I
j4I 3- Chalder de Newcallle.. - s ?2j _
Chaleur dufeu.de Charbon de terre , trës-ard'ente.
Examen de I’expantibilitéde cette:chaIeurlorfqii'ellé
eft fpontanée. I J 43. Comparaifon de la chaleur I
d e s . feii avec celle, dion grand feu de bois. 1142 . I
Examen de fa chaleur & de fa durée, comparée avec 1
celle du bois de Hêtre. 114 3 . Expériences fur ce
iujet,commumqucesàla Société Royale de Lyon,
5jM740- i i 44- Lai chaJetiii^«u%donne le feu de
Houille;en général, eonlldéréé quant à fon inten-
té, ea eftiraée càmmunément de 16 degrés. 1142.
Chaleur d un petit feuide Gharbon de terre corn-
pîreélpcelle dp fer-qi^'on y avoit-foit rougir. 1 14 2 .1
Ivoyer Chauffage. GhaleUiî du Charbon de terre con-
Jidérée quant à fon aflion fia» îles uflenfiles. ou
^ i ^ f ’Pârmi Ils'Hou:;.-'
klSurs Liégeois h téut« erpeeé.-deMilitementf ' « J
^ ‘^V;' ‘ 24fùi 2*8^ 1
& 'Eé^len. " ' ' I
Sj.t-%lnâh qui •''eft
L ' compris %ntrod^rcfeu# pôfct^ (Rb]\Sf\
Ckambféde^bnUei^fÈehifé^ff&^^è^roÛ'x
de* ^wfifeüydànsî nbmbÈe^de^ei'gnëuriês y pouiî ]
qpi f i I
I ‘i -tiFentff^^^f^Iftblr^.
’i ^ ‘aîëmï%7^§j
I ^ ( $ oue' 'ÿfa'fetz^Rôuéü I
I \ ^ Ç j
fin^^^|sÿdéliée, j a u n e I
I poWoi’t 'Fen ^ r % & qm*#crduvï I
de.tbfre/'iVftés1 ]
long-temps expofés à l’air. . I
^ Chandelles- pour éclairer- dans les Ætfesfâ$?%ôfS I
Ka’^on commode de les porter. J ^ 5 I
M'Clmgeage^ Petit: dilatedie^^‘'^ériÉ|e^Ws^ïès
iMouillieres- de Houfe J p'èur % è I
Iles HierehëtHrs, qui vienh'erîD à^'fê rencontjer’^^mf^l
1 1 |?%* I
I artificiele eft-à-di're ,ç kË fiai tah%^nê n>,jl
I appropriééM^hs lë ; pmts^â^me^.KLine. Voyê&^reil
£ airageChangement dèVchargé inévitàblê dàn$ lâ |
l'nâ^ga^oml;^
I ; i Qiape.* €hàpp& y EcBàrfiè. fÆVWinffay. Ptâû dans, I
hcùlamentum'drfiçulàrum. 232 , s y f , 3 0 7 ,9 13 ;
Chapeau de Mine.- Lugd. Couvermres'iAè# veines» I
• Chapeau des étanpons. 5Travérfe,’ dë'#Èi0|s,iquîJ
. ^^|ü®mb'nfe^’étançbn. ÿ i Chapeau mobilé
' \ <■ d^wlg^IiûÉê^ <QvfR,drk^ùe<£ÿir'f^çj'f^Ràràqi}e4 \
Glvapeaw:, ( Affirtage] fc >' o^Affinctà à I
- VAllemande: 1234. Voyez' Affinage^ \ ; 1
1 Chapeau. ( Fourneau à ) Poiifquoi aîàft kppéllé.-:
7°0- Chapeau fe dit auftî d’un^préfentou-^pe
efpece d’exaétipn qui a lieu dans certaine
p j , commerces / au-delà des çoriVebtîons. Un’Maî^
V> tre de Navire demande tant poür le fait, è tant ^1
K„pour fon efiapeau'.Dans la Coutume de f j j j j j
• lerië ae chapedu 'eft;%ne
^/»ëfpèce ’de^emèr^^pbtM mfjepS certain' càs/'J
rH \ * iK y i' ï f ' ' 'lü <
, 4 Chapeliersy Ges Mamtfafhiriers / à Alàis , cbm^'l
mencent à fe fervir;n du ;ftu‘ déCharbën- de terrë^ I
- pt^ùr chauffer leurs çhâûdièresi - - . - / iM*3* I
Chapiteau. Dôme, couvercle de l'alambic. VoyezI
Alambic. Forme &- démettre dû chapiteau de l’a- j
\ lambic-1*087, 1088. 5a compofition de plaques de
■ cuivrev i^és-ïië’' ;e'és plaques»
L *1^8:^.. J^ahiere dont elles femt/jbmtëS’ ënfemble/
\ AÈbfjg. Quelquefois garnies en maçonnerie’j afin de
dbnner à^èctè partie plus d.e fo'rcë- contre l’effet des
vapeurs, ;& la garantir de ce qui ppurroit la boffuer**
. 7* Êëpi'éfëntation en grandde; là furfaCë-, dû
'chapiteau.* 1089. Anneau de métal horifontal, placé
iph^dedahs.'duçhàûifeau^^^.' tac^araef
- C^pince circulaire quhtçrm'ineje fomçnetdû chapiteau
avec le tuyau de communication de l’alambic au