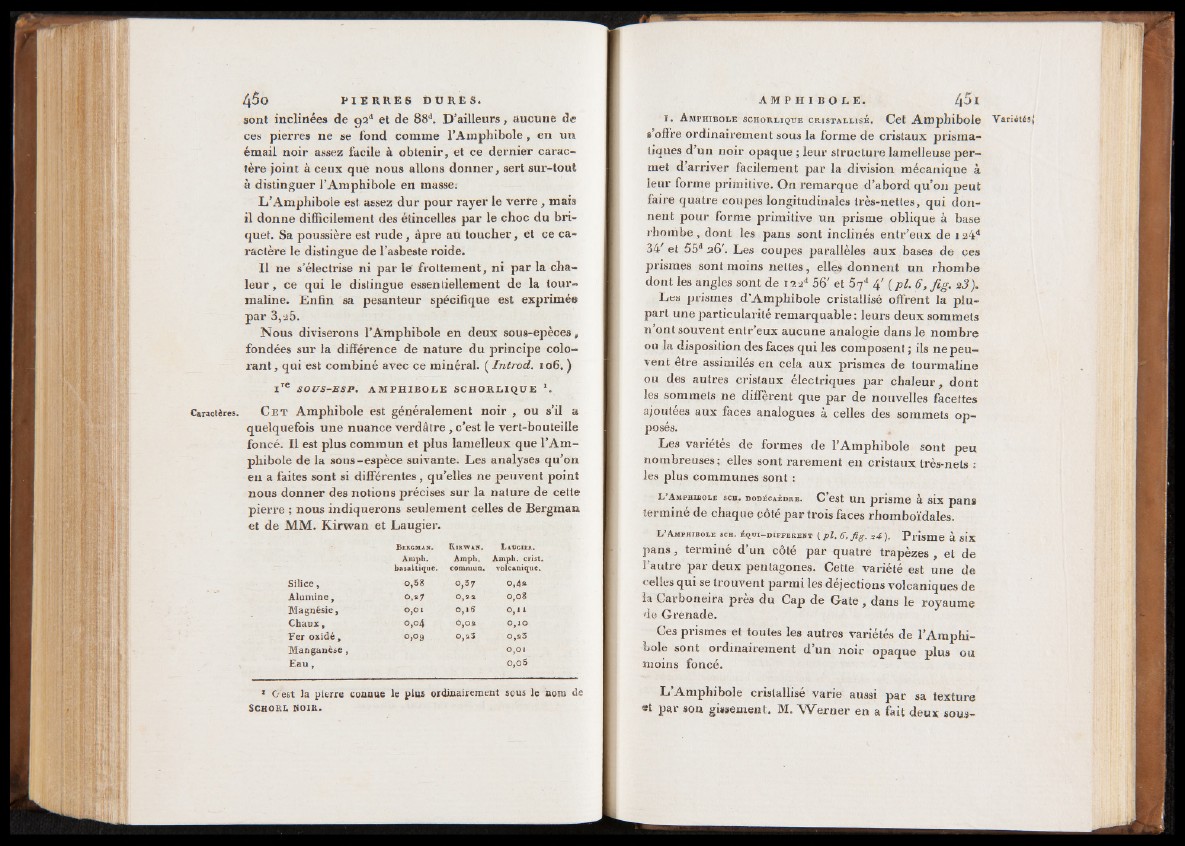
sont inclinées de 9a4 et de 88d. D’ailleurs, aucune de
ces pierres ne se fond comme l’Amphibole, en un
émail noir assez facile à obtenir, et ce dernier caractère
joint à ceux que nous allons donner, sert sur-tout
à distinguer l’Amphibole en masse;
L ’Amphibole est assez dur pour rayer le verte, mais
il donne difficilement des étincelles par le choc du briquet.
Sa poussière est rude, âpre aü toucher, et ce caractère
le distingue de l’asbeste roide.
Il ne s’électrise ni par le' frottement, ni par la chaleur,
ce qui le distingue essentiellement de la tourmaline.
Enfin sa pesanteur spécifique est exprimée
par 3,ü5.
Nous diviserons l’Amphibole en deux sous-epèces,
fondées sur la différence de nature du principe colorant,
qui est combiné avec ce minéral. ( Introd. 106. )
i re so u s -e s p . a m p h i b o l e SCHOB.LIQUE *.
C e t Amphibole est généralement noir , ou s’il a
quelquefois une nuance verdâtre, c’est le vert-bouteille
foncé. Il est plus commun et plus lamelleux que l’Amphibole
de la sous-espèce suivante. Les analyses qu’on
en a faites sont si différentes, qu’elles ne peuvent point
nous donner des notions précises sur la nature de cette
pierre ; nous indiquerons seulement celles de Bergman
et de MM. Kirwan et Laugier.
B e r gm an . K ir w a n , L a ù g ie r .
A m p b . A r a p h . A m p b . c r i s t .
b a s a l t iq u e . c om m u n . v o lc a n iq u e .
Silice, 0 ,5 8 0 , 3 7 0 , 4 a
Alumine , o , » 7 o ,® a 0 ,0 8
Magnésie, 0 ,0 1 o , i 6 0 , 1 1
Chaux, 0 ,0 4 0 , o a 0 , 1 0
Fer oxidé, 0 ,0 9 0 , a 3 0 , s 3
Manganèse, 0 ,0 1
E a u , 0 ,0 5
1 O est la pierre connue le plus ordinairement sous le nom de
Schorl hoir.
1. A m ph ib o l e schorliqtte c r i s t a l l i s é . Cet Amphibole
s’offre ordinairement sous la forme de cristaux prismatiques
d’un noir opaque ; leur structure lamelleuse permet
d’arriver facilement par la division mécanique à
leur forme primitive. On remarque d’abord qu’011 peut
faire quatre coupes longitudinales très-nettes, qui donnent
pour forme primitive un prisme oblique à base
rhombe, dont les pans sont inclinés entr’eux de 124d
34' et 55d 26'. Les coupes parallèles aux bases de ces
prismes sont moins nettes, elles donnent un rhombe
dont les angles sont de i22d 56' et 5qA 4' (p l. 6, fig. a3).
Les prismes d’Amphibole cristallisé offrent la plupart
une particularité remarquable: leurs deux sommets
n’ont souvent entr’eux aucune analogie dans le nombre
ou la disposition des faces qui les composent ; ils ne peuvent
être assimilés en cela aux prismes de tourmaline
ou des autres cristaux électriques par chaleur, dont
les sommets ne diffèrent que par de nouvelles facettes
ajoutées aux faces analogues a celles des sommets opposés.
Les variétés de formes de l’Amphibole sont peu
nombreuses; elles sont rarement eu cristaux très-nets :
les plus communes sont :
L 'A mphibole sch. dodé caèdre. C’est Un prisme à six pans
terminé de chaque côté par trois faces rhomboïdales.
L Amphibole sch. i£qui—d if f é r en t ( pl, 6t ^>4 ), PriSUlC à SIX
pans, terminé d’un côté par quatre trapèzes , et de
l’autre par deux pentagones. Cette variété est une de
celles qui se trouvent parmi les déjections volcaniques de
la Carboneira près du Cap de Gâte, dans le royaume
de Grenade.
Ces prismes et toutes les autres variétés de l’Amphibole
sont ordinairement d’un noir opaque plus ou
moins foncé.
Variétés,
L ’Amphibole cristallisé varie aussi par sa texture
et par son gissement. M. Werner en a fait deux sous