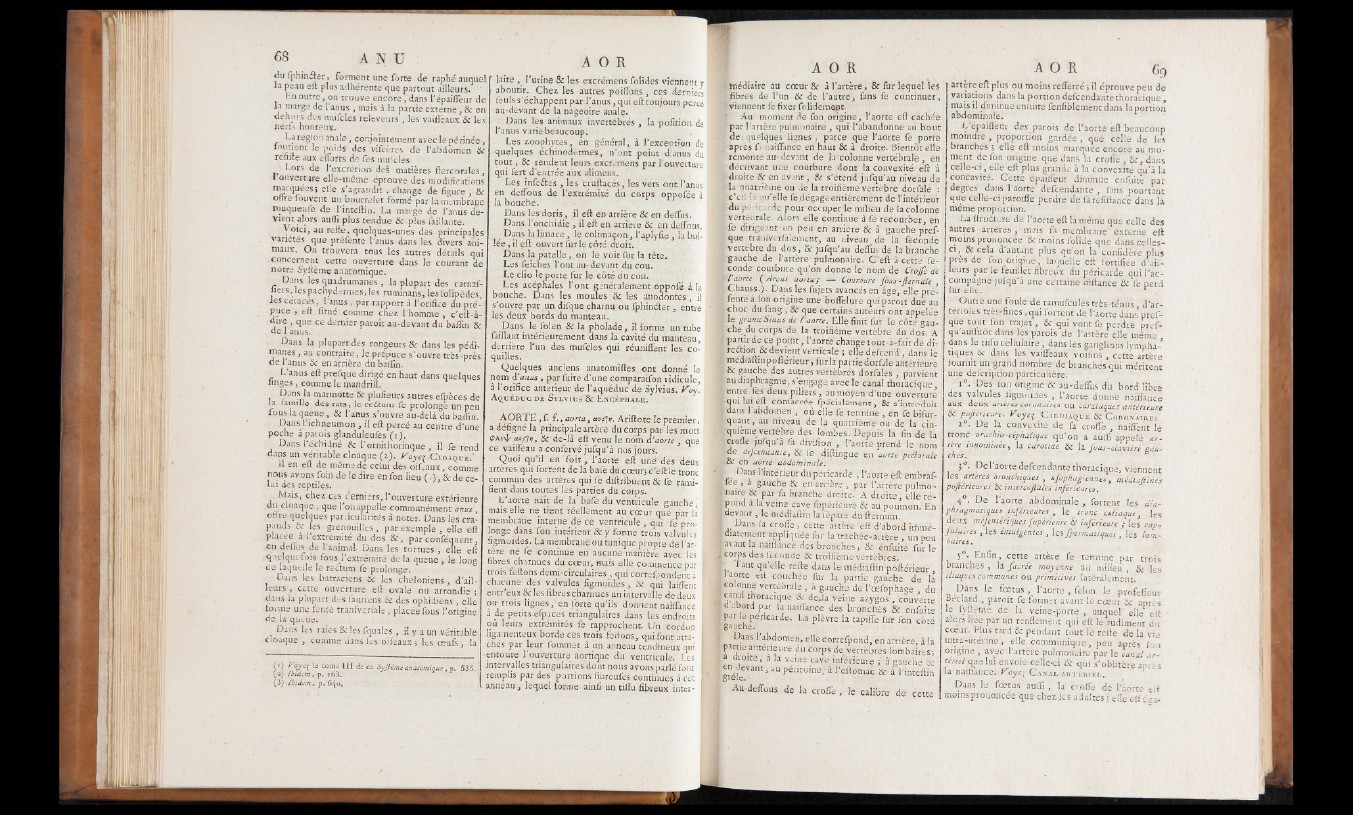
68 A N U .
du fphinfler, forment une forte de raphé auquel
la peau eft plus adhérente que partout ailleurs. *
En outre^ on trouve encore, dans l'épaifieur dé
la marge de I anus , mais à la partie externe, & en
dehors des miiicles releveurs , les vaiffeaux & les-
nerfs honteux.
La région anale, conjointement avec le périnée ,
lnutient le poids des vifcères de l'abdomen &
rêliite aux efforts de fes-mufcles.
Lors de l'excrétion- dèl matières ftercorales,
I ouverture elle-même éprouve des modifications
marquées î elle s'agrandit , change de figure , &
offre fouvent un bourrelet formé par la membrape
muqueufe de l’inteftin. La marge de l'anus devient
alors auflî plus tendue &-plus Taillante.
Voici^ au refte* quelques-unes des principales
variétés que préfente l'anus dans les divers animaux.
On trouvera tous les autres détails qui
concernent cette ouverture dans le courant de
notre Syftème anatomique.
Dans les quadrumanes, la plupart des carnaf-
liers, les pachydermes, les ruininans, lesfoüpèdes,-,
les cétacés, l'anus , par rapport à l’orifice du pré-'
Puce , eft fitué comme chez l ’homme , c ’eft-à-
d ire , que ce dernier parole au-devant du baffin &
de 1 anus.
Üans la plupart des rongeurs & dans les pédi-
manes, au contraire, Je prépuce s'ouvre très-près
de 1 anus & en arrière du baffin.
L’anus eft prefque dirigé en haut dans quelques
linges, comme le mandrill.
Dans la marmotte & plufieuts autres efpèces de
Ja famille des rats, le reéfum fe prolonge un peu
m la 9“ e,j e , & l'anus s’ouvre au-delà du baffin.
Dans: i'iehneumon , il eft percé au centre d'une
poche à parois glanduleufes ( i ) .
Dans l échidné &: l’ornithorinque, il fe rend
dans un véritable cloaque (2). C loaque/ ;
il en eft de même de celui des oiLaux, comme
nous avons foin de le dire enfon lieu (0 , & d e celui
des reptiles. .
Mais, chez cès derniers,, l'ouverture extérieure
cloaque, que l'on appelle communément anus ,
offre quelques particularités à noter. Dans les crapauds
& les- grenouilles, par exemple , elle eft
pla.cée^à l'extrémité du dos & , par conféquent,
en deffus de l’animal. Dans les tortues , elle eft
quelquefois fous l'extrémité de la queue, le long
oe laquelle le recïum fe.prolonge.
Dairs les batraciens & les chéloniens, d'ail-»
leurs , cette ouverture eft ovale ou arrondie y
dans la plupart des fauriens & des Ophidiens , elle
dorme une fente tranfverfale, placée fous l’origine
-de la queue.
Dans les raies &les fquales , il y a un véritable
cloaque , comme dans les oifeaux ; les. oeufs, la'
M §|§|%; CGn*e I fl de ce Syjlème anatomique, p. 535.
(a) Ibidem, p. i63.
(3) .Ibid em / p . 640,
A O R
laite , l’ urine & les excrémens folides viennent y
aboutir. Chez lès autres poiffons , ces derniers
feuls s'échappent par l'anus, qui eft toujours percé !
au-devant de la nageoire anale.
Dans les animaux invertébrés , la pofition. de
l’anus varie beaucoup.
Les zoophytes, en général, à l'exception dé I
quelques écninodermes, n’ont point d'anus du !
tou t, & rendent leurs, excrémens par l'ouverture
qui fert d'entrée aux alimens.
Les infeéles , les cruftacés, les vers ontJ'anus !
en deftotis de l'extrémité du corps oppofée à
la bouche.
Dans lé s io n s , il eft en-arrière & en deffus.
Dans l'onchidie , iLeft en arrière & en deffous.
, Dans la limace, le colimaçon, l'aplyfie , la huilée
, il eft ouvert fur le côté droit.
Dans la patelle, on le voit fur la tête.
Les feicnes l’ont au-devant du cou.
Le clio le porte fur le côté du cou.
Les acéphales l’ont généralement oppofé à là
bouche. Dans les moules & les anodontes, il
s'ouvre par^un difque charnu ou fphinéfcer, entre (
les deux bords du manteau.
Dans le folén & la pholade, il forme un tube
Taillant intérieurement dans la cavité du manteau,
derrière l'un des mufcles qui réunifient les coquilles.
Quelques anciens anatomiftes ont donné le
nom d'anus, par fuite d’une comparaifon ridicule,
à l’orifice antérieur de l'aquéduc de Sylvius. Voy.
A quéhuc de S ylvius '& E ncéphale.
A O R T E , î. î . , aorta t ttofjvt. Ariftote Te premier ,
a defigné la principale artère du corps par les. mots
(pAê-vJ/ ecop']t]i & de-là eft venu le nom d'aorte que
ce vaiffeau a confervé jufqu'à nos jours.
Quoi qu’il en fo i t , l’aorte eft une' des deux
artères qui fortent de la bafe du coeurs c’eft le trorre
commun des artères qui fe diftrîbUent & fe ramifient
dans toutes les parties du corps. "
L'aorte naît de la bafe du ventricule gauche,
mais elle ne tient réellement au /coeur que par la
membrane interne de ce ventricule, qui fe prolongé
dans Ton intérieur & y forme trôis valvules
figmoïdes. La membrane ou tunique propre de l'artère
ne fe continue en aucune manière avec les
fibres charnues du coeur, mais elle commence par
trois feftons demi-circulaires , qui correfpondent à
chacune des valvules figmoïdes, & qui làiffent
entr'eux & les fibres charnues un intervalle de deux
ou trois lignes, en forte qu'ils 'donnentnaiffance
à de petits.efpaces triangulaires dans lés endroits
où leurs extrémités fe rapprochent. Un cordon I
ligamenteux borde ces trois fêlions,, qui font atta- I
chés par leur fommet à un anneau tendineux qui
'entoure l'ouverture aortique du ventricule. Les
intervalles triangulaires dont nous avons parlé font
remplis par des portions fibreufes continues à cet
anneau, lequel forme ainfi un tifiu fibreux inter-
A O R
Wédiaire au coeur & à l’artère, & fur lequel les
fibres de l’un & de l'autre, fans fe continuer,
T viennent fe fixer folidemept.
^ Au moment de Ton origine, l’aorte eft cachée
'par l ’artère pulmonaire , qui l’abandonne au bout
.de.quelques lignes, parce que l'aorte fe porte
après fà naiffance en haut & à droite. Bientôt elle
■ ’ remonte au-devant de la colonne vertébrale, en
décrivant une courbure dont la convexité eft à
j droite & en avant, & s'étend jufqu’àu niveau d e ;
la quatrième ou de la troifième vertèbre dorfale :
/e*e!i ià qu'elle fe dégage entièrement de l’intérieur
|-du péricarde pour occuper le milieu de lacolonnê
vertébrale. Alors elle continue à fe recourber, en
|-fe dirigeant un peu en arrière & à gauche pref-
• que tranfverfalement, au niveau de ia fécondé
; vertèbre du dos , & jufqu’au defiïis de la branche
p gauehe de l’artère pulmonaire. G'eft à cette fe-
| conde courbure qu’on donne le nom de Crojfe de
$-1 aorte ( Arc us aorte,y — Courbure fous-fternale ,
iChauss.). Dans les, fujets avancés en âge, elle pré-
I fenté a Ton origine une boflelure quiparoit due au
|-choc du fang, & que certains auteurs ont appelée
I le grand. Sinus de l'aorte. Elle finit fur le côté gau-
; che du corps de la troifième vertèbre du dès. A
i partir de ce point, l'aorte change tout-â-fait de di-
l-rection & devient verticale ; elle defeen d , dans ie
| médiaftin poftérieur, fur la partie dorfale antérieure
I & gauche des autres vertébrés dorfales , parvient
| au diaphragme, s'engage avec le canal thoracique,
■ •»entre fes deux piliers, au moyen d’une ouverture
/ qui lui eft cônfacrée fpécialement, & s’introduit-
| dans 1 abdomen , où elle fe termine , en fe bifur-
» quant, au niveau de la quatrièmevou de la cinquième
vertèbre des lombes. Depuis la fin de la
•fcrolie jufqu'à fa divifion , l'aorte prend le nom
-de dejeendame, & le distingue én aorte pectorale
•ta& en aorte abdominale.
f »ans l'intérieur du pfericârde , l’aorte eft embtaf-
|fee , a gauche & .en arrière , par l’artère pulmo- ■
Braire Si par fa branche: droite. A droite, elle ré-
|pond a la veine Cave füpëriêure & au poumon. En
luevant, le médiaftin laléparedu ftèrnumi
l Dans fa croffe, cette-artère»eft d’abord iiirmé-
rdiatement appliquée fur la trachée-artère , un peu
avant la naillance des bronches, & enfuite furie
[corps des leconde & troifième vertèbres,
f I ant qu’elle refte dans le médiaftin pôftérieur
I aorte eft couchée fur la partie gauche de la
co,onné vertébrale, à gauche de l’oefophagë , du
.canal thoracique & deda veine azygos , couverte
a abord par la naillance des bronches & enfuite
par le péricarde. La plèvre h tapifle fur fon côté
fgauche.
■ Gans;l abdomen, elle correlpond, en arrière, à la
partie anterieure du corps de vertèbres lombaires;
a droite.,' a la veine cave inférieure ; à1 gauche &
-en^devant, au péritoine, à l’ellomac & a l ’inteftin
Aurdeffous. de la croffe, le calibre de cette -
A O R 69
artère eft plus ou moins refierré y il éprouve peu de
variations dans la portion defcendantethoracique,
mais il diminue enfuite fenfiblement dans la portion
abdominale.
L'épaiftèur des parois de l'aorte eft beaucoup
moindre, proportion gardée, que celle de Tes
branches 5 elle eft moins marquée encore au moment
de fon origine que dans la croffe, & , dans
celle-ci, elle eft plus grande à la convexité qu’à la
concavité. Cette épailfeur diminue enfuite par
degrés dans 1 aorte defeendante, fans pourtant
que celle-ci paroiffe perdre de fârénftance dans la
| même proportion. _
La ftruèture de l'aorte eft la même que celle des
autres artères, mais fa membrane externe eft
moins prononcée & moins folïde que dans celles-
c i, & cela d autant plus qu'on la confidère plus
près de fon origine, laquelle eft fortifiée d'ailleurs
par le feuillet fibrëûx du péricarde qui l'accompagne
jufqu'à une-certaine diflance & fe perd
fur elle. . ' *' • r
Outre une foule de ramufcules très ténus, d’ar-
.térioles très-fines, qui fortent de l'aorte dans prefque
tout fon trajet, & qui vont fe perdre pref-
qu'aufiïtôt dans les parois de l'artère elle même
dans- le tiffu cèliulaire , dans les ganglions lymphatiques
& dans les| vaïffeaux voifins , cette artère
fournit un grand nombre de branches qui méritent
une défeription' particulière.
1 . Dès fon origine & au-deffus du bord libre
™ valvules figmoïdes , l’aorté donne naiffance
aux deux ancres coronaires ou cardiaques antérieure
& pofténeure. VoycX C audiaque & CoKOBiiRET '
2l; De la convexité de: fa crollé , naiffent le
tronc ‘brachio-céphalique qu’ on a auffi appelé artère
innommée, la carotide & la fous-claviire eau-
■ chescr"''- ‘ : ■ • •, ' 6 '
3°. D e l’aortedefcenclanté thoraciqué, viennent
les attires bronchiques , efophagiennes, mèdiafiines
pojierieutes &cinicïcoftàUs inférieures.
4 . De 1 aorte. abdominale , fortent les diaphragmatiques
.inférieures , le tronc. caliaque, les
.deux mcj'entériques fupèrieure & inférieure les cap-
Juiaires , les émulgentes , les fpermaüques , lès loin-
baires, ■ •
. L9- Enfin, cette; artère fe termine par trois
branches , la facrée moyenne au milieu , Se les
iliaques communes ou primitives latéralement.
Dans le foetus, l’aorte, félon le profefleur
Bec lard , paroït fe former avant le coeur Se après
le fyftème de la veine-porte , auquel elle' eft
alors bee par un renflement qui eft le rudiment du
coeur. Plus tard & pendant tout le refte d e là vie
intra-utérine , elle communique, peu après fon
origine , avec l’artère pulmonaire par le canal artériel
que lui envoie celle-ci & qui s’ oblitère après
la naillance- b'oyct C anal aut ehie i,.
Dans le; foetus auffi , la croffe de l’aorte eft
moins prononcée que chez les adultes ; elle eit éga