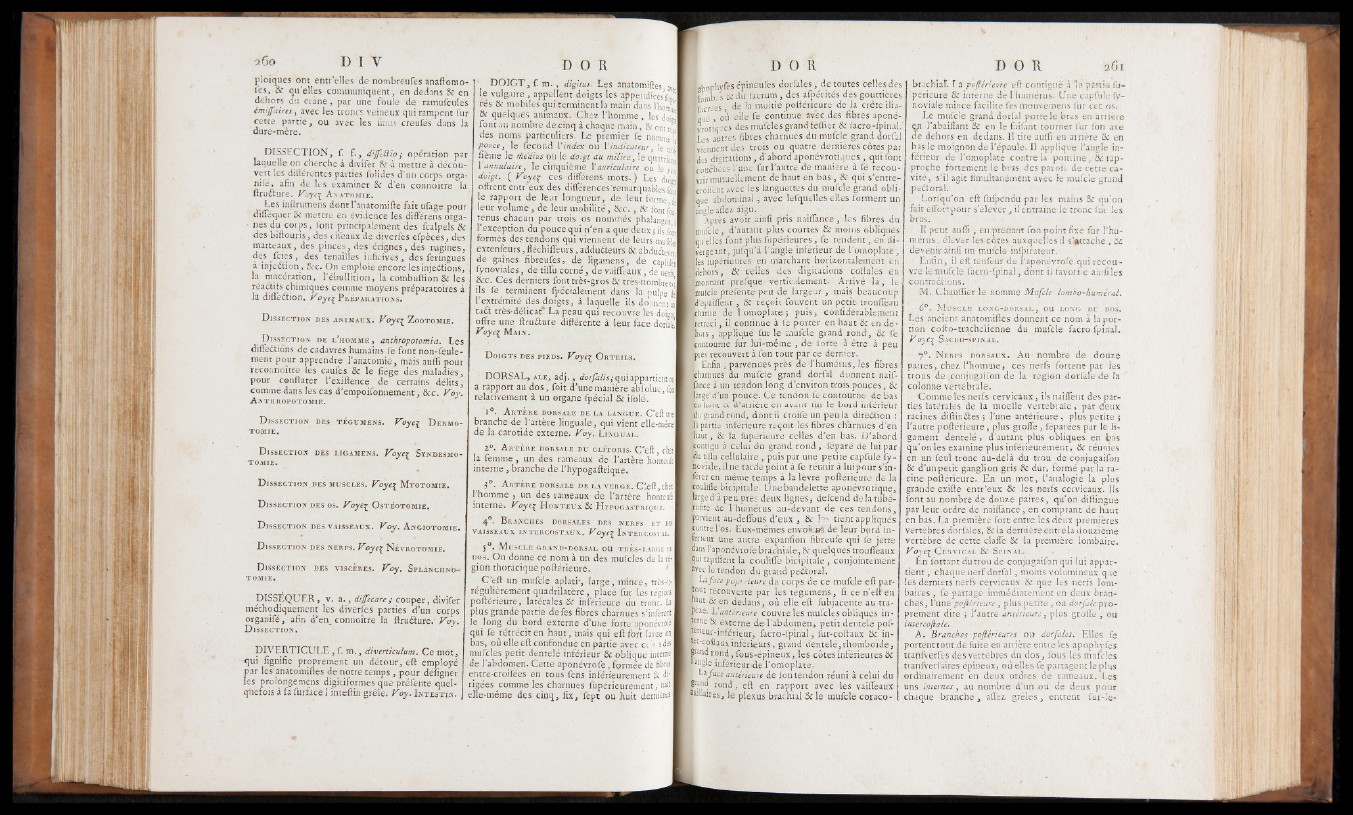
ploïques ont entr;’elles de nombreufes anaftomo-
ie s , & qu'elles communiquent, en dedans & en
dehors du crâne, par une foule de ramufcules
émijfaires, avec les troncs veineux qui rampent fur
cette partie, ou avec les finus creufés dans la
dure-mère.
DISSECTION, f. f . , dijfeftioy opération par
laquelle on cherche à divifer & à mettre à découvert
les différentes parties folides d'un corps orgar
nifé, afin de les examiner & d'en connoître la
ftruéture. Vaye£ Anatomie.
Les inftrumens dont l’anatomifte fait ufage pour
difféquer & mettre en évidence les différens orga-
' nés du corps, font principalement des fcalpels &
des biftouris, des cileaux de diverfes efpèçès, des
marteaux, des pinces, desérignes, des rugines,
des fc ie s , des tenailles inficives, des feringues
à injeétion, &c. On emploie encore les injections,
la macération, l’ébullition, la combuftion & les
réaétifs chimiques comme moyens préparatoires à
la diffeétion. Voye[ Préparations.
Dissection des animaux. Voye^ Zootomie.
Dissection de l’homme, antkropotomia. Les
difièCtions de cadavres humains fe font non-feulement
pour apprendre l'anatomie, mais auffi pour i
reconnoître les caufes & le fiége des ,maladies, :
pour c^nftater l’ ëxiftence de certains délits,
comme dans les cas d’ empoifonnement, & c . Voy.
A n thropotomie.
Dissection des tégumens. Voyei Dermo-
TOM IE .
Dissection des ligamens. Voye^ Syndesmotomie.
Dissection.des muscles. Voye[ Myotomie.
Dissection des os. Voye[ Ostéotomie.
Dissection des vaisseaux. Voy. Angiotomie.
Dissection des nerfs. Voye^ Névrotomie.
Dissection des ' viscères. Voy. Splanchnotomie.
DISSÉQUER, v. a . , dijfecarey couper, divifer
méthodiquement les diverfes parties dsun corps
organifé, afin d’en, connoître la ftru&ure.- Voy.
Dissection.
D IV ER T ICU L E , f. m., diverticulum. Ce mot,
qui lignifie proprement un détour, eft employé
par les anatomiftes de notre temps, pour défigner
les prolongemens digitiformes que préfente,quelquefois
à fa furface i inteftih grêle. Voy. Intestin. 3
D O IG T , f. m ., digitus. Les anatomiftes, w,
le vulgaire , appellent doigts les appendices %
rés & mobiles qui terminent la main dans l’homme
& quelques animaux. Chez l’homme, les do2
font au nombre de cinq à chaque main, & outrer
des noms particuliers. Le premier fe nomme 1
pouce, le fecOnd Y index ou l’indicateur 3 1 e tr ■
fième le médius on 1 e doigt du milieu, le quatrième
X annulaire, le cinquième Y auriculaire ou le pe!j
doigt. ( Voyeç ces différens mots.) Les doim
offrent entr’eux des différences'remarquablesfous
le rapport de teur longueur, de leur forme, de
leur volume, de leur mobilité, & c . , & font fou.
tenus chacun par trois os nommés phalanges 1
l’exception du pouce qui n’en a que deux} ils fo’m
formés des tendons qui viennent de leurs mufcles
extenfeurs, fléchiffeurs, adduéteurs & abduâeurs-
de gaînes fibreufes, de ligamens, de capfulej
fynoviales, de tiffu corné, de vaiffeaux, de nerfs
&c. Ces derniers font très-gros & très-nombreux’:
ils fe terminent fpécialement dans la pulpe dè!
l'extrémité des doigts, à laquelle ils donnent un
taét très-délicat* La peau qui recouvre les doigts
offre une ftruéture différente à leur face dorfale!
Voye^ Main.
Doigts des pieds. Voyè[ Orteils.
DORSAL, a l e , ad j., do rfali s j qui appartient ou
a rapport au dos v foit d’une manière abfôluç, foit
relativement à un organe fpëcial & ifolé.
i°. Artère dorsale de la langue. C’eftune
branche de l'artère linguale, qui vient elle-même
de la carotide externe. Voy. Lingual.
2 °. Artère dorsale du clitoris. O’eft, cher
la femme, un des rameaux de l’artère honteufe
interne, branche de l'hypogaffrique.
3°. A rtère dorsale de la verge. C ’,eft, chez
l'homme , un des rameaux de l'artère honteufe
interne-. Voyef Honteux & Hypogastrique.
4 °- B ranches dorsales des nerfs et des
vaisseaux in ter co st au x . Voye% I ntercostal.
5°* M uscle grand-dorsal ou tr è s -large du
dos. On donne ce nom à un des mufcles de la région
thoracique poftérieure.
C'eft un mufcle aplati*, large, mince, très-irrégulièrement
quadrilatère, placé fur les régions
.poftérieure, latérales & inférieure du tronc. U
plus grande partie defes fibres charnues s’infèrent
le long du bord externe d'une forte aponévrofe.
qui fe rétrécit en haut, mais qui eft fort large en
bas, où elle eft confondue en partie avec et * s des
mufcles petit dentelé inférieur & oblique interne
de l'abdomen. Cette aponévrofe, formée de fibres
entre-croifées en tous fens inférieurement & dirigées
comme les charnues fupérieurement, naît
elle-même des cinq, fix, fept ou huit dernières
D O R
Lbophyfés épineufes' dorfales, de toutes celles des
['lombes & du facrum, des afpérités des gouttières
Ifacrees, de la moitié poftérieure de la crête ilia-
E t ié , où elle fe continue avec des fibres àponé-
I vrotiq-^es des mufcles grand feffier & facro-lpinal.'
■ Les autres fibres charnues du mufcle grand dorfal
|viennent des trois ou quatre dernières côtes par
Ides digitations, d’abord aponévrotiques , qui font
Icoucbées l’une fur l’autre de manière à fe recou-
Ivrir mutuellement de haut en bas , & qui s’entre-
Icroifent avec les languettes-du mufcle grand obli-
fque abdominalavec lefquelles elles forment un
■ angle affez aigu. / v _ ■
I Après avoir .ainfi pris naiffance, les fibres du
■ mufcle, d’autant plus courtes & moins obliques
| qu’e lle s font plus fupérieures, fe ren d en ten di-
[vergeantj jufqu’à l'angle inférieur.de l'omoplate,
les fupérieures en m'archant horizontalement e n .
llehors, & celles des digitations coftales en
| m o n t a n t prefque verticalement. Arriv é-là, ie :
Imufcie préfente peu de largeur , mais beaucoup
jd'épaiffeur, & reçoit fouverit un petit trouffeau
Kharnu'de l ’omoplate j puis3 confidérablement
■ rétréci, il, continue à fe porter en haut & en de-
liors, appliqué: fur le mufcle grand rond, & fe
■ contourne fur lui-même , de. lorte à être à peu
près recouvert à.fon tour par ce dernier.
I Enfin , parvenues près ded’humérus, les fibres-
fcharnues au mufcle grand dorfal donnent naif-
Hance à un tendon long d'environ trois pouces, &
Barge” d’un pouce. Ce tendon fe contourne de bas
[en haut 6c d’arrière en avant lur le bord inférieur
[du grand rond, dont il croife un peu la direction :
Ba partie inférieure reçoit les fibres charnues d'en
i;haut, & la fupérieure celles d’en bas. D’abord
pntigu à celui du grand, rond , féparé de lui par
Jlu tiifu cellulaire, puis par une petite capfule fy-
poviale,ilne tarde point à fe réunir à lui pour s’insérer
en même temps à là lèvre poftérieure de la
Couliffe bicipitale. Unebandelette aponévrotique,
Barge d’à peu près deux lignes, defeend delà tubé-
lofite de l'humérus au-devant de ces tendons,
parvient au-deffous d’eux , & !as tient appliqués
contre l’os. Eux-mêmes envolurti de leur bord inferieur
une autre expanfion fibreufe qui fe jette
©ans l’aponévrofe brachiale, & quelques trouffeaux
pui tapilïènt la couliffe bicipitale, conjointement
ravec le tendon du grand peéloral.
■ La face pojy rieure du corps de ce mufcle eft partout
recouverte par les tégumens , fi ce n’eft en
ijaut & en dedans, où elle eft fubjacente au-tra-
XIantérieure couvre les mufcles obliques in terne
& externe de l'abdomen, petit dentelé pof-
Berieur-inférieuri facro-fpinal, fur-coftaux & in-
K^-coftauxinférieurs, grand dentelé,rhomboïde,
grand rond, fous-épineux, les côtes inférieures &
.-. angle inférieur de l’omoplate.
■ La face antérieure de ion tendon réuni à celui du
grand rond, eft en rapport avec les vaiffeaux
pillaires, le plexus brachial & le mufcle coraco-
D O R 261
brachiaf. T a poftérieure eft contiguë à la partis fupérieure
& interne de l'humérus. Une capfule fv~
noviàle mince facilite fes mou ve me ns fur cet os.
Le mufcle grand dorfal porte le bras en arrière
ep l’abaiffant & en lefaiiïint tourner fur fon axe
ae dehors en dedans. Il tire auffi en arrière & en
bas le moignon de l’épaule. Il applique l’angle inférieur
de l’omoplate contre la poitrine, & rapproche
fortement le bras des parois de cetre cav
ité, s’il agit fi'multanément avec le mufcle grand
pedoral. .
Lorfqu’ôn eft fufpéndu par les mains & qu’on
fait effort pour s’éleve r, il entraîne le tronc fur les
bras.
Il peut auffi, en prenant fon point fixe far l’humérus
, élever les côtes auxquelles il s’attache , &:
devenir ainfi un mufcle infpirateur.
Enfin, il eft tenfeur de l 'aponévrofe qui recouvré
le mufcle facro-fpinal 3 dont il favorise ainfi les
contra étions.
M. Chauffer le nomme Mufcle lombo-huméral.
. 6°, Muscle long-dorsal, ou long du dos.
Les anciens anatomiftes donnent ce nom à la portion
cofto-trachelienne du mufcle facro-fpinal.
Voye[ Sacro-spinal.
7°. Nerfs dorsaux. A u nombre de douze
paires, chez l’homme, ces nerfs fortene par les
trous de conjugaifon de la région dorfale de la
colonne vertébrale.
Comme les nerfs cervicaux, ils naiffent des parties
latérales de la moelle vertébrale, par deux
racines diftinétes ; l ’une antérieure, plus pétite 5
l’autre poftérieure, plus groffe , féparées par le ligament
dentelé, d’autant plus obliques en bas
qu’ on les examine plus inférieurement, & réunies
en un feul tronc au-delà du trou de conjugaifon
& d’un petit ganglion gris & dur, formé parla racine
poftérieure.. En un mot, l’ analogie la plus
grande exifte entr’eux & les nerfs cervicaux. Ils
font au nombre de douze paires, qu’on diftingue
par leur ordre de naiffance, en comptant de haut
en bas. La première fort entre les deux premières
vertèbres dorfales, & la dernière entrela douzième
vertèbre de cette claffe & la première lombaire.
Voyez C er v ica l & S p in a l .
En fortant du trou de conjugaifon qui lui appartient
, chaque nerf dorfal, moins volumineux que
les derniers nerfs cervicaux & que les nerfs lombaires
, fe partage- immédiatement en deux branches,
l ’une poftérieure, plus petite, ou dorfale proprement
dire 5 l’autre antérieure3 plus groffe, ou
intercoftale.
A . Branches poftérieures ou dorfales. Elles, fe
portenttout.de fuite en arrière entre les apophyfes
tranfverfes des vertèbres du dos, fous les mufcles
tranfverfaires- épineux, où elles fe partagent le plus
ordinairement en deux ordres de rameaux. Les
uns internes, au nombre d’un ou de deux pour
chaque branche, aflèz grêles, entrent fur-le