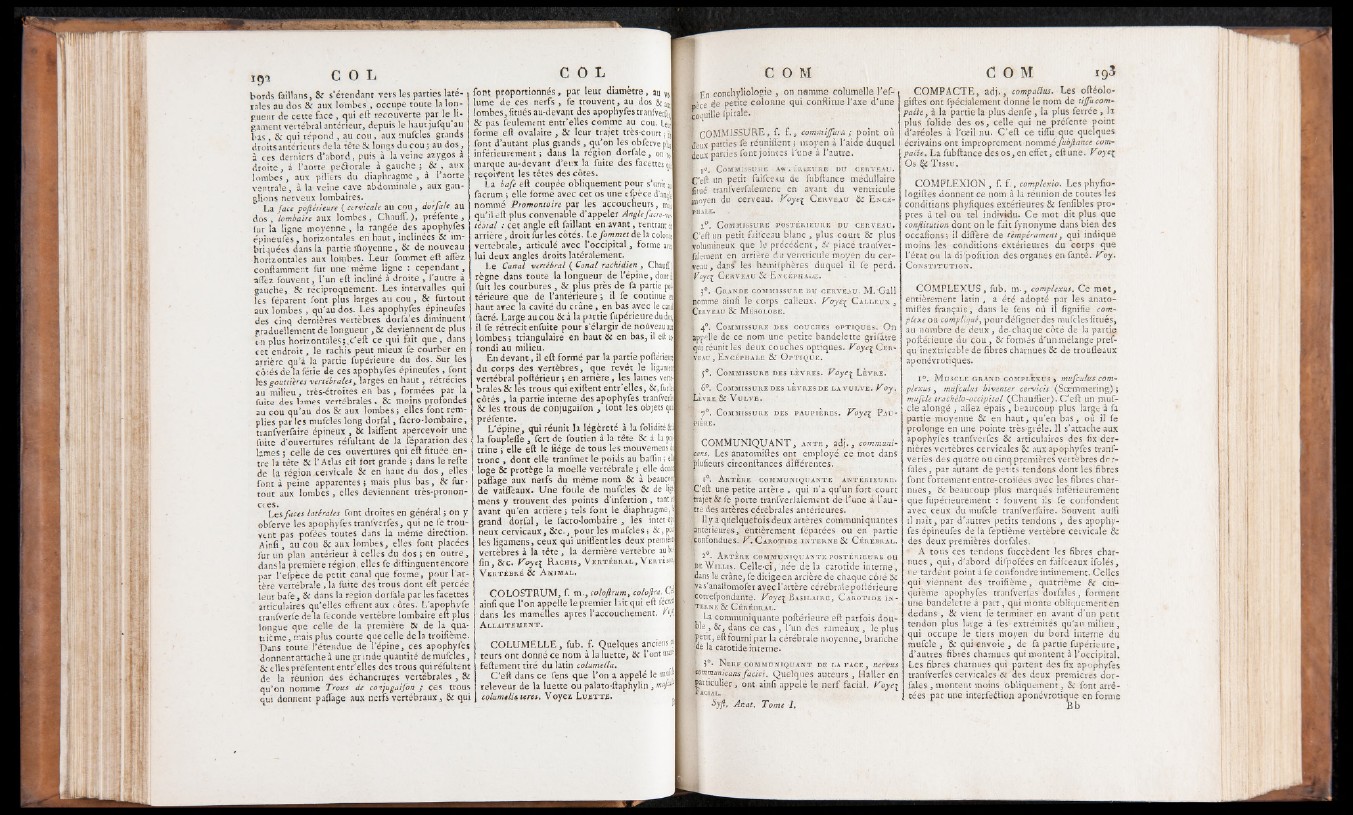
bords faillanSj & s’étendant vers les parties latérales
au dos & aux lombes, occupe toute la longueur
de cette fa c e , oui eft recouverte pnr le lï-
gament vertébral antérieur, depuis le haut jufcju au
b a s , & oui répond , au cou , aux mufcles grands
droits antérieurs de la tête & longs du cou ; au dos,
à ces derniers d'abord, puis à la veine azygos à
droite, à l'aorte peélorale à gauche; & , aux
lombes, aux piliers du diaphragme, à l'aorte
ventrale, à la veine cave abdominale , aux ganglions
nerveux lombaires.
La face pofiéricure ( cervicale au cou, dorfale au
dos , lombaire aux lombes, Chauff.)» prefente,
fur la ligne moyenne, la rangée des apophyfes
épineufes, horizontales en haut, inclinées & imbriquées
dans la partie moyenne, & de nouveau
horizontales aux lombes. Leur fommet eft affez
conftamment fur une même ligne : cependant,
alfez fouvent, l'un eft incliné à droite , l'autre à
gauche, & réciproquement. Les intervalles qui
les féparent font plus larges au c o u , & furtout
aux lombes , qu’ au dos. Les apophyfes épineufes
des cinq dernières vertèbres dorfales diminuent
graduellement de longueur, & deviennent de plus
en plus horizontales;.c'eft ce qui fait que, dans
cet endroit, le rachis peut mieux fe courber en
arrière qu'à la partie fupérieure du dos. Sur les
côtés de la férié de ces apophyfes épineufes , font
les gouttières vertébrales, larges en haut, rétrécies
au milieu, très-étroites en b as , formées par la
fuite des lames vertébrales, & moins profondes
au cou qu’ au dos & aux lombes; elles font remplies
par les mufcles long dorfal, facro-lombaire,
tranfverfaire épineux , & laiffent apercevoir une
fuite d'ouvertures réfultant de la féparation des
lames ; celle de ces ouvertures qui eft fituée entre
la tête & l’ Atlas eft fort grande ; dans le refte
de la région cervicale & en haut du dos , elles
font à peine apparentes ; mais plus bas, & fur -
tout aux lombes, elles deviennent très-pronon-
cces.
Les faces latérales font droites en général ; on y
obferve les apophyfes tranfverfes. qui ne fe trouvent
pas pofées toutes dans la même direction.
Ainfi, au cou & aux lombes, elles font placées
fur un plan antérieur à celles du dos ; en outre,
dansla première région, elles fe diftinguentencore
par l'efpèce de petit canal que forme, pour l ’artère
vertébrale, la fuite des trous dont eft percée
leur bafe, & dans la région dorfale par les facettes
articulaires qu’elles offrent aux côtes. L'apophyfe
tranfverfe de la fécondé vertèbre lombaire eft plus
longue que celle de la première 8t de la quatrième,
mais plus courte que'celle delà troifième.
Dans toute l’ étendue de l’épine, ces apophyfes
donnent attache à une gr tnde quantité de mufcles,
& elles préfentent entr’elles des trous qui réfultent
de la réunion des échancrures vertébrales , &
qu’on nomme Trous de co-tjugaifon ; ces trous
qui donnent paffage aux nerfs vertébraux, 8c qui
C O L
font proportionnés, par leur diamètre, au %
lume de ces nerfs , fe trouvent, au dos & a«
lombes, fitués au-devant des apophyfes tranfverfet
& pas feulement entr'elles comme au cou. Leu;
forme eft ovalaire , & leur trajet très-court ; j
font d’autant plus grands , qu'on les obferve plUI
inférieurement ; dans la région dorfale, on f
marque au-devant d’eux ja fuite des facettes^
reçoivent les têtes des côtes.
La bafe eft coupée obliquement pour s’unit au
facrum ; elle forme avec cet os une efpèce d’angle
nommé Promontoire par les accoucheurs, mais
qu’ il eft plus convenable d’appeler Angle ficro-v«.
té in al : çet angle eft raillant en avant, rentrant en
arrière, droit furies côtés. Le fommet delà colonne
vertébrale, articulé avec l’oc c ip ita lforme avec
lui deux angles droits latéralement.
Le Canal vertébral ( Canal rachidien , Chauff.)
règne dans toute la longueur de l’épine, dont il
fuit les courbures, & plus près de fa partie po(-
térieure que de l’antérieure > il fe continue en
haut avec la cavité du crâne, en bas avec le canil
facré. Large au cou & à la partie fupérieure du dos,
il fe rétrécit enfuite pour s’élargir de noûyeauaui
lombes î triangulaire en haut 8c en bas, il eft arrondi
au milieu.
En devant, il eft formé par la partie poftérieure
du corps des vertèbres, que revêt le ligamèoi
vertébral poftérieur 5 en arrière, les lames vertébrales
& les trous qui exiftent entr’elles, &,furlei
côtés , la, partie interne des apophyfes tranfverfes
8c les trous de conjugaifon , font les objets qui
préfente.
L’ épine, qui réunit la légèreté à la folidité&i
la foupleffe, fert de foutien à la tête 8c à la poitrine
ï elle eft le fiége de tous les mouvemens k
tronc , dont elle tranfmet le poids au badin ; élit
loge 8c protège la moelle vertébrale j elle donne
paffage aux nerfs du même nom 8c à beaucoi!|
de vaiffeaux. Une foule de mufcles 8c de lig*
mens y trouvent des points d’infertion , tant ei
avant qu'en arrière ; tels font le diaphragme,If
grand dorfal, le facro-lombaire , les inter épi
neux cervicaux, 8cc-, pour les mufcles> & ,pool
les ligamens, ceux qui uniffentles deux premier«
vertèbres à là tê te , la dernière vertèbre au bi
lin, 8cc. Voye\ Rachis, V e r t é b r a l , V ertebiU)
V ertébré 8c A nim al»
COLOSTRUM, f. m-, coloftrum, coloJlra. C&
ainfi que l’ on appelle le premier lait qui eft fécreu
dans les mamelles après l'accouchement.
A l l a it em e n t .
COLUM E L LE , fub. f. Quelques anciens *
teurs ont donné ce nom à la luette, 8c l’ont main*
feftement tiré du latin columella.
C ’eft dans ce fejis que l’on a appelé le nijjn
reîeveur de la luette ou palato-ftaphylin, m r
cçlumtlid. ures. Voyez Luette. f
É g n conchyliologie , on namme columelle re fl
u e petite colonne qui conftitue l’axe d’ une
poquille i’pirale.
I COMMISSURE, f. f . , commijfurà ; point où
®eux parties fe réunifient ; moyen à l’aide duquel
lieux parties font jointes l'un« à l’autre.
■ 1°. C ommissure a« x ürleure du cerveau.
C’eft un petit faifceiu de fubftance médullaire
fetué tranfverlaîemenc en avant du ventricule
inoyen du cerveau. Ifoye-^ C erveau 8c E ncéphale.
•>
B 20. C ommissure postérieure du cerveau.
iC’eft un petit raifceau blanc , plus court 8c plus
Volumineux que le précédent, 8c piacé tranfver-
îaîement en arrière du ventricule moyen du cerceau
, dans* les hémifphères duquel il fe perd.
wfoyez C erveau & E ncéphals.
K 30. G rande commissure bu cerveau . M. Gall
{nomme ainfi le corps calleux. Voyeç C alleux ,
C erveau 8c M ésolobe.
K 40. C ommissure des couches o pt iq ues. On
appelle de ce nom une petite bandelette grifâtre
«qui réunit les deux couches optiques. Voye£ Cer-
weau:., Encéphale 8c O p t iq u e .
k j°. C ommissure des lè vres. Voye£ L è v r e .
■ 6°. C ommissure des lèvres de la v u l v e . Voy.
■ Lèvre. 8c V ulve .
I 70. C ommissure des paupières. Voye% Pau pière.
I COMMUNIQUANT, a n t e , ad;., commuai-
uans. Les anatomiftes ont employé, ce mot dans
gilufieurs circonftances différentes.
i i°‘. A rtère communiquante an t ér ieu r e .
C’eft une petite artère , qui n’ a qu’un fort court
trajet 8c fe porte tranfverfalement de Pune à l’au-
Jtre des artères cérébrales antérieures.
K Ily à quelquefois deux artères communiquantes
intérieures, entièrement féparées ou en partie
confondues. V, C arotide in tern e 8c C érébral.
B 2°. Artère communiquante postérieure ou
;§>e W illis. Celle-ci, née de la carotide interne,
,;dans le crâne, fedirigeen arrière de chaque côté 8c
|va s’analtomofer avec l'artère cérébrale poftérieure
Icorrefpondante. Voye% Basilaire, C arotide în -
|terne 8c C érébral.
B La communiquante poftérieure eft parfois dou-
J p e , 8c, dans ce c a s , l ’un des rameaux, le plus
petit, eft fourni par la cérébrale moyenne, branche
kde la carotide interne.
B 3°- Nerf communiquant de la f a c e , nervus
vommunicans faciei. Quelques auteurs , Haller en
.particulier, ont ainfi appelé le nerf facial. Voyez
I acial.
I Syji, Anat. Tome I,
C OM P A C T E , ad ;., comparus. Les oftéolo-
giftes ont fpécialement donné le nom de tijfu compare
y à la partie la plus denfe, la plus ferrée ,
plus folide des o s , celle qui ne préfenre point
d’aréoles à l’oe il nu. C ’eft ce tiffu que quelques
écrivains ont improprement nommé Jubfiance compare.
La fubftance des o s , en effet, eft une. Voyeç
Os T issu,
COMPLEXION , f. f ., complexio. Les phyfio-
logiftes donnent ce nom à la réunion de toutes les
conditions phyfiques extérieures 8c fenfibles propres
à tel ou tel individu. C e mot dit plus que
conftitution dont on le fait fynonyme dans bien des
occafîons; il diffère de tempérament, qui indique
moins les conditions extérieures du corps que
l'état ou la difpofîtion des organes en fanté. Voy.
! C o n st itu t io n .
COMP LEXUS, fub. m., complexus. C e met,
entièrement latin , a été adopté par les anato-
miftès français, dans le Cens où il fignifie complexées
compliqué, pour défigner des mufcles fitués,
au nombre de deux, de-chaque côté de la partie
poftérieure du c o u , 8cformés d’unmélange pref-
qu'inextricablede fibres charnues 8c de troufieaux
aponévrotiques.
i° . M uscle grand com plexu s, mufculus. corn-
plexus , mùfculus biventer cervicis (Soemmering) ;
mufcle trachélo-occipital (Chauflier). C ’eft un muf-
cle alongé , affèz épais , beaucoup plus large à fa
partie moyenne 8c en haut, qu'en bas, où il fe
prolonge en une pointe très-grêle. Il s’attache aux
apophyfes tranfverfes 8c articulaires des fix dernières
vertèbres cervicales 8c aux apophyfes tranfverfes
des quatre ou cinq premières vertèbres der-
fales, par autant de petits tendons dont les fibres
font fortement entre-croifées avec les fibres charnues,
8c beaucoup plus marqués inférieurement
que fupérieurement : fouvent ils fe confondent
avec ceux du mufcle tranfverfaire. Souvent aufli
il naît, par d’ autres petits tendons , des apophyfes
épineufes de la feptième vertèbre cervicale 8c
des deux premières dorfales.
I A tous ces tendons fuccèdent les fibres charnues
, qui, d’abord difpofées en faifeeaux ifolés,
ne tardent point à fe confondre intimement. Celles
qui viennent des troifième, quatrième 8c cinquième
apophyfes tranfverfes dorfales, forment
une bandelette à part, qui monte obliquement en
dedans , 8c vient fe terminer en avant d’un petit
tendon plus large à fes extrémités qu'au milieu,
qui occupe le tiers moyen du bord interne du
mufcle , 8c qui envoie , de fa partie fupérieure,
d’ autres fibres charnues qui montent à l’occipital.
Les fibres charnues qui partent des fix apophyfes
tranfverfes cervicales 61 des deux premières dorfales
, montent moins obliquement, 8c font arrêtées
par une interfeêUoji aponévrotique en forme