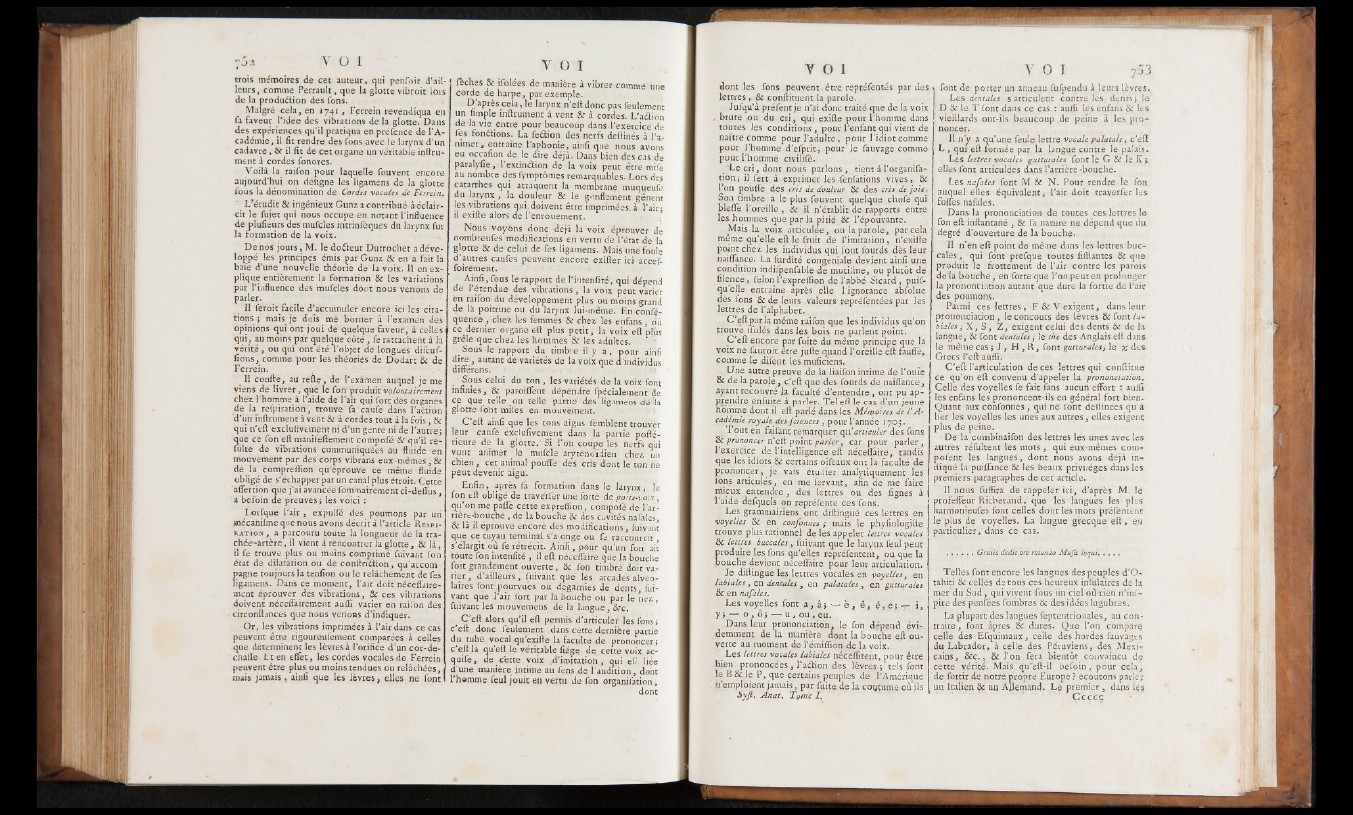
75a V O I
trois mémoires de cet auteur, qui penfoit d'ailleurs,
comme Perrault, que la glotte vibroit lors
de la production des Tons.
Malgré cela, en 17 4 1 , Ferrein revendiqua en
fa faveur l'idée des vibrations de la glotte. Dans
des expériences qu'il pratiqua en préfence de l'A cadémie,
il fit rendre des fons avec le larynx d'un
cadavre, & il fit de cet organe un véritable inftru-
ment à cordes fonores.
Voilà la raifon pour laquelle fouvent encore
aujourd'hui on déligne les ligamens de la glotte
foiis la dénomination de Cordes vocales de Fer rein.
' L’érudit 8c ingénieux Gunz a contribué à éclaircir
le fujet qui nous occupe en notant l’influence
de plufieùrs des mufcles intrinfèques du larynx fur
la formation de la voix.
De hós'jours, M. le doCteur Dutrochet a développé
les principes émis par Gunz & en a fait là
baie d'une nouvelle théorie de la voix. Il en explique
entièrement la formation & les variations
par l'influence des mufcles dont nous venons de
parler.
Il ferôit facile d'accumuler encore ici les citations
i mais je dois me borner à Pexamen des
opinions qui ont joui de quelque faveur, à celles
qui, au moins par quelque côté, fe rattachent à la
vérit.é, ou qui ont été l'objet de longues difeuf-
fions, comme pour les théories de Dodart & de
Ferrein.
Il confie, au rèfte, de l'examen auquel je me
viens de livrer, que le fon produit volontairement
chez l'homme à l’ aide de l’air qui fort dès organes
de la refpiration, trouve fa caufe dans l’action
d'ijhr infiniment à vent & à cordes tout à la fois, &
qui n'eft excluliveméhtni d'un genre ni de l'autre}
que cè l’on eft manifeftement compofé Sc qu’il ré-
fuite de vibrations communiquées au fluide en
mouvement par des corps vibrans eux-mêmes , 8c
dè la compreflion qu’éprouve ce même fluide
obligé de s’échapper par un canal plus étroit. Cette
nffertion que j’ai avancée fomrnairemèntci-deffusi
a befoin de preuves j les voici :
Lorfque l ’a ir , expulfé des poumons par un
mécanilme que nous avons décrit à l’article Respiration,
a parcouru toute la longueur de la trachée
artère, il vient à rencontrer la glqtte, 8c là,
il fe trouve plus ou moins comprimé fuivant fon
état de dilatation ou dé conftriâion, qu'accompagne
toujours la tenfion ou le relâchement de fes
ligamens. Dans ce moment, l’air doit néceffaire-
ment éprouver des vibrations, & ces vibrations
doivent nécefîairèment aufli varier en raifon des
circonftances que nous venons d’indiquer.
Or, les vibrations imprimées à l’air dans ce cas
peuvent être rigoureufement comparées à celles
que déterminent les lèvres à l’orifice d’un cor-de-
chaflè. Eten effet, les cordes vocales de Ferrein
peuvent être plus ou moins tendues ou relâchées,
mais jamais, ainfi que les lèvres, elles ne font
v 0 1
ftches & ifoiées de manière à vibrer comme une
corde de harpe, par exemple.
D'après cela, le.larynx n'eft.donc pas feulement
un fimple inftrument à vent & à cordes. L'aâion
de la vie entré pour beaucoup dans.l'exercice de
fes fonctions. La fedtion des nerfs deflinés à l'animer.,
entraîne 1,'aphonie, ainfi que nous avons
eu occafion de le dire déjà. Dans bien descas de
paralyfie , :1 extinéiion de la voix peut être mife
au nombre des fymptômes remarquables..Lors des
catarrhes qui attaquent la membrane muqiieufe
du larynx , la douleur & le gonflement gênenc
les .vibrations, qui, doivent être, imprimées, à l'air ;
il exifte alors de l'enrouement.
Nôus-Voÿbns donc déjà la voix éprouver de
nombreufes modifications en vertu de l'état de la
glotte &-de celui de fes ligamens. Mais une foule
d'autres caufes peuvent encore exifter ici accefi-
foirèment.
Ainfi, fous le rapport de Tintenfité, qui dépend
de l'étendue des vibrations, la voix peut varier
en raifon-du développement plus ou moins grarid
de là poitrine ou du larynx lui-même. En confé;-
quénee ,- chez les femmes & chez les enfans, ou
1 ce dernier organe eft plus petit, la voix eft plus
grêle que chez lés hommes & les adultes. -
Sous-le rapport du timbre il y a , pour ainfi
dire, autant de variétés de la voix que d'individus
différens.
Sous celui du ton , les variétés de la vdix font
infinies, & paraiffent dépendre fpécialement de
ce que telle ou telle partie des ligamens dé ta
glotte font rnifes -en- mouvement.
■ C'eft ainfi que les tons aigus fêmblent trouvée
leur cailfe éxelufivement dans la partie: poffl-
rieüre de la glotte.' Si i’dti coupe les fierfs qui
Vont animer le mufcle aryténoïdien chez un
chien, cet animal pouffe des cris dont le ton ne
peut devenir aigu.
Enfin, après fa formation'dans le larynx, fe
fon eft obligé de travéirfer une forte de porte-voix,
qu'on me palfe cette expreflïon, compofé de l'ar-
rière-boüche, de la bouche & des cavités nafales,
& là il éprouve encore des modifications, fuivant
que ce tuyau terminal s'aionge ou fe raccourcit,
s'élargit'où fe rétrécit. Âirifi, pbur qu'un fon ait
touteTon intenfitë, il eft néceffairè que la bouche
foit grandement ouverte, & fon timbre doit varier,
d'ailleurs, fuivant que les arcades alvéolaires
font pourvues ou dégarnies de dents, fui-
vajit que l'air fort par la bouche ou par le nez ,
fuivant les mouvemens de la langue, &c.
C'eft alors qu'il eft permis'd'articuler fes fons;
c'eft donc feulement dans cette dernière partie
du tube, vocal qu'exifte la faculté de prononcer ;
c ’eft là qu’eft le véritable fiége de. cette voix ac-
quife,, de ç'erte voix .d’ imitation, qui eft liée
d'une manière intime au fens de l'audition, dont
l'homme feui jouit en vertu de fon ôrganifation,
dont
T O I V O I
dont les fons peuvent < être, reprérentés par des
lettres, 8c conftituent la parole.
Jufqu’à préfent je n’ai donc traité que de la voix
, brute ou du c r i, qui exifte pour l'homme dans
to'utes les conditions, pour l'enfant qui vient de
naître comme pour l’adulte, pour l'idiot comme
pour l ’homme d’elpri.t, pour le fauvage comme
pour l’homme çiyilifé.
"Le cri, dont nous parlons, tient à I’organifa-
tionj il fert à exprimer les-fenfations vives, 8c
l’on poufle des cris de douleur & des cris dejoie.
Son timbre a le plus fouvent quelque chofe qui
blefie l’oreille , 8c il n’établit de rapports* entre
les hommes que par la pitié ,8c l'épouvante.
Mais la voix articulée, ou la parole, par cela
meme qu'elle eft le fruit de l’imitation, n'exifte ,
point chez les individus qui fontLourds dès leur
naiflance. La furdité congéniale .devient ainfi une
condition indifpenfable de mutifme, ou plutôt de
filence, félon l’expreflion de l’abbé Sicard, puisqu'elle
entraîne après elle l ’ignorance abfolue
des fons 8c de leurs valeurs repréfentées par les
lettres de l’alphabet.
C ’ çft par la même raifon que les individus qu’on
prouve, ifojes dans les bois ne parlent point.
C'eft encore par fuite du même principe que la
voix ne fauroit être jufte quand l’oreille eft faufle,
comme le difent les muficiens.
Une autre preuve de la liaifon intime de l’ouïe
& de la parole, c’eft que des fourds de naiflance,
ayant recouvré la faculté d’entendre, ont pu ap-
Pf.enc^re enfuite à parler. Tel eft,le cas d’un jeune
homme dont ,il eft parlé dans les Mémoires de l'A cademie
royale des feiences , pour l’année 1703.
Tout en faifant remarquer qu‘ articuler des fons
8c prononcer n’eft point parler3 car pour parler,
l ’exercice de l'intelligence-eft néçeffaire, tandis
que les idiots & certains oifeaux ont la faculté de
prononcer, je vais étudier analytiquement les
Ions articulés, en me fer vaut, afin de me faire
mieux entendre, des lettres ou des lignes à
1 aide defquels on repréfente ces fons.
Les grammairiens ont diftingué ces lettres en
voyelles 8c en çonfonnes } mais le pvhyfiologifte
trouve plus rationnel' de les appeler lettres vocales
& lettres buccales, fuivant que le larynx feul peut
produire les fons qu’elles repréfentent, ou que la
bouche devient nécelfaire pour leur articulation*
Je diftingué les lettres vocales en voyelles, en
labial.es , en dentales 3 en palatales , en gutturales
& en nafales.
Les voyelles font a , â} ^ è , ê , é ,£ } -7- i ,
y > — o , ô } — u , o u , eu.
Dans leur prononciation, le fon dépend évidemment
de la manière dont la bouche ejl ouverte
au moment de l’émiflion de la voix.
_ Les lettres vocales labiales néceflitent, pour être
bien prononcées, l'aâion des lèvres } tels font
le B 8c le P, que certains peuples de l’Amérique
n'emploient jamais, par fuite de la coutume où ils
Syfif Anat, Tome /,
\ font de porter un anneau fufpendu à,leurs lèvres.
Les dentales s’articulent contre les dents} le
| D 8c le T font dans ce cas .: aulïi les enfans 8c les
vieillards ont-ils beaucoup de peine à les prononcer.
Il n‘y a qu’une feule lettre. Vocale palatale, c ’eft
L , qui eft formée par la langue contre le palais.
Les Lettres vocales gutturales font le G 8c le K }
elles font articulées dans l’arrière-bouche.
Les nafales font M 8c N. Pour rendre le fon
auquel elles équivalent, l’air doit traverfer les
foflTes nafales.
Dans la prononciation de toutes ces lettres le
fon eft inftantané , 8c fa nature ne dépend que du,
degré d’ouverture de la bouche.
Il n’en eft point de même dans les lettres buccales,
qui font prefque toutes fifflantes 8c que
produit le frottement de l’air contre les parois
delà bouché, en forte que l'on peut en prolonger
la pronontiation autant que dure la fortie de l’air
des poumons.
Parmi ces lettres, F 8c V exigent, dans leur
prononciation, le concours des lèvres 8c font labiales
; X , S , Z , exigent celui des dents 8c de la
langue, & font dentales ; 1 e the des Anglais eft dans
le même cas} J , H , R , font gutturales j le % des
Grecs l'eft aüiflâ.
C'eft l’a«iculation de ces lettres qui conftitue
ce qu’on eft convenu d’appeler la prononciation.
Celle des voyelles fe fait fans aucun effort : auffi
les enfans les prononcent-ils en général fort bien.
Quant aux çonfonnes, qui ne font deftinées qu’ à
lier les voyelles les unes guxautres, elles exigent
plus de peine.
De la combinaifon des lettres lés unes avec les
autres réfultent les mots , qui eux-mêmes com^
pofent les langues, dont nous avons déjà in-»
diqué la puiffance 8c les beaux privilèges dans les
premiers paragraphes de cet article.
11 nous fuffira de rappeler ici-, d’après M. le
profeffeur Richerand, que les langues les plus
harmonieufes font celles dont lés mots préfentenc
le plus de voyelles. La langue grecque e ft, en
particulier, dans ce cas.
. . . . . . Graiis dédit ore rotundo Mu fa loqui. . . . .
Telles font encore les langues des peuples d’O-
tahiti 8c celles de tous ces heureux infulaires de la
mer du Sud, qui vivent foiis iïn çiel où rien n’ inf-
pire des penfées fombres 8c des idées lugubres.
La plupart des languës feptentrionales, au contraire,
font âpres & dures. Que l’on compare
celle des Efquimaux, celle dès hordes fauvage s
du Labrador, à celle des. Péruviens, clés Mexi^
cains, Sec., 8c l’on fera bientôt convaincu
cette vérité. Mais qu'eft-il befoin, pour cela,
de fottir de notre propre Europe ?,écoutons parler
un Italien un Allemand. Le premier, dans fe$