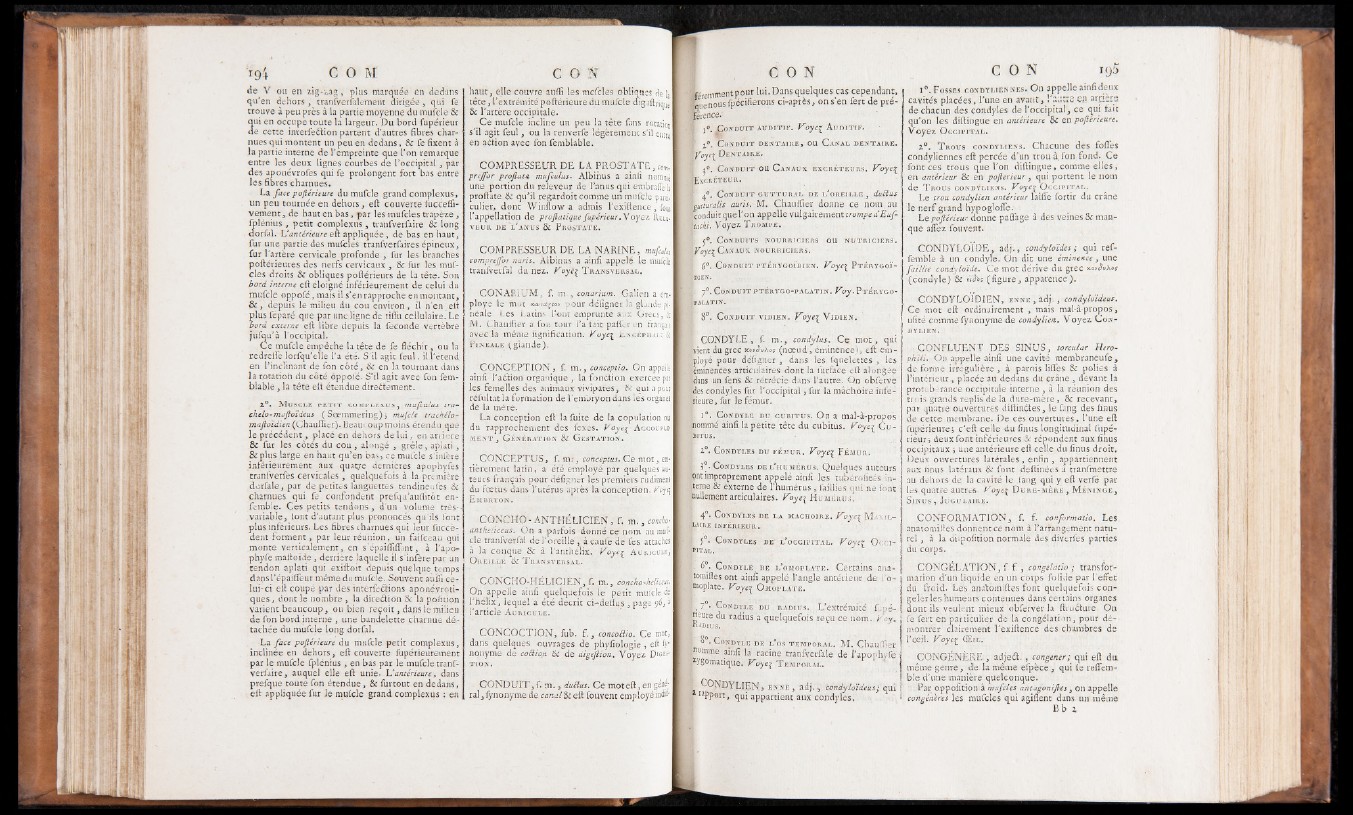
1 9 4 c 0 M
de V ou en z ig -z a g , plus marquée en dedans
qu’en dehors, tranfverfalement dirigée , qui fe
trouve à peu près à la partie moyenne du mufcle &
qui en occupe toute la largeur. Du bord fupérieur
de cette interfe&ion partent d’autres fibres charnues
qui montent un peu en dedans, 8c fe fixent à
la partie interne de l'empreinte que l'on remarque
entre les deux lignes courbes de l’occipital, pat-
dés aponévrofes qui fe prolongent fort bas entre
les fibres charnues.
La face pojiérieure du mufcle grand complexus,
un peu tournée en dehors, eft couverte fucceflî-
vement, de haut en bas, par les mufcles trapèze,
fblénius , petit complexus, tranfverfaire & long
dorfal. U antérieure eft appliquée, de bas en haut,
fur une partie des mufcles tranfverfaires épineux,
fur l'artère cervicale profonde , fur les branches
poftérieures des nerfs cervicaux , & fur les mufcles
droits & obliques poftérieurs de la tête. Son
bord interne eft éloigné inférieurement de celui du
mufcle oppofé, mais il s'en rapproche en montant,
& , depuis le milieu du cou environ, il n'en eft
plus féparé que par une ligne de tiflii cellulaire. Le
bord externe eft libre depuis la fécondé vertèbre
jufqu'à l’occipital.
C e mufcle empêche la tête de fe fléchir, ou la
redrelfe lorfqu'elle l'a été. S’il agit feul, il l'étend
en l'inclinant de fon côté, & en la tournant dans
la rotation du coté ôppole. S'il agit avec fon fem-
blable, la tête eft étendue directement.
2°. Muscle petit complexus, mufculus tra-
chelp-mofioideus ( Scemmering) j mufcle trachélo-
mafioïdien (Chauflier). Béarn: oup moins étendu que
le précédent, placé en dehors de lu i, en arriéré
& fur les côtés du c o u , alongé , grêle, aplati,
& plus large en haut qu’en bas, ce mufcle s'inlère
inférieurement aux quatre dernières apophyfes
tranfverfes cervicales, quelquefois à la première
dorfale, par de petites languettes tendineufes &
charnues qui fe confondent prefqu’auflitôt en-
femble. Ces petits tendons, d’un volume très--
variable, lont d’autant plus prononcés qu’ils font
plus inférieurs. Les fibres charnues qui leur fuccè-
dent forment, par leur réunion, un faifcéau qui
monte verticalement, en s’épaifliffant, à l'apo-
phyfe maftoïde, derrière laquelle il s'infère par un
tendon aplati qui exiftoit depuis quelque temps
dansl'épaifteur même du mufcle. Souvent aufîî celui
ci eft coupé par des interférions aponévroti-
ques, dont le nombre, la dire dion & la pofition
varient béaucoup, ou bien reçoit, dans le milieu
de fon bord interne , une bandelette charnue détachée
du mufcle long dorfal.
La face poftérieure du mufcle petit complexus,
inclinée en dehors, eft couverte fupérieurement
par le mufcle fplénius , en bas par le mufcle tranfverfaire,
auquel elle eft unie. L'antérieure, dans
prefque toute fon étendue, & furtout en dedans,
eft appliquée fur le mufcle grand complexus : en
c o f j
haut, elle couvre auffi les mcfcles obliques de |3
tête, l'extrémité poftérieure du mufcle digaftriqUe
5c l’artère occipitale.
Ce mufcle incline un peu la tête fans rotation
s'il agit feul, ou la renverfe légèrement s’il enfrl
en aètion avec fon femblable.
COMPRESSEUR DE LA PROSTATE, com.
prejfor proftau mufculus. A.lbinus a ainli nommé
une portion du releveur de l'anus qui embralfeli
proftate & qu'il regardoit comme un mufcle particulier,
dont Winflow a admis l'exiftence, fous
l'appellation de projlatique fupérieur,Voyez Rus*
v e u R de "l a nus & P ro sta t e .
COMPRESSEUR DE LA NARINE, mufculus
comprejfor naris. Aibinus a ainfî appelé le mufcle
tranfverfal du nez. Voyè[ T ransversal.
CONARiUM, f. m , conarium. Galien a employé
le mot KuvuPtov pour défîgner la glande pi-
néale Les Latins l'*ont emprunte aux Grecs, &
M. Chauflier à fon tour l'a fait paffer en fianças
avec la même lignification. Voye^ EeH§£-phal.-&
Pinéale (glande).
CONCEPTION , f. m ., conceptio. On appelle
ainfî l'aétion organique , la fonction exercee par
les femelles des animaux vivipares* 6c qui a pour
réfuitat la formation de l ’embryon dans les organes
de la mère.
La conception eft la fuite de la copulation ou
du rapprochement des fexes. Voyt[ A ccouplem
en t , G én éra t io n 5c G e st a t io n .
CON CE PTU S , f. m;, conceptus. Ce mot, en- (
tièrement latin, a été employé par quelques au-1
teurs français pour défîgner lès premiers rudimens <
du foetus dans l'utérus après la conception. Voyi{
E mbr yon.
CONCHO - AN TN É L IC IEN , f. m. 3 concho-
antheiiceus. On a parfois donné ce-nom au muf-1
d e tranfverfal de l'oreille, à caufe de fes attaches I
à la conque 5c à l'anthélix. Voye£ A uricule,
Oreille 6 c T ransversal.
CON C H O-H É LIC1 EN , f. m., concho-htlm |
On appelle ainfî quelquefois le petit mufcle de
l'hélix, lequel a été décrit ci-deflus, page 96, à
l'article A uricule.
CON CO C T IO N , fub. £ , c'oncoüio. Ce mot J
dans quelques ouvrages de phyfîologie , eft lj"
nonyme de coftioji 6c de digefiion. Voyez Digestion.
CON DUIT, f. m ., duftus. Ce mot eft, en général,
fynonyme de canal 5c eft Couvent employé indif
C O N
■ eremmentpour lui. Dans quelques cas cependant,
B u e nous fpécifierons ci-après, on s'en fert de pré-
prence.
B l ° . C on duit a u d it if . Voye^ A u d it i f .
K 2°. C on duit d e n t a ir e , ou C anal d en t a ir e .
I Voye\ Den ta ir e .
K j ° . C on duit ou C anaux e x c r é t e u r s . Voye£
■ Excréteur.
■ 40. C onduit g u t t u r a l de l' o r e i l l e , dudbus
Igutturalis auris. M. Chauflier donne ce nom.au
■ Conduit que l'on appelle vulgairement trompe d'Euf-
l 'tacfii. Voyez T rompe.
k f ° . C on du its n o u r r ic ier s o u n u t r ic ie r s .
iVoyei C anaux n o u r r ic ie r s .
■ 6°. C on duit p t é r y g o ïd ien . Voye[ P t é r y g o ïÏDJENi
K 70. C on du it p t é r y g o -pa la t in . Voy. P térygo-
|PALÀTIN.
I 8 °. C on du it v id ie n . Voye[ V id ie n .
1 CONDYLE , f. m., condylus. C e mot, qui
■ vient du grec xoviïvxos (noeud, éminence), eft employé
pour défîgner , dans les- fquelettes , les
■ éminences articulaires dont la lurface eft alongée
dans un Cens 5c rétrécie dans l'autre. On obferve
ides condyles fur l'occipital, fur la mâchoire inférieure,
fur le fémur.
1. i°. C ondyle du c u b it u s . On a mal-à-propos
nommé ainfî la petite tête du cubitus. Voye^ Cu-
•jiilTUS.
I 2°. C ondyles du f ém u r . Voyez F ém u r .
|: 3°. C ondyles d e l ’ h um é r u s . Quelques auteurs
lont improprement appelé ainfî les tubérofîtés interne
& externe de l'humérus , faillies qui ne font
Nullement articulaires. Voyc[ H u m é r u s .
K 40. C ondyles d e la mâ choir e. Voyc[ M a x i l -
|laire in f é r ie u r .
I 1 • C ondyles de' l ' o c c ip ita l . Voye£ Occip
it a l .
■ g®. C ondyle de l’omoplate. Certains anatomiftes
ont ainfî appelé l'angle antérieur de i’o-
Imoplate. Voye^ O mop late.
I I 7°- C ondyle d u r a d iu s . L’extrémité fupé-
Jneure du radius a quelquefois reçu ce nom. Vay.
Jaadius.
I 0 . C ondyle de l ’os t em po r a l . M . Chauflier
|nommé ainfî la racine tranfverfàle de l’apophyfe
pygomatique. Voye^ T empo ral.
CONDYLIEN, e n n è , adj.-, condyloïdeusjqui
r apport, qui appartient aux condyles,
C O N iy5
i° . Fosses condyliennes. On appelle ainfî deux
cavités placées, l'une en avant* !'si;tr£ Çfl arn ~p
de chacun des condyles de l'occipital, ce qui fait
qu'on les diftingue en antérieure 5c en pojiérieure.
Voyez Occipital.
2°. T rous condyliens. Chacune des fofles
condyliennes eft percée d’un trou à. fon fond. Ce
font ces trous que l'on diftingue, comme elles,
en antérieur & en pofterieur , qui portent le nom
de T rous condÿliens. Voye[ O ccipital.
Le trou condylien antérieur laifle fortir du crâne
le nerf grand hypogloffe.
Le pofiérieur donne paflage à des veines 5c manque
àflez fouvent.
CON DY LO IDE , adj., condyloides ; qui ref-
femble à un condyle. On dit une éminence, une
faillie condyloïde. Ce mot dérive du grec xovfuXos
(condyle) & üfos ( figüre, apparence).
CONDYLOIDIEN, enne , adj. , condyloideus.
Ce mot eft ordinairement , mais mal-à propos,
ufité comme fynonyme de condylien. Vo yez C on^-
DYLIEN.
' CONFLUENT DES SINUS , torcular Hero-
phiti. On appelle ainfî une cavité membraneufe ,
déformé irrégulière, à parois liftes 5c polies à
l’intérieur, placée au dedans du crâne , devant la
protubérance occipitale interne , à la réunion des
trois grandis replis de la dure-mère, & recevant,
par quatre ouvertures diftinéles, le fang des fînus
de cette membrane. De ces ouvertures, l’une eft
Supérieure5 c’eft celle du fînus longitudinal fupérieur
3 deux font inférieures ic répondent aux fînus
occipitaux ; une antérieure eft celle du fînus droit.
Deux ouvertures latérales, enfin , appartiennent
aux finus laté.raux & font .deftinées à tranfmettre
au dehors de la cavité le fang qui y eft verfé par
les quatre autres. Voye[ Dure-mère , Méninge,
Sinus , Jugulaire.
CON FORMATION , f. f. conformatio. Les
anatomiftes donnent ce nom à l’ arrangement naturel
, à la difpofîtion normale des diverfes parties
du corps.
CON G ÉLATION , f f . , congelatio ; transformation
d’un liquide en un corps folide par l’effet
du froid. Lès anatomiftes font quelquefois congeler
les humeurs contenues dans certains organes
dont ils veulent mieux obferver la ftruéture. On
fe fert en particulier de la congélation, pour démontrer
clairement l’exiftence des chambres de
l'oeil. Voye£ OEil .
CONGÉNÈR.E , adjeét., congener; qui eft du
même genre, de la même efpèce, qui fe reflem-
b!e d'unô manière quelconque.
Par oppofition à mufcles antagoniftes, on appelle
congénères les mufcles qui agiflent dans un même
B b 2