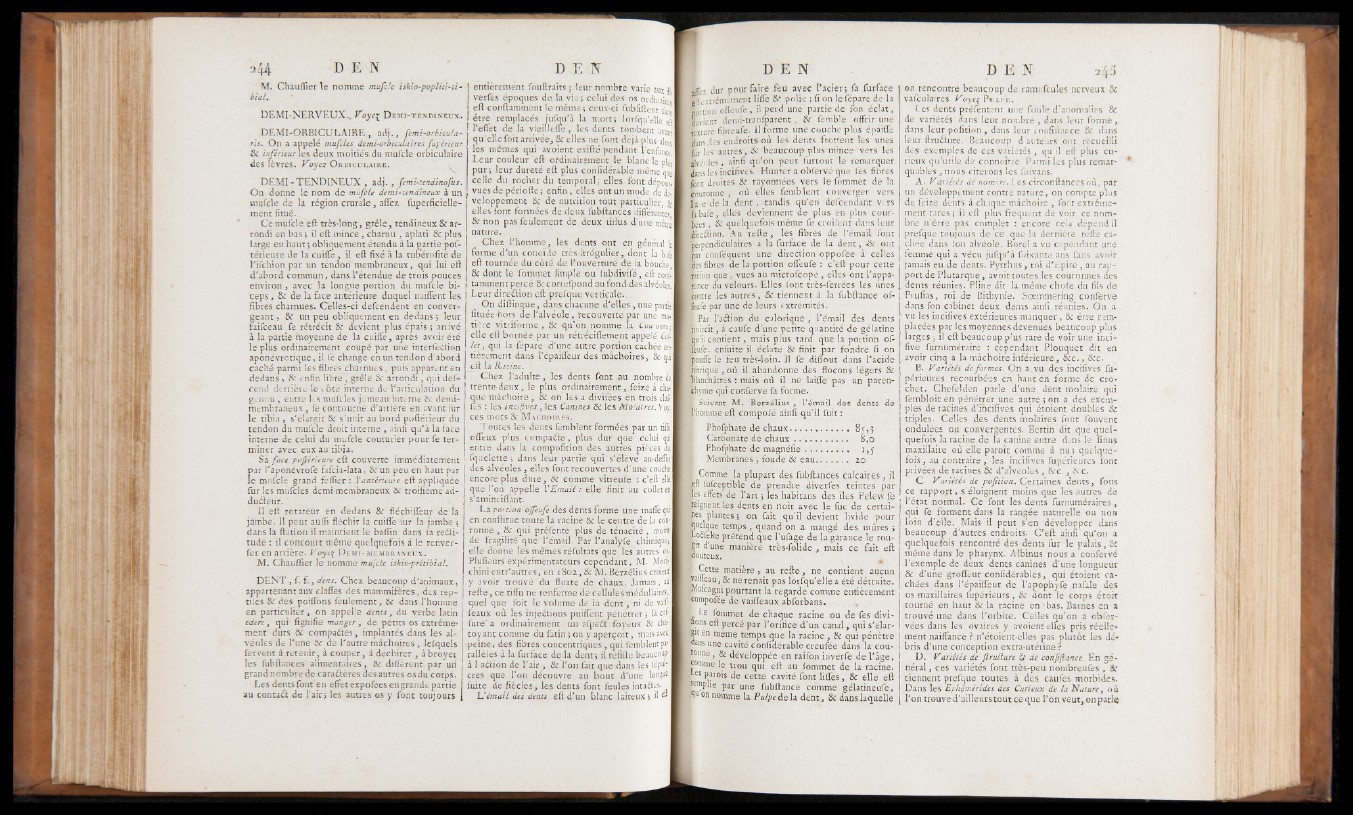
M. Chauffer le nomme mufcle iskio-popliti-ti-
bial.
DEMI-NERVEUX.. Voye\ D emi- te n d in eu x .
DEMI-ORBICULAIRE , ad j., femi-orbicula-
ris. On a appelé mufcles demi-orbiculaires fuférieur
& inférieur les deux moitiés du mufcle orbiculaire
des lèvres. Voye% O r b iculaire.
DEM I-TEN DINEU X , ad j., femi-tendinofus.
On donne le nom de mufcle demi-tendineux à un
mufcle de la région crurale, affez fuperficielle-
ment fitué.
Ce mufcle eft très-long, grêle, tendineux & arrondi
en bas ; il eft mince, charnu , aplati & plus
large en haut 5 obliquement étendu à la partie pof-
térieure de la cuiffe, il eft fixé à la tubérofité de
rifchion par un tendon membraneux, qui lui eft
d'abord commun, dans l'étendue de trois pouces
environ, avec la longue portion du mufcle bi- ;
ceps , & de la face antérieure duquel n aillent les I
fibres charnues. Celles-ci defcendent en convergeant
, & un peu obliquement en dedans ; leur
faifceau fe rétrécit & devient plus épais 5 arrivé
à la partie moyenne de la cuiffe, après avoir été
le plus ordinairement coupé par une interfedion
aponévrctique, il fe change en un tendon d'abord
caché parmi les fibres charnues, puis apparent en
dedans > & enfin libre 5 grêle &r arrondi, qui def-
cend derrière le côté interne de l'articulation du
genou, entre les mufcles jumeau interne ëe demi-
membraneux , fe contourne d'arrière en avant fur
le tibia , s'élargit & s'unit au bord poftérieur du
tendon du mufcle droit interne , ainlî qu'à la face
interne de celui du mufcle couturier pour fe terminer
avec eux au tibja.
Sa face pojiérieure eft couverte immédiatement 1
par l'aponévrofe fafcia-lata, & un peu en haut par
le mufcle grand feflier : l’ antérieure eft appliquée I
fur les mufcles demi-membraneux troifième adducteur.
11 eft rotateur en dedans & fléchiffeur de la
jambe. 11 peut auffi fléchir la cuiffe fur la jambe ;
dans la ftation il maintient le baffin dans fa rectitude
: il concourt même quelquefois à le renver-
fer en arrière. Voye\ Dem i-membraneux.
M. Chauffer le nomme mufcle iskio-prétibial.
D E N T , f. f . , dens. Chez beaucoup d'animaux,
appartenant aux claffes des mammifères, des reptiles
& des poiffons feulement, & dans l’homme 1
en particulier, on appelle dents, du verbe latin |
edere, qui fignifie manger, de petits os extrême« I
ment durs & compactes, implantés dans les alvéoles
de l'une & de l'autre mâchoires , lefquels
fervent à retenir, à couper, à déchirer , à broyer
les fubftances alimentaires, & diffèrent par uii
grand nombre de caractères des autres os du corps.
Les dents font en effet expofées en grande partie
au contact de l'air5 les autres os y font toujours
entièrement fouftraits ; leur nombre varie aux d’
verfes époques de la vie; celui des os ordinaire
eft conftamment le même ; ceux-ci fubfiftent fans
être remplacés jufau’à la mort; lorfqu’elle eft
| l’effet de la vieilleffe, les dents tombent avant
qu'elle fort arrivée, & elles ne font déjà plus alors
les mêmes qui avôient exifté pendant l ’enfance
Leur couleur eft ordinairement le blanc le p[|js
pur; leur dureté eft plus cohfidérable même que
celle du rocher du temporal; elles font dépour.
vues de périofte; enfin, elles ont un mode de développement
& de nutrition tout particulier &
elles font formées de deux fubftances différentes
& non pas feulement de deux tiftus d’une même
nature.
Chez l'homme, les dents ont en général h
forme d'un conoïde très-i'rrégulier, dont la bafe
eft tournée du côté de l'ouverture de la bouche
& dont le 'fommet fimpie ou fubdivifé, eft conftamment
percé & correfpond au fond des alvéoles,
j Leur direction eft prefque verticale.
On diftingue, dans chacune d’elles, une partie
fîtuée-hors de l'alvéole, recouverte par une matière
vittiforme , & qu’on nomme la Couionne:
elle eft bornée par un rétréciflèment appelé Collet,
qui la fépare d'une autre portion cachée erç
fièrement dans l’épaiffeur des mâchoires, & qui
^lt la Racine.
Chez l’adulte, les dents font au nombre de
trente-deux, le plus ordinairement, feize à chaque
mâchoire, & on les a divifées en trois claffes
: les Incifives , les Canines & les Molaires. Yoy,
ces mots & Mâchoires.
Toutes les dents fëmblent formées par un tiilii
offeux plus compaCte, plus dur que celui qui
entre dans la compofition des autres pièces du
fquelette ; dans leur partie qui's'élève au-deflus
des alvéoles , elles font recouvertes d’une couche
encore plus dure, & comme vitreufe : c’eft elle
que l’ on appelle Y Email : elle finit au collet eu
s'aminciffant.
La portion oJfeufeAes dents forme une maife qui
en conftitue toute la racine & le centre de la couronne
, & qui préfente plus de ténacité, moins
de fragilité que l'émail. Par l'analyfe chimique)
elle donne les mêmes réfultats que les autres os.
Plufieurs expérimentateurs cependant, M. Mori-
chini entr'autres, en 1802, & M. Bérzélius croient
y avoir trouvé du fluate de chaux. Jamais, an
refte, ce tiffu ne renferme de cellules médullaires,
quel que foit le volume dé la dent, ni de vaff-
féaux où’ les injeCtions puiffent pénétrer ; fa caf-j
fure'a ordinairement un afpeCt foyeu-x & chatoyant
comme du fatin ; on y aperçoit, mais avec I
peine, des fibres concentriques, qui lèmblentparallèles
à la furface de la dent; il réfifte beaucoup
à 1 aCtion de l'air , & T on fait que dans les fépul*
cres que l'on découvre au bout d’ une longue
fuite de fié clés, les dents font feules intaCtes.
Vémail des dents eft d’un blanc laiteux j il
ÿ0-e7 t|ur pour faire feu avec l’acier; fa furface
Ifftextrêmement liffe & polie ; fi on le fépare de la
portion ofleufe, il perd une partie de fon éclat,
fevient demi-tranfparent, & femble offrir une
Rxture fibreufe. 11 forme une couche plus épaiffe
dans.les endroits où les dents frottent les unes
fur les .autres, & beaucoup plus mince vers les
alvéoles, ainfi qu’on peut furtout le remarquer
dans les incifives. Hunter a obfervé que les fibres
fbnt droites & rayonnées vers le fommet de la
couronne , où elles femblent converger vers
fa'tg delà dent, tandis qu’en defeendant vers
fit bafe, elles deviennent de plus en plus cour-
Eiées, & quelquefois même fe croifent dans leur
direction. Au refte, les fibres de l’émail font
perpendiculaires à la furface de la dent, &. ont
par conféquent une direction oppofée à celles
lies fibres de la portion offeufe : c’eft pour cette
iaifon que, vues au microfçope, elles ont l’appa-
fience du velours. Elles font très-ferrées-les unes
lontre les autres", & tiennent à la fubftance of-
feufe par une de leurs extrémités,
fi Par l’aCtion du calorique , l’émail des dents
noircit, à caufe d’ une petite quantité de gélatine
iju’il contient, mais plus tard que la portion ofi
ieufe; enfuite il éclate & finit par fondre fi on
pouffe le feu' très-loin. 11 fe difiout dans l’ acide
nitrique, où il abandonne des flocons légers &
Splanchâtres : mais où il ,ne laiffe pas un parenchyme
qui conferve fa forme.
fi| Suivant M. Bérzélius, l’émail des dents de
l ’homme eft compofé ainfi qu’ il fuit :
Phofphate de chaux......... ...... . . . . 8m
Carbonate de ch au x ..............
Phofphate de magnéfie . . . . . . . . i,y
Membranes, foude & eau.. . . . . 10
■ Comme la plupart des fubftances calcaires, il
B p fufceptible de prendre diverfes teintes par
ffles effets de l'art ; les habitans des îles Pelew fe
teignent les dents en rïoir avec le fuc de certaines
plantes ; on fait qu’il devient livide pour
. quelque temps , quand on a mangé des mûres ;
Loëfeke prétend que l ’ufage de la garance le rou-
Igit d’une manière très-folide , mais ce fait eft
■ douteux.
■ Cette matière, au refte, ne contient aucun
iVarffeau, & ne renaît pas lorfqu'elle a été détruite.
■ Mafcagni pourtant la regarde comme entièrement
Kompofée de vaiffeaux abforbans.
•ir *'e de chaque racine ou de fes divisons
eft percé par l’orifice d’ un cana'l, qui s'élar-
. Il'r en même temps que la'racine, & qui pénètre
dans une cavité confidérable creufée dans la cou-
KPnne, & développée en raifon inverfe de l'â ge,
Somme le trou qui eft au fommet de la racine.
es P?r0*s de cette cavité font liffes, & elle eft
f en?P*le Par une fubftance comme gélatineufe,
on nomme la Pulpe de la dent, & dans laquelle
©n rencontre beaucoup de ramufcules nerveux &
vafculaires. V oyq; Pu l p e .
Les dents préfentent une foule d’anomalies &
de variétés dans leur nombre , dans .leur forme ,
dans leur pofition , dans leur çonfiftance & dans
leur ftruéture. Beaucoup d auteurs ont recueilli
des exemples de ces variétés, qu il eft plus curieux
qu’utile de connoître Parmi les plus remarquables
, nous citerons les fui vans.
A. Variétés de nombre. Les circonftances où, par
un développement contre nature, on compte plus
de feize dents à chaque mâchoire , font extrêmement
rarés 5 il eft plus frequent de voir ce nombre
n’êtrs pas complet : encore cela dépend il
prefque toujours de ce que la dernière refte cachée
dans (on alvéole. Borel a vu cependant une
femme qui a vécu jufqu’ à foixante ans fans avoir
jamais eu de dents. Pyrrhus, roi d’ Epire, au rapport
de Plutarque, avoittoutes les couronnes des
dents réunies. Pline dit la même chofe du fils de
Prufias, roi de Bithynie. Soemmering conferve
dans fon cabinét deux dents ainfi réunies. On a
vu les incifives extérièures manquer, & être remplacées
par les moyennes devenues beaucoup plus
larges ; il eft beaucoup plus rare de voir une inci-
five furnuméraire : cependant Plouquet dit en
avoir cinq a la mâchoire inférieure, & c . , &c.
B. Variétés de formes. On a^vu des incifives fu-
périeures recourbées en haut en forme de crochet.
Ghefelden parle d’une dent molaire qui
fembloit en pénétrer une autre ; on a des exemples
de racines d’incifives qui étoient doubles &
triples. Celles des dents molaires font fouvent
onduléès ou convergentes. Bertin dit que quelquefois
la racine de la canine entre dans le fînus
maxillaire où elle paroît comme à nu; quelquefois,
au contraire , -les incifives fupérieures font
privées de racines & d’ alvéoles , &rc., &c.
C Variétés de pofition. Certaines dents, fous
ce rapport, s'éloignent moins que les autres de
l’état normal. C e font les dents furnuméraires,
qui fe forment dans la rangée naturelle ou non
loin d’elle. Mais il peut s'en développer dans
beaucoup d'autres endroits. C’ eft ainfi qu’ on a
quelquefois rencontré des dents fur le palais, 8c
même dans le pharynx. Albinus nous a confervé
l ’exemple de deux dents canines d’une longueur
& d’une groffeur confidérables, qui étoient cachées
dans l’épaiffeur de l ’apophyfe nafale des
os maxillaires fupérieurs, & dont le corps étoit
tourné en haut & la racine en ’ bas. Barnes en a
trouvé une dans l’orbite. Celles qu’on a obfet-
vées dans les ovaires y avoient-elles pris réelle*
ment naiffance ? n’étoient-elles pas plutôt les dé*
bris d'une conception extra-utérine?
D. Variétés de firuciure & de confifiance. En général,
ces variétés font très-peu nombreufes , &r
tiennent prefque toutes à des caufes morbides.
Dans les Ep/iémérides des Curieux de la Nature, où
l'on trouve d’ailleurs tout ce que l’ on veut, on parle