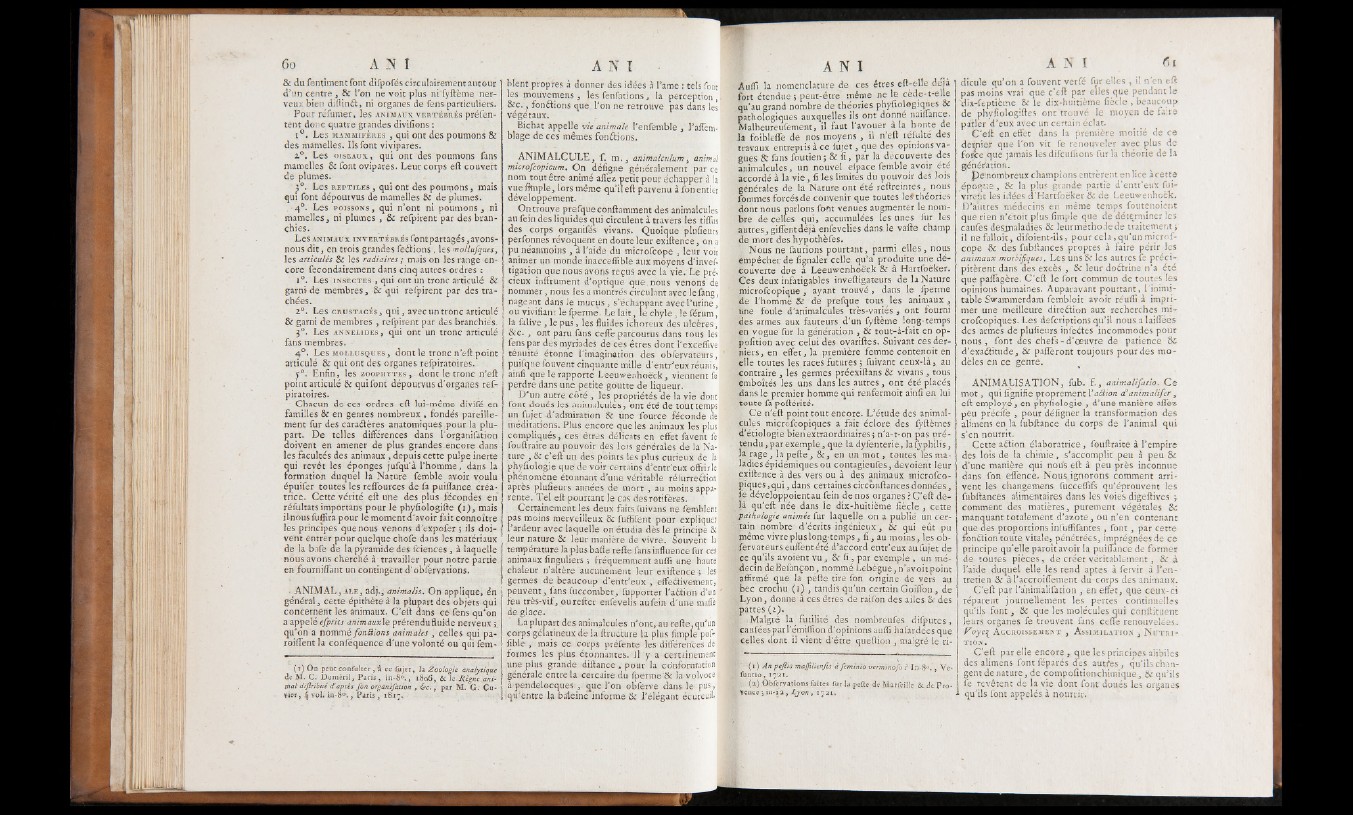
6o A N I
& du fentfment font difpofés circulairement autour
d’ un centre , 6c l’on ne voit plus ni fyftème nerveux
bien diftinét, ni organes de fens particuliers.
Pour réfumer, les animaux vertébrés préfen-
tent donc quatre grandes divifions :
i ° . Les mammifères , qui ont des poumons 6c
des mamelles. Ils font vivipares.
2 ° . Les o iseaux, qui ont des poumons fans
mamelles & font ovipares. Leur corps eft couvert
de plumes.
30.. Les r ep t îles j qui ont des poumons, mais
qui font dépourvus de mamelles 6c de plumes.
■ 40. Les poissons, qui n’ont ni poumons, ni
mamelles, ni plumes , 6c refpirent par des branchies.
Les animaux in vertébrés font partagés, avons-
nous d it, en trois grandes fe&ions, les mollufques,
les articulés & les radiaires ; mais on les range-en-
core fecondairement dans cinq autres ordres ■«
i° . Les insectes , qui ont un tronc articulé &
garni de membres, 6c qui refpirent par des trachées.
2°. Les cr usta cé s , q ui, avec un tronc articulé
& garni de membres , refpirent par des branchie's.
3°. Les ANNELiDEs, qui ont un tronc articulé
fans membres. -
4 ° . Les mollu squ es, dont le tronc n’eft point
articulé 6c qui ont des organes refpiratoires.
5°. Enfin, les zo ophytes, dont le tronc n’eft
point articulé 6c qui font dépourvus d’organes refpiratoires.
Chacun de ces ordres eft lui-même divifé en
familles & en genres nombreux , fondés pareillement
fur des caractères anatomiques pour la plupart.
De telles différences dans l’organifation
doivent en amener de plus grandes encore dans
les facultés des animaux, depuis cette pulpe inerte
qui revêt lès éponges jufqu’à l’homme, dans la
formation duquel la Nature femble avoir voulu
épuifer toutes les reffources de fa puiflance. créatrice.
Cette vérité eft une des plus fécondes en
réfultatsimportans pour le phyfiologifte ( i ) , mais
ilnous fuflSra pour le moment a avoir fait connoïtre
les principes que nous venons d’expofer ; iis doivent
entrer pour quelque chofe dans les matériaux
de la bafe de la pyramide des fciences, à laquelle
nous avons cherché à travailler pour notre partie
en fourniffant un contingent d'obfèrvations.
. ANIM A L , à l e , adj., animalis. On applique, én
général, cette épithète à la plupart des objets qui
concernent les animaux. C ’eft dans ce- fens qu’ on
a appe\éefprits animauxle prétendu fluide nerveux j,
qu’on a nommé fonctions animales , celles qui pa-
roiflent la conféquence d’une volonté ou qui fem-
(r) On peùt cônfulter , à ce fiijet, la Zoologie analytique
de M. C. Duméril, Paris, in-8°., i-8o6, 8c Je Règne,animal
difiribué d ’après fo n organifation , & c . , par M. G. Cu-
Y-ie-T j 4 Y'ol. in-8°. , Paris, 184 7,.
A N I
Ment propres à donner des idées à I’ame : tels font
les moüvemens, les fenfations, la perception ,
&c. 3 fondions que l’on ne retrouve pas dans les
végétaux.
Bichat appelle vie animale l’enfemble , l’affem-
blage de ces mêmes fon étions.
AN IM A LCU LE , 'f. m ,, animalculum, animal
microfcopicum. On défigne généralement par ce
nom tout être animé affez petit pour échapper à la
vue lttnple, lors même qu’il eft parvenu à fon entier
développement.
On trouve prefqueconftamment des animalcules
au fein des liquides qui circulent à travers les tiffus
des corps organifés vivans. Quoique plufieurs
perfonnes révoquent en doute leur exiftence, on a
pu néanmoins , à l’aide du microfcope , leur voir
animer un monde inacceflible aux moyens d’ invef-
tigation que nous avons reçus avec la vie. Le pré*
cieux inftrument d’optique que,nous venons de
nommer, nous les a montrés circulant avec lefang,
nageant dans le mucus, s’échappant avec l’urine,
ou vivifiant le fperme. Le lait, le chyle, le férum,
la falive, le pus, les fluides ichoreux des ulcères,
Sic-. 3 ont paru fans ceffe parcourus dans tous les
fens par des myriades de ces êtres dont I’exceflive
ténuité étonne l'imagination des observateurs,
puifque fouvent cinquante mille d’entr’ eiix réunis,
ainlî que le rapporte Leeuwenhoëck, viennent fe
perdre dans une petite goutte de liqueur.
D’un autre c ô té , les propriétés de la vie dont
font doués les animalcules, ont été de tout temps
un fujet -d’admiration & une fource féconde ae
méditations. Plus encore que les animaux les plus
compliqués, ces êtres délicats en effet favent fejj
fouftraire àu pouvoir des lois générales de la Nature
, 6c c ’eft un des points les plus curieux de la
phyfiologie que de voir certains d’entr’eux offrir le
phénomène étonnant d’une véritable réfurredion
après plufieurs années de m o r t, au moins apparente.
Te l eft pourtant le cas des rotifères.
Certainement les deux faits fuivans ne fémblent <
pas moins merveilleux & fuffifent pour expliquer
l’ardeur avec laquelle on étudia dès le principe &
, leur nature & leur manière de vivre. Souvent la^
température la plus baffe refte fans influence fur ces !
animaux finguliers j fréquemment aufli une haute ;
chaleur n’altère aucunement leur exiftence» les!
I germes de beaucoup d’entr’eux , .effectivement, '
peuvent, fans fuccomber, fupporter l’adtion d’un ;
feu très-vif, ou relier enfevelis aufein d'une malle |
de glace.
La plupart des animalcules n’ ont, au refte, qu’un ;!
corps gélatineux de la ftru&ure la plus fimple pof- p
fib le , mais ce corps préfente les différences de a
formes les plus-étonnantes. 11 y a certainement I
une plus grande diftance , pour la conformation!
générale entre la cercaire du fperme & la volvocel
à pendelocques:, que l’ on obferve dans le- pus» 9
;qü’entre la baleine informe 6c l’ élégant écureuiM
Aufli la nomenclature de ces êtres eft-elîe déjà
fort étendue j peut-être même ne le cède-t-elle
qu’ au grand nombre de théories phyfiologiques &
pathologiques auxquelles ils ont donné naiffance.
Malheureufement, il faut l’avouer à la honte de
.la foibleffe de nos moyens , il n’eft réfulté des
travaux entrepris à ce fujet, que des opinions vagues
& fans foutien; & fi, par la decouverte des
animalcules, un nouvel efpace femble avoir été
accordé à la v ie , fi les limites du pouvoir des lois
générales de la Nature ont été reftreintes , nous
fornmes forcés de convenir que toutes le^ théories
dont nous parlons font venues augmenter le nombre
de celles qui, accumulées les unes fur les
autres, giffentdéjà enfevelies dans, le vafte champ
de mort des hypothèfes.
Nous ne faurions pourtant, parmi e lle s , nous
empêcher de fignaler celle qu’a produite une découverte
due à Leeuwenhoeck 6c a Hartfoëker.
Ces deux infatigables inveftigateurs de la Nature
microfcopique, ayant trouvé, dans le lpérme
de l’homme & de prefque tous les animaux ,
une foule d’animalcules très-variés, ont fourni
des armes aux fauteurs d’ un fyftème long-temps
en vogue fur la génération , & tout-à-fait en op-
pofition avec celui des ovariftes. Suivant ces derniers,
en effet, la première femme contenoit en
elle toutes les races futures ; fuivant ceux-là,, au
contraire, les germes préexiftans 6c vivans , tous
emboîtés les uns dans les autres, ont été placés
dans le premier homme qui renfermoit ainfi en lui
toute fa poftérité.
, C e n’eft point tout encore. L’étude des animalcules
microfcopiques a fait éclore des fyftèmes
d’étiologie bien extraordinaires} n’a-t-on pas prétendu,
par exemple, que la dyfenterie, lalyphilis,
la rage, la pefte, & , en un m o t, toutes les maladies
épidémiques ou contagieufes, dévoient leur
exiftence à des vers ou à des animaux microfcopiques
, qui, dans certaines circonftances données ,
fe développoientau fein de nos organes ? C ’eft delà
qu’eft née dans le dix-huitieme fiè c le , cette
pathologie animée fur laquelle on a publié un certain
nombre d’écrits ingénieux, 6c qui eût pu
piême vivre plus long-temps, f i, au moins, les obier
vateurs euffent été d’ accord entr’eux au fujet de
ce qu’ils avoient vu, 6c fi , par exemple , un médecin
deBefançon, nommé Lebègue, n’avoit point
affirmé que la péfte tire fon origine de vers au
bec crocnu (1) , tandis qu’un certain Goiffon, de
L yon, donne à ces êtres de raifon des ailes 6c des
, pattes (2).
Malgré la futilité des nombreufes difputes,
cauféesparl’émiflîon d’opinions aufli hafardées que
celles dont il vient d’être queflion , malgré le rir
(1) An peftis majjilienfis à feminio verminàfo ? In-8»., Ve-
lïuntio, 1921.
|v. (2.) Observations faites fur la péfte de Marfeille 8c de Provence
5, in-12, L y o n , 1721.
dicule qu’ on a fouvent verfé fur elles , il n'en eft
pas moins vrai que c’eft par elles que pendant le
'dix-feptième & le dix-huitième fiècle , beaucoup
de phyfiologiftes ont trouvé le moyen de fa:re
parler d’eux avec un certain éclat.
C ’eft en effet dans la première moitié de ce
derpief que l’on vit fe renouveler avec plus de
force que jamais les difcuflions fur là théorie de la
génération.
péTiombreux champions entrèrent en lice à cette
,époque, 6c la plus grande partie d’ entr’eux fui-
virent les idées a Hartfoëker & de Leeuwenhoëk.
D’autres médecins en même temps foutenoient
que rien n’ étoit plus fimple que de déterminer les
caufes desjnaladies & leurméthodede traitement}
il nefalloit, difoient-ils, pour cela, qu’ un miçrof-
cope 6c des fubftances propres à faire périr les
animaux morbifiques. Les uns St les autres fe précipitèrent
dans des excès , & leur doctrine n’ a été
que paflagère. C ’eft le fort commun de toutes les
opinions humaines. Auparavant pourtant, l'inimitable
Swammerdam fembloit avoir réufli à imprimer
une meilleure direction aux recherches microfcopiques.
Les defcriptions qu’ il nous a laifleës
des armes de plufieurs infeétes incommodes pour
nous, font des chefs - d’oeuvre de patience 6c
d’exaélitude, 6c pafîeront toujours pour des modèles
en ce genre.
ANIMALISATION, fub. f ., animalifatio. C e
m o t, qui fignifie proprement YaÜion d‘animalifer,
eft employé, en phyfiologie , d’une manière affez
peu précife , pour défigner la transformation des
alimens en la fubftance du corps de l’animal qui
s’en nourrit.
Cette aétion élaboratrice, fouftraite à l’empire
des lois de la chimie, s’accomplit peu à peu &
d’une manière qui nous eft à peu près inconnue
dans fon effence. Nous ignorons comment arrivent
les changemens fuccefftfs qu’éprouvent les
fubftances alimentaires dans les voies digeftives }
comment des matières, purement végétales 8c
manquant totalement d’azote, ou n’en contenant
que des proportions infuffifantes, fon t, par cette
fonction toute vitalé, pénétrées, imprégnées de ce
principe qu’elle paroît avoir la puiffance de former
dé toutes p ièces, de créer véritablement, & à
l’aide duquel elle les rend aptes à fervir à l’entretien
6c à l ’accroiffement du corps des animaux.
C ’eft par l’animalifation., en effet, que ceux-ci
réparent journellement les pertes continuelles
qu’ils fo n t, & que les molécules qui conftituent
leurs organes fe trouvent fans ceffe renouvelées.
f^oye[ A ccroissement , A s similat ion , N u t r i t
io n .
C'eft par elle encore , que les principes alibiles
des alimens font féparés des autfes, qu’ ils changent
de nature, de compofitionchimique, & qu’ ils
fe revêtent de la vie dont font' doués les organes
■ qu’ils font appelés à nourrir.