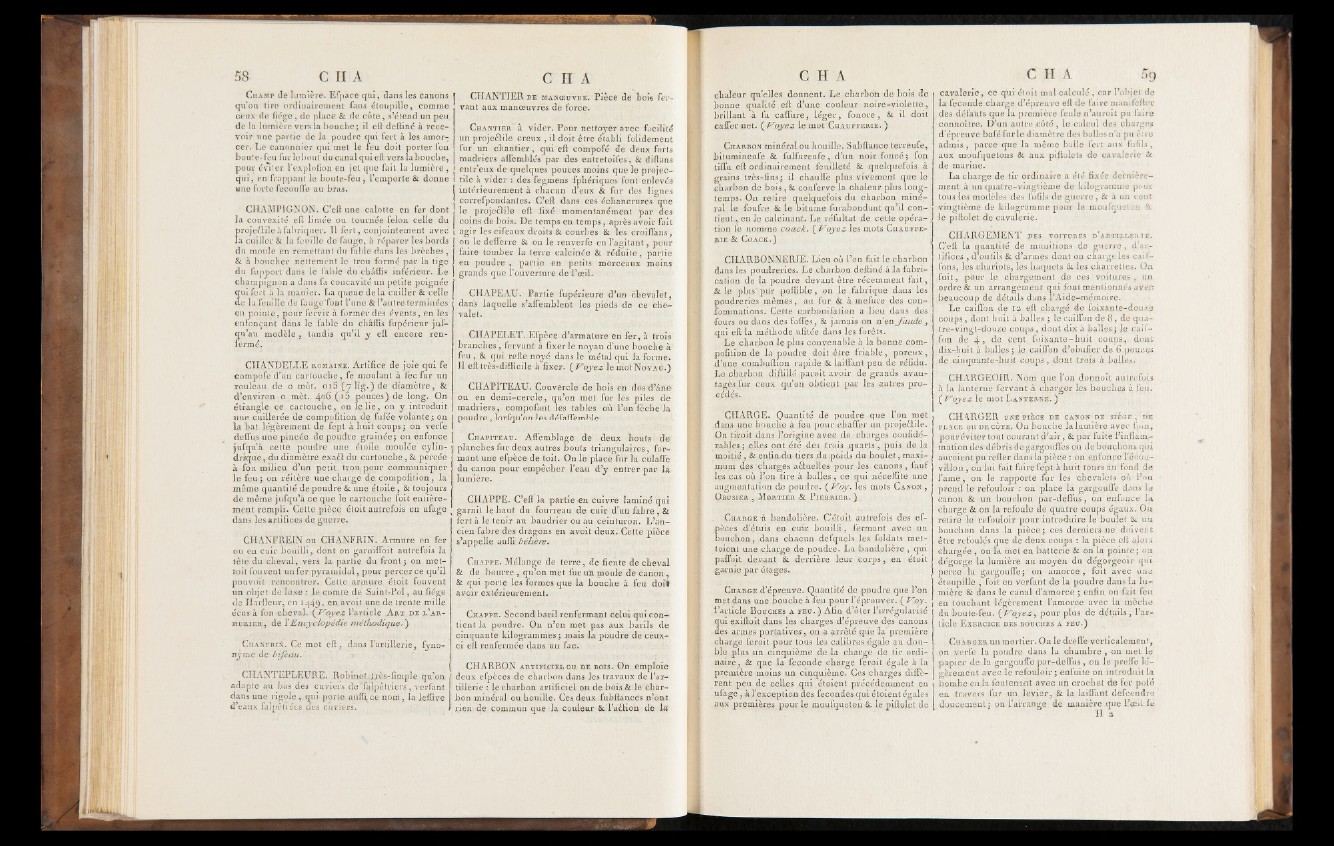
u
58 C II A
Champ de lumière. Efpace qui, dans les canons
qu’on tire ordinairement fans é toupille, comme
ceux de liège, de place' & de côte, s’étend un peu
de la lumière vers la bouche ; il eft delliné à recevoir
une partie de la poudre qui fert à les amorcer.
Le canonnier qui met le feu doit porle.v fon
boule-feu furlebout du canal qui eft vers labouche,
pour éviter l’explolion en jet que fait la lumière ,
qui, en frappant le boule-féu, l’emporte & donne
une forte fecoulfe au bras.
CHAMPIGNON. C’eft une calotte en fer dont
la convexité eft limée ou tournée félon celle du
projectile à fabriquer. Il fert, conjointement avec
la cuiller & la feuille de faugë, à réparer les bords
du moule en remettant du fable dans les brèches,
& à boucher nettement le trou formé par la tige
du fupport dans le fable du claâffis inférieur. Le
champignon a dans fa concavité un petite poignée
qui fert à la manier. La queue delà cuiller & celle
de la feuille de fange "font l’une & l’autre terminées
en pointe, pour fervir à former des évents, en les
enfonçant dans le fable du cbâfîis fupérieur juf-
qu’au modèle , tandis qu’il y eft encore renfermé,
CHANDELLE romaine. Artifice de joie qui fe
compofe d’un cartouche, fe moulant à fec fur un
rouleau de o met. o i5 (7 Rg; J de diamètre, &
d’environ o met. 4°6 ( 15. pouces) de long. On
étrangle ce cartouche, on le.lie, on y introduit
une cuillerée de compofition de fufée volante; on.
la bat légèrement de fept hliait coups; on verfé
defîu.s une pincée de poudre grainée; on énfonce
jufqu’à cette poudre une étoile moulée cylindrique,
du diamètre exâCt du cartouche, & percée
à fon milieu d’un petit trou; pour communiquer
le feu ; ou réitère une charge de compofition, la
même quantité de poudre & une étoile , & toujours
de même jufqu’à ce que le cartouche foit entièrement
rempli. Celte pièce étoit autrefois en ufage
dans les artifices de guerre.
CHANFREIN ou CHANFRÎN. Armure en fer
ou en cuir bouilli, dont on garnifl’oit autrefois la
tête du cheval, vers la partie du front; on met-
toit fou vent un fer pyramidal, pour percer ce qu’il
pouv dit rencontrer.. Celte armure étoit fou vent
un objet de luxe : le comte dé Sainl-Pol, au fiége
de Harfleur, en 1449, en 9v°d une de trente mille
éc.us à fon cheval. {Voyez l’article Art de l ’armurier,
de Y Encyclopédie méthodique.')
C hanfrin. Ce mot eft, dans l’artillerie, fyno-
nyme de bifeau.
CHANTEPLEURE. Robin e.L Jr è e - fi ni p 1 e qu’on
adapte au bas des cuviers de 'ialpêtriers, verfant
dans une rigole qui porte aüffi,ce nom, la lefiive
d’eaux falpêtrées des cuviers.
C H A
CHANTIER i>E manoeuvre. Pièce de boi« fer-
vant aux manoeuvres de force.
Chantier' à vider. Pour nettoyer avec facilité
un projectile creux , il doit être établi folidement
fur un chantier, qui eft compofé de deux forts
madriers aflèmblés par des entre loïfes, & diftans
entr’eux de quelques pouces moins que le projectile
à vider : des fegmens fpbériques font enlevés
intérieurement à chacun d’eux & fur des ligues
correfpondantes, C’eft dans ces échancrures que
le projectile eft fixé momentanément par des
coins de bois. De temps en temps, après avoir fait
agir les cifeaux droits & courbes & les croiffans,
on le defferre & on le renverfe en l’agitant, pour
faire tomber la terre calcinée & réduite, partie
en poudre , partie en petits morceaux moins
grands que l’ouverture de l’oeil.
CHAPEAU. Partie ( upérieure d’un chevalet,
dans laquelle s’afîemblent les pieds de ce chevalet.
CHAPELET. Efpèce d’armature en fer, à trois
branches, fervant à fixer le noyau d’une bouche à
feu , & qui relie noyé dans le métal qui la forme.
Il eft tres-difficile à fixer. {Voyez le mot Noyau.)
CHAPITEAU. Couvercle de bois en dos d’ârie
on en demi-cercle, qu’on met fur lès piles de
madriers, compofant les tables où l’on lèche la
poudre , lorfqu’on les défaffemble.
Chapiteau. AfTemhlage de deux bouts de
planches fur deux autres bouts triangulaires, formant
une efpèce de toit. On le place fur la culaffe
du canon pour empêcher l’eau d’y entrer par la
lumière.
CHAPPE. C’eft la partie en cuivre laminé qui
garnit le haut du fourreau de cuir d’un fabre , &
fert à le tenir au baudrier ou au ceinturon. L’ancien
fabre$es dragons en avoit deux. Cette pièce
s’appelle aufti bélière.
Chappe. Mélange de terre, de fiente de cheval
& de bourre , qu’on met fur un moule de canon .
& qui porte les formes que la bouche à feu doit
avoir extérieurement.
Chappe. Second baril renfermant celui qui contient
la poudre. On n’en met pas aux barils de
cinquante kilogrammes ; mais la poudre de ceux-
ci eft renfermée dans un fae.
CHARBON a r t if ic ie l ou de bois. On emploie
deux efpèces-de charbon dans les travaux de l’artillerie
: le charbon artificiel ou de bois & le charbon
minéral ou. houille. Ces deux fubftances n’ont
pjen de commun que la couleur &.l ’a£tion de là'
chaleur quelles donnent. Le charbon de bois de
bonne qualité eft d’une couleur noire-violette,
brillant à fa cafïure, léger, fonore, & il doit
cafter-net. ( Voyez le mot Chaufferie. )
Charbon minéral ou houille. Subftance terreufe,
bilumineufe & fulfureufe, d’un noir foncé; fon
tiflu. eft ordinairement feuilleté & quelquefois à
grains très-iius; il chaude plus vivement que le
charbon de bois ., & conferve la chaleur plus longtemps.
On retire quelquefois du charbon minéral,
le foufre & le bitume furabondunt qu’il contient.,
en le calcinant. Le réfukat de cette opération
fe nomme co.ack. .( Voyez les mots Chauffer
ie & CoACK.)
CHARBONNERTE. Lieu ou l’on fait le charbon
dans les poudreries. Le charbon deftiné àla fabrication
de la poudre devant être récemment fait,
& lp pl.us'pùr poffible, on le .fabrique dans les
poudreries mêmes, au fur fit à me Cure des con-
iomraations, Cette car.bpnifation a lieu dans des
fours ou dans des foffes, & jamais on n’en Jaude ,
qui eft la méthode ufitée dans les forêts.
Le charbon le plus convenable à la bonne compofition
de la poudre doit être friable, poreux,
d’une combuftion rapide & lailfanfc peu de réfidu.
Le charbon diftillé paroit avoir de grands avantagés
fur ceux qu’on obtient par les autres procédés,
cavalerie, ce qui étoit mal calculé , car l’objet de
la fécondé charge d’épreuve eft de faire manifefter
dès défauts que la première feule n’auroit pu faire
connoître. D’un autre .côté, le calcul des charges
d’épreuve bafé furie diamètre des balles n’a pu être
admis , parce que la même balle fert aux fufils,
aux moufquetons & aux pi fiole Ls de cavalerie &.
de marine.
La charge de tir ordinaire a été fixée dernièrement
à un quatre-vingtième de kilogramme pour
tous les modèles des fufils de guerre , & à un cent
vingtième de kilogramme pour le rnoufquetoa &
le piftolet de cavalerie.
CHARGEMENT des voitures d'artillerie.
C’eft la quantité de munitions de guerre , d’artifices
, d’outils & d’armes dont on charge les eail-
fons, les .chariots, les haquets &. les charrettes. On
fuit, pour lp chargement de ces voitures , mi
.ordre ;& un arrangement qui font mentionnés aven
beaucoup de détails dans F Ai d c-m é m 01re.
Le cailTon de 12 eft chargé de foixante-douze
coups , dont huit à balles ; le caiffon de 8, de qua-
.tre-vingt-douze coups , dont dix à balles; le caif-
fon de 4 ? de cent loixante-huit coups,. dont
dix-huit à balles ; l,e çailfon d’obufier de 6 pouces
de Ginquan.te-buit coups, dont trois à balles,
CHARGEOIR. Nom que l’on donnoit autrefois
à la lanterne fervant à charger les bouches à leu.
( Voyez le mot Lanterne. )
CHARGE. Quantité de poudre que l’on met
dans une bouche à feu pour cbàflèr un projectile.
On tiroit dans l’origine avec de charges confidé-
rables; elles .ont été des trois quarts , puis de la
moitié, Si enfindu tiers .duipoids du boulet, maximum
des .charges actuelles pour les canons , fauf
les cas où l’on tire.à balles, ce. qui nécelfite une
augmentation de poudre. ( Voy. les mots Canon ,
Qbusier , Mortier & P ie r r ie r . )
. C harge ù bandolière, Ç’étoit autrefois des ef-
pècés d’étuis en cuir bouilli, fermant avec un
bouchon, dans chacun defquels les foldats met-
loient une .charge de poudre. La bandolière , qui
paifo.it_devant & derrière le.ur ,corps, en étoit
garnie par étàgps.
Charge d’épreuve. Quantité de poudre que l’on
met dans une bouche à ïèu pour réprouver. ( Voy.
l ’article B ouches a f eu . ) Afin d’ôter l’irrégularité
qui exiftoit dans les charges d’épreuve des canons
des armes portatives , p;n ;a arreté que la première
charge feroit pour tons les calibres égale au dou- .
ble. plus un cinquième de la charge de tir ordinaire
, & que la féconde charge feroit égale à la
première moins un cinquième. Ces charges diffèrent
peu de celles qui étoient précédemment en
ufage , à l’exception des fécondés qui étoient égales
aux premières pour le moulqueton & le piftolet de
CH ^ R G E R une pièce de canon de siège ; de
place 911 de.cote. On bouche la lumière avec .loin,
pour éviter tout courant d’air, & par fuite Fin,Ranimation
des débris de gargouffes ou de bouchons qui
aiiroientpu relier dans la pièc.e : on enfonce l’écou-
vi'llon , on lui fait faire fépt à huit tours au fond de
l’aine , on le rapporte fur les chevale.ts où l’on
prend le refouloir : on place la gargoulïè dans la
canon & un bouchon par-défi us, on enfonce la,
charge & on la refoule de quatre coups égaux. Ou
retire le refouloir pour introduire le boulet &. un
bouchon dans la pièce; ces derniers 11e doivent
être refoulés que de deux coups : la pièce eft alors
chargée , on la met en batterie & on la pointe; ou
dégorge la lumière au moyen du dégorgeoir qui
perce la gargoulïè; on amorce , foit avec une
étoupille , foit en verfant de la poudre dans la lumière
& dans le canal d’amorce ; enfin on fait feu
en touchant légèrement l’amorce avec la mèche
du boute-feu. ( Voyez, pour plus de détails, l’article
E xercice des bouches à feu .)
Chârçer un mortier. On le dreffe verticalement,
l yerfe la poudre- dans la chambre , on met le
pi er de la gargaufte par-deflus, on le prelle 1ère
ment avec le refouloir ; enfuite on introduit la
>mbe en la foulenaat avec un crochet de fer polé
l travers für un levier, & la laifî’ant descendre