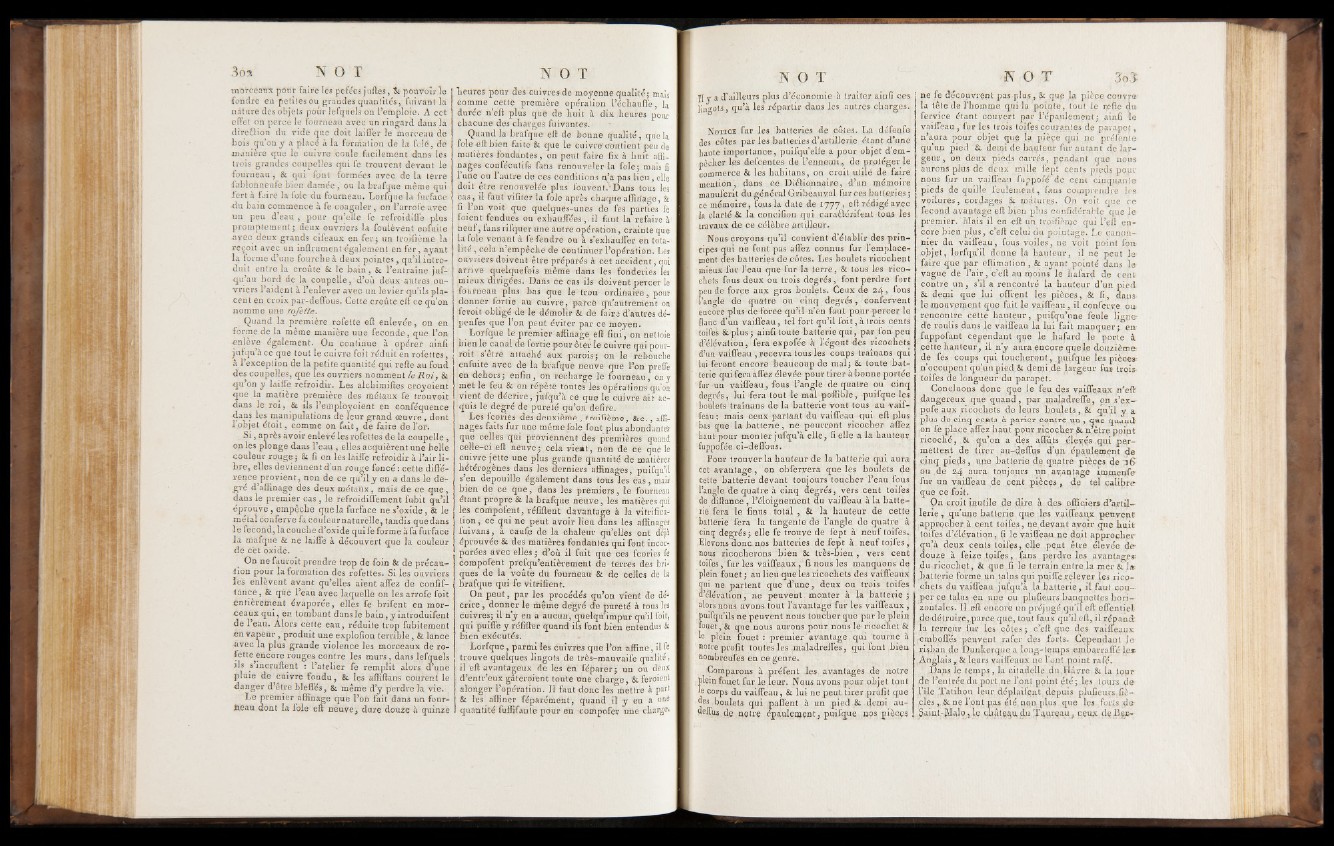
morceaux polir Faire les pefées j ailes, te p on voir le
fondre en petites ou grandes quantités, buvant là
nature des objets pour lefquels on l’emploie. A cet
effet on perce le fourneau avec un ringard dans la
direction du vide que doit lai fier le morceau de
bois qu’on y a placé à la formation de la foie, dé
manière que le cuivre coule facilement dans lès
trois grandes coupelles qui fe trouvent devant le
fourneau, & qui font formées avec de la terre
fablonneufe bien damée, ou la brafque même qui
iert à faire la foie du fourneau. Lorfque la furface
•du bain commence à fe coaguler,, on l’arrofe avec
un peu d’eau , pour qu’elle fe refroidiffe plus
promptement 5 deux ouvriers la foulèveut enfuite
-avec deux grands cifeaux en fer; un troisième.la
reçoit avec un inftrument également en fer, ayant
la forme d’une fourche à deux pointes , qu’il introduit
entre la croûte & le bain, & l’en train e juf-
qu’au bord de la coupelle, d’où deux autres ouvriers
l’aident à l’enlever avec un levier qu’ils placent
en croix par-deffous. Cette croûte eft ce qu’on
nomme une rejette.
Quand la première rofette eft enlevée , on en
forme de la même manière une fécondé, que l’on
•enlève également. On continue à opérer ainfi
juiqu’à ce que tout le cuivre foit réduit en rofettés,
â l’exception de la petite quantité qui refte au fond
des coupelles, que les ouvriers nomment le Roi, &
qu’on y laiffe refroidir. Les alchimiftes croyoient
que la matière première des métaux fe trouvoit
dans le roi, & ils i’employoient en conféquence
-dan§ les manipulations de leur grand oeuvre , dont
1 objet étoit, comme ôn fait, de faire de l’or.
Si, après avoir enlevé les rofettes de la coupelle,
on les plonge dans l’eau, elles acquièrent une belle
-couleur rouge ; & fi on les laiffe refroidir à l’air libre,
elles deviennent d’un rouge foncé: cette différence
provient, non de ce qii’iLy en a dans le degré
d’affinage des deux métaux, mais de ce que,
dans le premier cas , le r efroidiffement fubit qu’il
éprouvé , empêche que la furface ne s’oxide, & le
métal conferve fa couleur naturelle, tandis que dans
le fécond, la couche d’oxide qui fe forme à fa furface
la mafque & ne laiffe à découvert que la couleur
de cét oxide.
On ne fauroit prendre trop de foin & de précau-
tion pour la formation des rofettes. Si les ouvriers
les enlevent avant qu’elles aient affez de confif-
tànce, & qûé l’eau avec laquelle on les arrofe foit
entièrement évaporée, elles fe brifent en mor-
eeaux qui, en tombant dans le bain, y mtroduifent
de l’eau. Alors cét te eau, réduite trop fubilement
en vapeur, produit une explofion terrible, & lance
avec la plus grande violence les morceaux de rofette
encore rouges contre les murs, dans lefquels
ils s’incruftént : l’atelier fe remplit alors d’une
pluie de ^cuivre fondu, & les affiftans courent le
Ranger d’etre bleffés, & même d’y perdre la vie.
Le premier affinage que l ’on fait dans un fourneau
dont la foie eft néavej dure douEe à quinze
heures pôtir des cuivres de moyenne qualité; mais
comme cette première opération l’échauffe, la
durée n’eft plus que de huit à dix heures pour
chacune des charges buvantes.
Quand la brafque eft de bonne qualité-, que la
foie eft bien faite & que le cuivre' contient peu de
matières fondantes, on peut faire fix à huit affinages
corifécutife fans renouveler la foie; mais fi
1 une ou l’autre dé ces conditions n’a pas lieu, elle
doit être renouvelée plus fouvent. Dans tous les
cas, il faut vifiter la foie apres chaque affiriage, &
fi l’on voit que quelques-unes de fes parties fe
foient fendues ou exhaufféés ,vil faut la refaire à
heuf, lansrifqüer une autre opération, crainte que
la foie venant à fe fendre ou à s’exhauffer en totalité
, cela n’empêché de continuer l’opération. Les
ouvriers doivent être préparés à cet accident, qui
arrive quelquefois même dans les fonderies les
mieux dirigées. Dans ce cas ils doivent percer le
fourneau plus bas que le trou ordinaire, pour
donner fortie au cuivre, parce qu’aut-réinent on
feroit obligé de le démolir & de faire d’autres dé-
penfes que l’on peut éviter par ce moyen.
Lorfque le premier affinage eft fini, on nettoie
bien le canal de fortie pour ôtér le cuivre qui pour-
roi t s’être attaché aux parois; on le rebouche
enfuite avec de la brafque neuve que l ’on preffe
en dehors; enfin^ on recharge le fourneau, on y
met le feu & on répété toutes les opérations qu ou
vient de décrire, jufqu’à cé que le cuivre ait acquis
le degré de pureté qu’on déliré.- 1
Les feories des deuxième , troifième, & c ., affinages
faits fur une même foie font plus abondantes
que celles qui proviennent des premières quand
celle-ci eft neuvé; cela vieUt, non de ce que le
cuivre jette une plus grande quantité de matières
hétérogènes dans les derniers affinages, puifqu’il
s’en dépouillé également dans tous les cas, mais
bien dé ce que, dans les premiers, le fourneau
é'tant propre & la brafque neuve, les matières qui
les compofent, réfiftent davantage à la vitrification
* ce qui ne peut avoir lieu dans les affinages
fuivans, à caufe de la chaleur quelles ont déjà
éprouvée & des matières fondantes qui font incorporées
avec elles; d’où il fuit que ces feories fe
compofent prefqu’entièrement de terres des briques
de la voûté du fourneau & de celles de la
brafque qui fe vitrifient.
On peut, par les procédés qu’on vient de dé4
crire, donner le même degré de pureté à tous les
cuivres; il n y en a aucun, quelquimpur qu’il foit,
qui puifl'e y réfîfter quand ils font bien entendus &
bien exécutés.
Lorfque, parmi lés Cuivrés que l’on affine, il fe
trouve quelques lingots de très-mauvaife qualité,
il eft avantageux de lés en féparer; un ou deux
d’entr’eux gâterdiént toute une charge, & feroient
alonger l’opération. Il faut donc les mettre à part
& les affiner féparément, quand il y en a une
quantité fuffifanle pour en compofer une charge*
|I y a d’ailleurs plus d’économie à traiter ainfi ces
lingots, qu’à les répartir dans l.es: autres charges.
Nötige fur les batteries de cales. La defenfe
des côtes par les batteries d’artillerie étan t d’une
haute importance, puifqu’elle a pour objet d’empêcher
les defeentes de l’ennemi., de prptégev le
commerce & les habitans, on croit utile de faire
mention, dans cé Diélionnaire, d’un mémoire
manuferit dugénéral Gri boa-uval Fur ces batteries ;
ce mémoire, fous la date de 1777, eft rédigé av.ee
la clarté & la, concifion qui . caraGérifent tous les
travaux de ce célèbre artilleur.
Nous-croyons qu’il convient d’établir des principes
qui ne font pas affez connus fur remplacement
des batteriçs décotes. Les boulets ricochent
mieux fur lJeau que fur la terre, & tous les ricochets
fous deux ou trois degrés, font perdre fort
peu de force aux gros boulets. Ceux de 24, fous
l’angle de quatre ou cinq degrés, confervent
encore plus-deforee qu’il n’en faut pour percer le
liane d’un vaiffeau, tel fort qu’il foit,à trois cents
toifeS & plus ; ainfi toute 'batterie qui, par fon peu
d’élévation, fera expofée à l’égout des ricochets
d’un vaiffeau , recevra tous les coups tr-aînans qui
lui feront encore ‘beaucoup de mal; & toute batterie
qui fera affez élevée-pour tirer à bonne portée
fur un vaiffeau , fous l’angle de quatre ou. cinq
degrés , lui fera tout le mal poffible, puifqtie les
boulets traînans de la batterie vont tous au vaiffeau;
mais ceux parlant du vaiffeau qui eft plus
bas que la batterie, ne pourront ricocher affe?
hautpour monter jufqu’à elle, fi elle a la hauteur
fuppofée.ci-deffoiîs.
Pour trouver la hauteur de la batterie qui aura
cet avantage, on obferyera que les boulets de
cette batterie devant toujours toucher l’eau.fous
l’angle de quatre à cinq degrés, vers cent toifes
de diftance, l ’éloignement du vaiffeau à la batterie
fera le finus total , & la hauteur de cette
batterie fera la tangente de l’angle de quatre à
cinq degrés; elle fe trouve de fept à neuf toifes,.
.Elevons donc, nos batteries de fept à. neuf toifes,
nous ricocherons bien & très-bien , vers cent
toifes, fur les vaiffeaux, fi nous les manquons de
plein fouet ; au lieu que les ricochets des vaiffeaux
qui ne. partent que d’une, deux ou trois toifes
d’élévation, ne peuvent monter à la batterie ;
alors nous avons tout l’avantagé fur les vaiffeaux ,
pttifqu’ils ne peuvent nous toucher que par le plein
fouet, & que nous aurons pour nous le*ricochet &
fe plein fouet : premier avantage. qui tourne à
notre profit toutes les-maladrefles, qui font bien
nombreufes en ce genre.
a uictcm xcj uvuuiagtx uc ubulx .
plein fouet fur le leur. Nous avons pour ;obj.et tou
fe corps du vaiffeau, & lui ne peut tirer profit qu<
des boulets qui paffent à un pied.& demi au-
deflus.de notre épaulement, puifque nos. pièce;
ne fe découvrent pas plus, & que la pièce couvre
la tête de l’homme qui la pointe, tout le r^efte du
fervice étant couyért par l’épaulemerrt ; ainfi le
vaiffeau , fur les trois toifes courantes de parapet,
n’aura pour objet que la pièce qui ne prélente
qu’un pied & demi de hauteur fur autant de largeur,
ou deux pieds carrés, pendant que nous
aurons plus de deux mille fept cents pieds pour
nous fur un vaiffeau fuppofé’ de cent cinquante
pieds de quille feulement, Tans comprendre les
; voilures, cordages & mâtures. On voit que ce
fécond avantage eft bien plus confîdérable que le
premier. Mais il en eft un troifième qui l’eft encore
bien plus, c’eft celui du pointage. Le canonnier
du vaiffeau, fous voiles, ne voit point fon
.objet, lorfqu’il donne là bailleur, il ne peut le
faire que par eftimation, & ayant pointé dans le
vagué de l’air, c’eft au moins le hafard de cent
contre un, s’il a rencontré la hauteur d’un pied
& demi que lui offrent les pièces, & fi, dans
le mouvement que fait le vaiffeau, il conferve ou
rencontre cette hauteur, puifqu’ime feule ligne-
de roulis dans .le vaiffeau la lui fait manquer; en
fuppofant cependant que le hafard le porte à
.cette hauteur, il n’y aura.encore quele douzième:
de fes coups qui toucheront, puifque les pièce»
n’oçcupent qu’un pied & demi,de fargeur fur trois-
toifes de longueur du parapet.
Concilions donc que le fon des vaiffeaux n’eft
dan gereux que quand, par .maladreffe, on s’ex—
pofé aux riçoehets de leurs boulets, & qu’il y a
plus de cinq cents à parier contre pn, que quand
on fe place, affez haut pour riçoçhgr A n’être point
ricoché, & qu’on a des affû.ts ^éle^qs qui permettent
de tirer au-d,effus d’un ép^uléipçnt de
cinq pieds, une batterie de quatre pièces de 1 6
ou de 24 aura toujours un avantage iminenfe-
fur un vaiffeau de çe.nt pièces , de tel calibre
que ce foit.
Qn croit inutile de dire à . d,es officiers d’artillerie
, qu’une batterie que les vaiffeaux peuvent
approcher à ç.ent toifes , ne,devant avoir que hu,it
toifes d’élévation, fi le vaiffeau ne doit approcher
qu’à deux cents toifes, elfe q>ept être élevée de-
douze à feize .toifes, fans perdre les avantage»
.du ricochet, & qne .fi le terrain entre la mer&j*
batterie forme un talus qui puifferelever les ricochets
du vaiffeau jufqu’à la batterie, il faut couper
ce talus çn une ou plufie,urs banquettes horizontales.
Il eft encore un préjugé qu’il eft effenliel
,d,e-détruire,.parce, que, tout faux qu’il eft, il répand
la terreur fur les ,côtes, ; c’eft que des vaiffeaux
rem^plfés peuvent rafer des forts. Cependant je
i;i§ban.de Dunkerque, a long-temps embarraffé le»
,Anglais ^ & leurs vaiffeaux ne l’ont point rafé.
X)aps le temps, la citadelle.du.fîâvre: & la tour
de l’entrée duport,ne l’on-t point été; les tours çle
nie Tatihou leur déplaifent depuis plufieurs fic-
çles ne l ’ont pas été non plus que les forts ;de-
Sainl-Miilo j.l.e qhjllç^adu .Taureau5 ceux de Bejc