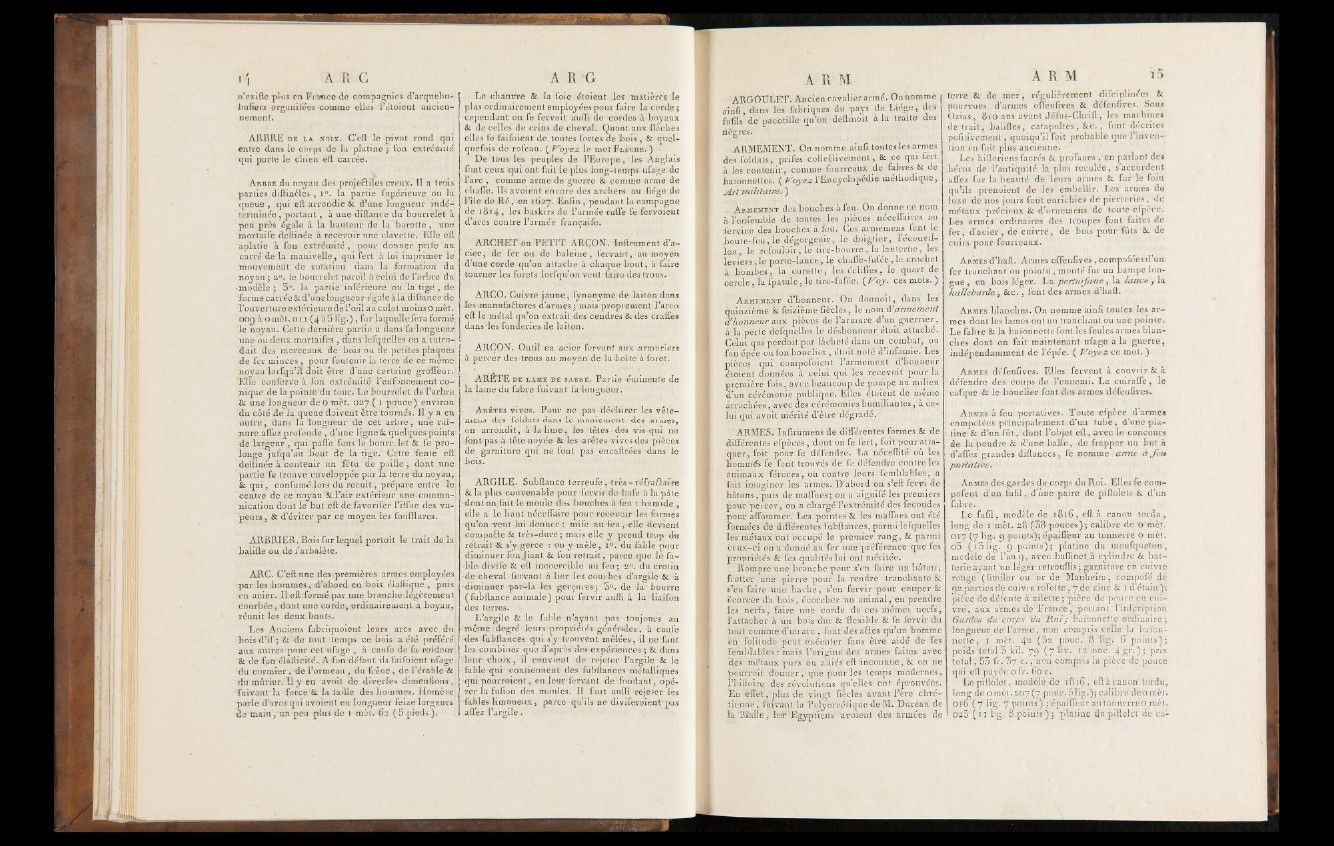
4 A R C
n’exifte plats en France de compagnies d’arquebu-
bufiers organises comme-elles l’étoieut anciennement.
ARBRE de la noix. C’eft le pivot rond qui
entre dans le corps de la platine 5 ton extrémité
qui porte le chien elt carrée.
Arbbe du noyau des projectiles creux. Il a trois
parties diftinâes , i°. la partie fupérieure ou la;
queue , qui eft arrondie & d’une longueur indé- '
terminée, portant, à une diflance du bourrelet à
peu près égale à la hauteur de la barette , une'
mortaife deftinée à recevoir une clavette. Elle eft
aplatie à fou extrémité , pour donner prife au
carré de la manivelle, qui fert à lui imprimer le;
mouvement de rotation dans la .formation du
noyau ; 20. le bourrelet pareil à celui de l ’arbre du
• modèle; 3°. la partie inférieure ou la lige , de
forme carrée & d’une longueur égale à la diftance de
l ’ouverture extérieure de l ’oeil au culot moimsomet.
009 à O mèt. 011 (4 à;5 lig.) , fur laqualleXera formé,
le noyau. Cette dernière partie a dans fadcmgueur
une ou deux mortaifes , dans'lofquelles on a introduit
des morceaux de bois ou de petites plaques: 1
de fer minces , pour fou tenir la terre de ce même
noyau lôrfqü’il doit être d une certaine groffeur.)
Elle conferve à Ion extrémité l’enfoncement conique
de la pointé du tour. Le bourrelet de l’arbre
& une'longueur de O met. 027( 1 pemee) environ
du côté de la queue doivent être tournés. Il y a en
outre, dans la longuear de cet ài’bre, une rainure.
affez ^profonde -,d’une ligne& qnelqu es points :
de largeur , qui pafl’e fous Le foonnvlet & fe prolonge
jufqu’ au .bout de la tige. Cette fente eft
deftinée à contenir un fétu de paille , dont une
partie fe trouve enveloppée par la terre du noyau,
& qui, confuméjors du recuit, prépare entre le?
centre de ce noyau & l’air extérieur une communication
dont le but eft dê favorrfer l’iffue des vapeurs,
& d’éviter par ce moyen les foufïlures.
ARBRIER,.Bois fur lequel portoit le trait de la;
balille ou.de i’arbalête.
ARC. C’eft une des premières armes ; employées;
par les .hommes,, ^d’abord en bois éiaftique., puis,
en acier. II.eft formé par une,'branche;légèrement;
courbée, dont une corde, ordinairement à boyau,
réunit les .deux.bouts.
Les Anciens fabriquoient leurs arcs avec du •
bois d’if ; & de tout temps ce bois a été préféré: |
aux autres ■ pour cet ù fage , à • ca-nfe de fa roideur
& de fon élafticité., A fou défaut, ils fai foie nt-u fage
du cormier , de l’ormeau , du frêne, de l’érable
du mûrier. Il y en a voit de diverles dimenflons,,'
fuivant la force'& la taille des hommes. Homère
parle d’arcs-qui avoient en longueur feize largeurs
4e main, un peu plus de 1 mèt. 62 ( 5 pieds ).
A R 'G
Le chanvre & la foie étoient les matières le
plus ordinairement employées pour faire la corde;
cependant on fe fervoit aufîi de cordes à boyaux
& de celles de crins de cheval. Quant aux flèches
elles le faifoient de toutes fortes de Lois , & quelquefois
de rofeau. {JVoyez le mot Flèche. )■
l)e tous les peuples de l’Europe, les Anglais
font ceux qui ont fait le plus long-temps ufage de
l’arc , comme arme de guerre & comme arme de
cliafle. Ils avoient encore des archers au liège de
l’île de Ré , en 1627. Enfin , pendant lu campagne
de 1814 » les baskirs de l’armée-tufle fe fer voient
d’arcs contre l’armée françaile.
ARCHET ou PETIT ARÇON. T nftrum en t d’acier,
de fer ou de baleine, fer van t , ' au moyen
d’une coa*de qu’on attache-à chaque bout :, à faire
tourner les forets lorfqu’on veut faire des trous.
ARCO. Cuivre jaune, fynonyme de laiton dans
les unéinufaôlures d’armes ; mais proprement l’arco
eft le métal qu’on ex trait-des cendres & des cratiès
dans les fonderies-de laiton.
ARÇON. Outil en acier fer van t aux armuriers
à percer des-trous au moyen de la boîte à foret.
ARETE de lame -de sabre. Partie -éminente de
la lame du fabre fuivant fa longueur.
A rê t e s vives. Pour ne pas déchirer les vêîe-
rnens des foldats dans le maniement des armes,
on arrondit , à la lime ,, les ‘testes des vis qui ne
font pas;à tête noyée & les arêtes vivesdes pièces
de garniture qui ne font pas encaftrées dans le
bois.
ARGILE. Subftance terreufe, ■ t rès - réfraü-aiVe
& la plus convenable pour fervir de bafe à la pâte
dont onfuit le moule des bouches à feu : humide",
elle a le liant néceflaire pour recevoir les-formes
-qu’on veut 1-ui donner : mife au feu, elle devient
compacte 81 très-dure; mais elle y "prend trop de
retrait •& s-y,gerce : on y mêle, i°. -du fable pour
diminuer fondant & fon retrait , parce que le fable
divife & eft incoercible au feu ; 29. du erolin
de cheval fervant à lier les couches d’argile & :à
diminuer par-là les gerçures-; -3°. de 'la- bourre
(fubftance animale) pour fervir aufîi à la liaifon
des terres.
L’argile & le fable n’ayant pas toujours au
même , degré -leurs 'propriétés générales', à eaufe
desfubftaaees qui,s’y trouvent mêlées, il ne faut
les combiner que -d’a-près' des expériences-; & dans
leur choix, -il convient de rejeter l’argrl-e 8t le
fable qui ‘contienneut des fubftances métalliques
quipouiToieul, enleur-fervaut de fondant, opérer
la fufion des moules. Il faut aufîi rejeter les
fables limoneux, parce qu’ils ne diviferoienfc pas
afl’ez l’argile.
A R M
ARGOULET. Ancien cavalier armé. On homme
ainfi, dans les fabriques du pays de Liéep, des
fufils de pacotille qu’on deftihoit à la traite des
jdègres.
ARMEMENT. On nomme ainfi toutes les armes
des foldats, prifes colleêlivement, &. ce qui fert
à lès contenir, comme fourreaux de Libres & de
baïonnettes. ( Voyez l’Encyclopédie méthodique.
Art militaire. )
A rmement des bouches a feu. Ôn donne çe nom
à l’eiifetnble de toutes les pièces néceffaires au
1er vice des bouches à feu. Ces arméniens font le
boute-feu , le dégorgeoir, le doigtier, l’écouvil-
lon, le refoule ir , le tire-bourre, la lanterne, les
leviers, le porle—lance, le chafl'e-lufee ,le crochet
à bombes, la . curette, les éclifîes, le quart de
cercle, la fpatule, le tire-fufée. ( Voy. ces mots. )
Armement" d’honneur. Oii donnoit, dans les
Quinzième & feizièmé fièolés, ’lé nom à-prmëriiènï ;
d’honneur aux pièces de l’armure d ’un guerrier,
à la perle defquelles le déshonneur é'toit attaché.
Celui qui perdoit par lâcheté dans un combat, ou
fon épée ou Ton bouclier -, étoit noie d’infamie. Lès
pièces qui compofoient l ’armement d’honneur
étoient données à celui qui les recevoit pour la
première fois, avec beaucoup de pompe au milieu
d’un cérémonie publique. Elles étoient de même
arrachées, avec des cérémonies humiliantes,'à celui
qui avoit mérité d’être dégradé.
ARMES. Inftramens de différentes formes & de
différentes efpèces , dont on fe fert, foit pour attaquer,
foit pour fe défendre. La nécëflîté'où les
hommés fe font trouvés de fe défendre contre lés
animaux fétoces, bu contre leurs femblables, a
fait imaginer les armes. D’abord on s’eft fervi de
bâtons , puis de raaffues; on a aiguifé les premiers J
pour percer, on a chargé l ’extrémité des fécondes
pour affommer. Les pointes %l les mafîues ont été
formées de différentes fubftaiïCes, parmi lefquelles
les métaux ont occupé ‘le premier rang, & parmi
ceüx-ci où a donné âu fer une préférence que fes
propriétés & fes qualités lui ont méritée.' •
Rompre une branche pour s’en faire un bâton,
frotter une pierre pôur la rendre tranchante &
s’ën faire une' hache, s’en fervir pour couper &
écorcer du bois, écorchër un animal, en prendre
les nerfs, faire une corde de ces mêmes nerfs,
l’attacher à un bois dur & flexible-& fe fetvir dü
tout comme d’un arc f ibntd'es a£les qu’un homme
én folilud'e peut exécuter fans être aidé dé fes
femblablés maïs l ’origine des 'armés faites avec
dps métaux purs ou alliés èft inconnue, & on ne
■ potfirbit donner, qTvë p'onr les temps modernës,
rhiftoire. des révolutions qu’ellëS ont éprouvées.
En effet, plus de vingt fiècles avant l’ère chrétienne
, fuivant la PolyoVc.éfique de M. Dureau de
la Malle, les' Egyptiens ' 1 a voi en t des armées de
A R M
terre & de mer, régulièrement difeiplinées &
pourvues d’armes oAenfives & défenfives. Sous
Ozias, 810 ans avant Jéfus-Chrift, les machines
de irait, baliftes, catapultes, & c ., font décrites
pofilivement -, quoiqu’il foit probable que l’invention
én foit plus ancienne-.
Les hiftoriens facrés .& profanes , en parlant des
héros dè l’antiquité la plus reculée, s accordent
affez fur la beauté de leurs armes & fur le foin
qu’ils prenaient de les embellir. Les armes de
luxe de nos jours font enrichies de pierreries, de
métaux précieux & d’orne mens de toutè efpère.
Les armes ordinaires des troupes font faites de
fer, d’acier, de cuivre, de bois pour fûts & de
cuirs pour fourreaux.
Armes d’baft. Armes offen.fi y es , compofées d’un,
fer tranchant ou pointu, monté fur un hampe longue
, en bois léger. La pertuifane > la lance y la
hallebarde.3 &.c., font des armes d’haû.
Armes blanches. On nomme ainfi toutes les armes
dont les lames ont un tranchant ou une pointe.
Le fabre & la baïonnette font les feules armes blanches
dont on fait maintenant ufage à la guerre,
indépendamment de l’épée. ( Voyez ce mot. )
Armes défenfives. Elles fervent à couvrir & à
i défendre des coups de l’ennemi. La cuiraflè, le
• eafque & le bouclier font des armes défenfives.
Armes:à feu portatives. Toute efpèce ■ d’armes
• compofées principalement d’un tube, d’une pla-
i fine & d’un fût., dont l ’objet eft., avec le concours
de la poudre & d’une balte, de frapper un but à
d’affez grandes diftances, fe nomme arme à Jeu
portative.
■ Armes des gardes du corps du Roi. Ell.esfe com-
pofent d’un fufil, • d’une paire de piftolets &: d’un
■ fabre.
Le fufil, modèle de 1816, eft à canon tordu,
long de"î mèt. 28 (58 pouces); calibre de o n>è|.
017 (7 lig. 9 points); épaiffeur au tonnerre O mèt.
o3 ( i 31ig. 9 points); platine du moùfqueton,
i modèle de l’an g , avec bafîinet.à cylindre & bat-
î'efiè avant un légèi* retrbufîis ; garniture en cuivré
rotigé (îimilor ou or de Manherm, compofé de
92.parti es dë cuivre rofet te ,7; de zinc & 1 d’étain)-;
pièce de déten te à ailette ; pièce de pouce eh cuivre1
, aux aimes d,é!jl'’ rabc‘è ,. portant ' lin(criplion
Gardés du corps du Roi ; baïonnette ordinaire;
longueur de l’arme , non compris celle la baïonnette,
1 mèt. 42'(52 pouc. 8 lig* G points);
poids total 5 leil. 79 (7 iiv. 12 ion'c. 4 gr. ) ; prix
total, 53 fr. 37 c . , non compris la pièce de pouce
qui eft payée O fr. 60 c.
Le piftolet, modèle de t8i6 , eft à canon’tordu,
long de o mèt. 207 (7 poucvfiîig.); calibre deomèt.
016 (7 lig. 7 points) ; épaiffeur an tonnerre o mèt.
oa5 ( u b g. 8 points )'■ ; platine du piftolet de ca