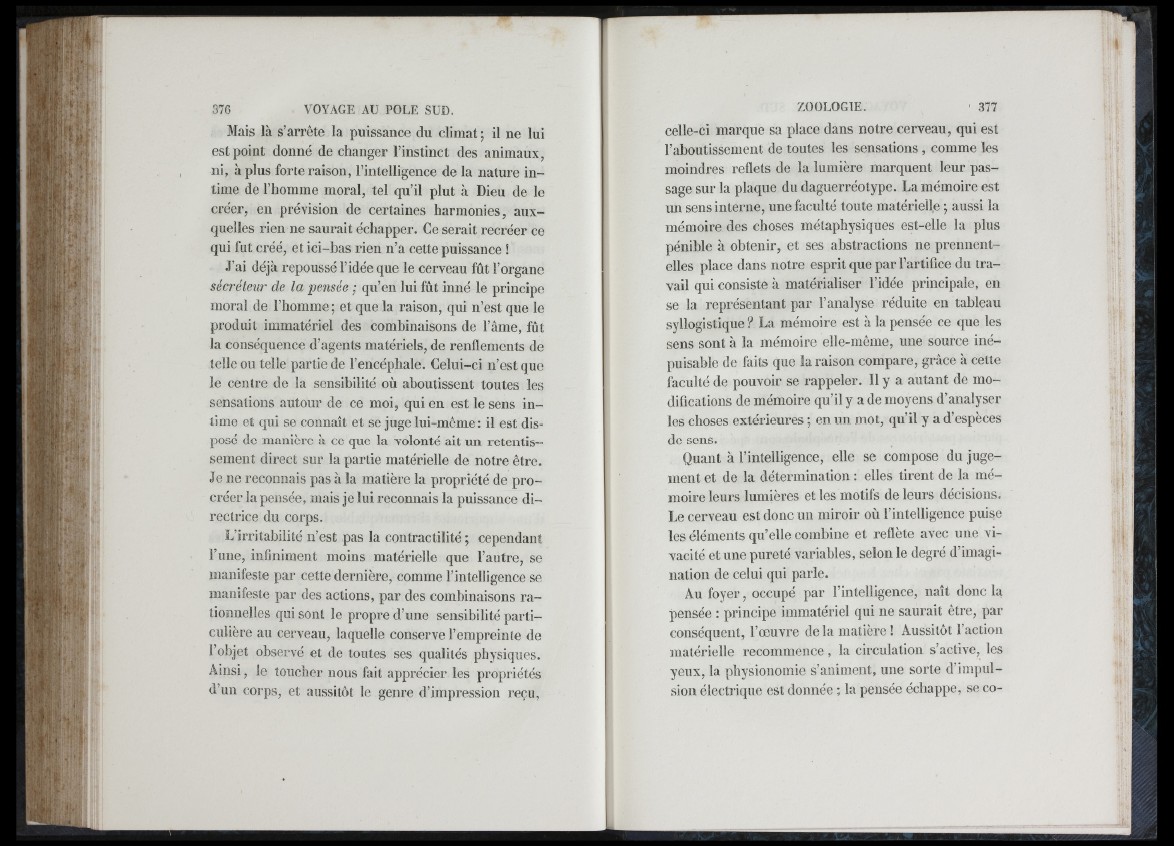
I
» J
liM ^
Mais là s’arrête la puissance du climat ; il ne lui
est point donné de changer l’instinct des animaux,
ni, à plus forte raison, l’intelligence de la nature intime
de l’homme moral, tel qu’il plut à Dieu de le
créer, en prévision de certaines harmonies, auxquelles
rien ne saurait échapper. Ce serait rec rée r ce
qui fut créé, et ici-bas rien n ’a cette puissance !
J’ai déjà repoussé l’idée que le cerveau fût l’organe
sécréteur de la pensée ; qu’en lui fût inné le principe
moral de Fliomme ; et que la raison, qui n ’est que le
produit immatériel des combinaisons de l’âme, fût
la conséquence d’agents matériels, de renflements de
telle ou telle partie de l’encéphale. Celui-ci n ’est que
îe centre de la sensibilité où aboutissent toutes les
sensations autour de ce moi, qui en est le sens in time
et qui se connaît et se juge lui-même: il est disposé
de manière à ce que la volonté ait un retentissement
direct sur la partie matérielle de notre être.
Je ne reconnais pas à la matière la propriété de p ro créer
la pensée, mais je lui reconnais la puissance directrice
du corps.
L’irritabilité n ’est pas la contractilité ; cependant
l’une, infiniment moins matérielle que l’autre, se
manifeste pa r cette dernière, comme l’intelligence se
manifeste par des actions, pa r des combinaisons ra tionnelles
qui sont îe propre d ’une sensibilité particulière
au cerveau, laquelle conserve l’empreinte de
l’objet observé et de toutes ses qualités physiques.
Ainsi, le toucher nous fait apprécier les propriétés
d ’un corps, et aussitôt le genre d ’impression reçu,
celle-ci marque sa place dans notre cerveau, qui est
l ’aboutissement de toutes les sensations , comme les
moindres reflets de la lumière marquent leur passage
sur la plaque du daguerréotype. La mémoire est
u n sens interne, une faculté toute matérielle ; aussi la
mémoire des choses métaphysiques est-elle la plus
pénible à obtenir, et ses abstractions ne pren n en t-
elles place dans notre esprit que pa r l’artifice du travail
qui consiste à matérialiser l’idée principale, en
se la représentant pa r l’analyse réduite en tableau
syllogistique ? La mémoire est à la pensée ce que les
sens sont à la mémoire elle-même, une source inépuisable
de faits que la raison compare, grâce à cette
faculté de pouvoir se rappeler. Il y a autant de modifications
de m émoire qu’il y a de moyens d ’analyser
les choses extérieures ; en un mot, qu’il y a d’espèces
de sens.
Quant à l’intelligence, elle se compose du jugement
et de la détermination : elles tirent de la mémoire
leurs lumières et les motifs de leurs décisions.
Le cerveau est donc un miroir où l ’intelligence puise
les éléments qu’elle combine et reflète avec une vivacité
et une pureté variables, selon le degré d’imagination
de celui qui parle.
Au foyer, occupé par l’intelligence, naît donc la
pensée : principe immatériel qui ne saurait être, par
conséquent, l’oeuvre de la matière ! Aussitôt l’action
matérielle re comme n c e , la circulation s’active, les
yeux, la physionomie s’animent, une sorte d’impulsion
électrique est donnée ; la pensée échappe, se coiJj.