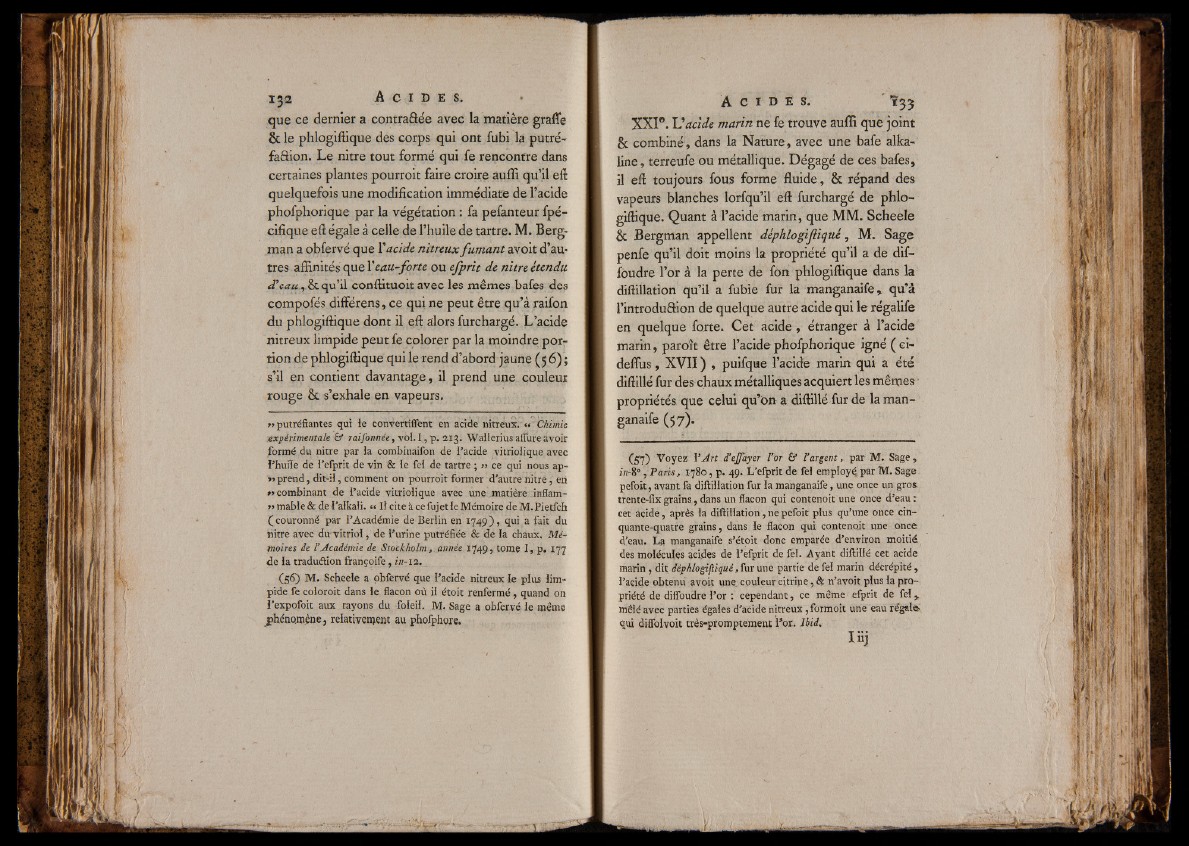
q u e ce dernier a contra âé e a ve c la matière grafle
& le phlogiffique des corps qui ont fubi la putré-
fa â ion . L e nitre tout formé qui fe rencontre dans
certaines plantes pourroit faire croire auiîi qu’il eft
quelquefois une modification immédiate de l’acide
phofphorique par la végétation : fa pefanteur fpé -
cifique eft égale à celle de l’huile de tartre. M . Bergman
a obfervé que l 'acide nitreux fumant avoit d’autres
affinités que Y eau-forte ou efprit de nitre étendu,
d’eau r& qu’il conffituoit avec les mêmes bafes des
compofés différens, c e qui ne peut être qu’à raifon
du phlogiffique dont il eft alors furchargé. L ’acide
nitreux limpide p eut fe colorer par la moindre portion
de phlogiffique qui le rend d’abord jaune (5 6) ;
s’il en contient da van tag e , il prend une couleur
roug e &. s’exhale en vapeurs.
>> putréfiantes qui Je convertiffent en acide nitreux. « Chimie
expérimentale &* raifomiée, vol. I , p. 213. Wailerius affure avoir
formé du nitre par la combinaifon de l ’acide vitriolique avec
ï ’huiïe de l’efprit de vin & le fel de tartre ; » ce qui nous ap-
» prend, dit-il, comment on pourroit former d’autre n itre , en
»»combinant de l’ acide vitriolique avec une ,matière .inflam-
>> mable & de l ’alkali. « Il cite à ce fuj et le Mémoire de M .Pietfch
if couronné par l’Académie de Berlin en 1 7 4 9 ) , qui a fait du
nitre avec du-vitriol, de l’ urine putréfiée & de la chaux. Mémoires
de l’Académie de Stockholm . année 1749» tome I , p. 177
de la traduétion françoife, in-12.
(56) M . Scheele a obfervé que l’ acide nitreux le plus limpide
fe coloroit dans le flacon où il étoit renfermé, quand on
l ’expofoit aux rayons du foleil. M. Sage a obfervé le m!m®
jjhénQHiène, relativement au phofphore.
X X P . Uacide marin ne fe trouve auifi que joint
& combiné', dans la N a tu r e , avec une bafe alkaline
, terreufe ou métallique. D é g a g é de ces bafes,
il eft toujours fous forme flu id e , & répand des
vapeurs blanches lorfqu’il eft furchargé de p h lo -
giftique. Quant à l’acide marin, que M M . S che e le
& Bergman appellent déphlogifiqué, M . S a g e
penfe qu’il doit moins la propriété qu’ il a de dif-
foudre l’or à la perte de fon phlogiffique dans la
diffillation qu’il a fubie fur la manganaife, qu’à
l’introduâion de quelque autre acide qui le ré g a life
en quelque forte. C e t a c id e , étranger à l’acide
marin, paroît être l’acide phofphorique igné ( ci-
d e flu s , X V I I ) , puifqae l’acide marin qui a été
diftillé fur des chaux métalliques acquiert les m êmes
propriétés que celui qu’o n a diftillé fur de la manganaife
( 5 7 ) .
(5 7 ) V o y e z l’ Art d’ejjayer For & l’argent, par M . Sage,
¿«-8°, Paris, 1780, p. 49. L ’efprit de fel employé par M . Sage
pefoït, avant fa diftiHation fur la manganaife, une once un gros
trente-fix grains, dans un flacon qui contenoit une once d’ eau :
cet açide, après la diftiHation, ne pefoit plus qu’une once cinquante
quatre grains, dans le flacon qui contenait une once
d’eau. La manganaife s’ étoit donc emparée d’ environ moitié
des molécules acides de l ’ efprit de fel. Ayant diftillé cet acide
matin, dit déphlogifiqué, fur une partie de fel marin décrépité,
l’acide obtenu avoit une. couleur c jtriiie, & n’avoit plus la propriété
de diffoudre l ’or : cependant, ce même efprit de f e l ,
mêlé avec parties égales d’acide nitreu x, formoit une eau régale
qui diffolvoit très-promptement l’ or. Ihid.
I i i j