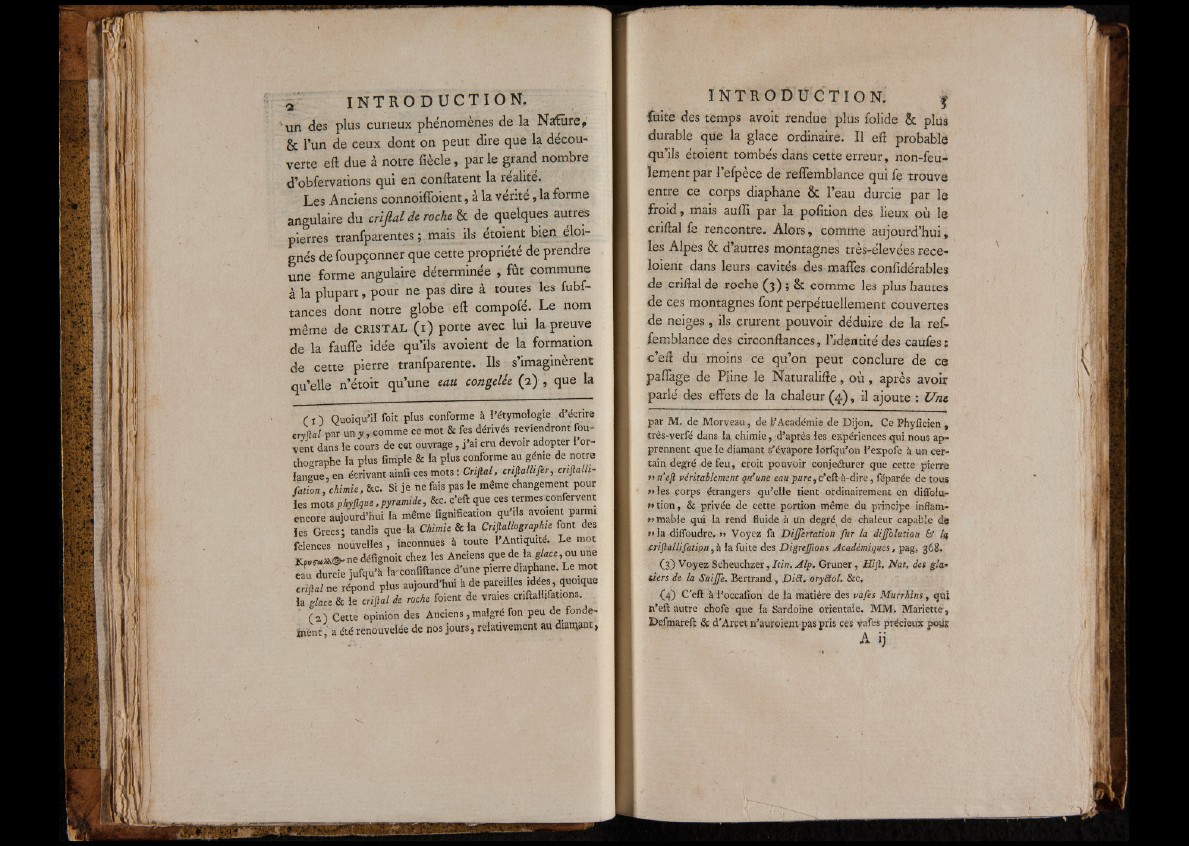
un des plus curieux phénomènes de la Nature,
& l’un de ceux dont on peut dire que la découverte
eft due à notre fiècle, par le grand nombre
d’obfervations qui en confiaient la réalite.
Les Anciens connoifïbient, a la vente, la forme
angulaire du enfla! de roche & de quelques autres
pierres tranfparentes ; mais ils étoient bien éloignés
de foupçonner que cette propriété de prendre
une forme angulaire déterminée , fût commune
à la plupart, pour ne pas dire à toutes les fubf-
tances dont notre globe eft compofé. Le nom
même de C R IS T A L ( i ) porte avec lui la preuve
de la fauffe idée qu’ils avoient de la formation
de cette pierre trasparente. Ils s’imaginèrent
qu’elle n’étoit qu’une eau congelée (a) , que la
r n Quoiqu’ il foit plus conforme à i ’ étymologie d’ écrire
tryftal par un y , -comme ce mot & fes dérivés reviendront fou-
vent dans îe cours de cet ouvrage, j ’ai cru devoir adopter l’ orthographe
fa plus finiple & fa pfus conforme au génie de notre
langue, en écrivant ainfi ces mots : Criftal, criftaltifer, criftallt-
fation, chimie, &c. Si je ne fais pas fe même changement pour
fes motsphyfique,pyramide, &c. c’eft que ces termes confervent
encore aujourd’hui fa même figmfication qu’ ifs avoient parmi
les Grecs: tandis que -fa Chimie & fa Criftallographie font des
feiences nou ve ffe s, inconnues à toute f’Antiquité. L e mot
JHûvçue&Çr ne défignoit chez fes Anciens qpedesfa glace,ou une
eau durcie iufqu’h la 'c o n fia n c e d’une pierre diaphane. Le mot
S c T n e répond plus aujourd’ hui à de pareilles idées quoique
ïa glace & fe enfiai de roche foient de vraies criftafhfations.
' Cette opinion des A n cien s , malgré fon peu de fonde-
ïn èn t, a été renouvelée de nos jou rs , relativement au diamant,
fuite des temps avoit rendue plus folide & plus
durable que la glace ordinaire. Il eft probable
qu’ils étoient tombés dans cette erreur, non-feulement
par l’efpèce de reffemblance qui fe trouve
entre ce corps diaphane & l’eau durcie par le
froid, mais auffi par la pofition des lieux où le
criftal fe rencontre. Alors, comme aujourd’hui,
les Alpes & d’autres montagnes très-élevées rece-
loient dans leurs cavités des maffes. confidérables
de criftal de roche (3) ; & comme les plus hautes
de ces montagnes font perpétuellement couvertes
de neiges, ils crurent pouvoir déduire de la ref-
femblanee des circonftances, l’identité des caufes ;
c ’eft du moins ce qu’on peut conclure de ce
pairage de Pline le Naturalifte, o ù , après avoir
parlé des effets de la chaleur (4), il ajoute ; Une
par M . de Morveau, de ^’Académie de Dijon. Ce Phyficien ,
très-verfé dans fa chimie, d’ après fes expériences qui nous apprennent
que le diamant s’ évapore îorfqu’ on f’ expofe à un certain
degré de feu , croit pouvoir conjedurer que cette pierre
» n'eft véritablement qu'une eau pure, c’ efl-à-dire, féparée de tous
»»les corps étrangers qu’elle tient ordinairement en diffofu-
»♦tion, & privée de cette portion même du principe inflam-
r> mabfe qui fa rend fluide à un degré, de chaleur capable de
»» la diifoudre. »* Voyez fa DiJJertation fur la dijfolution 6' /<j
c r i f la l li fa t io n fa fuite des Digrejftons Académiques, pag, 368.
( 3) Voyez Scheuchzer, Itin. Alp. Gruner, Hift, fiat, des g'a*
tiers de la Suijfe. Bertrand > Diêt. oryStol. &c,
(4 ) C'eft à l’occafion de fa matière des vafes Murrhins, qui
n*eft autre chofe que fa Sardoine orientafe, M M . Mariette,
Defraareft & d'A rcetn ’auroient pas pris ces vafes précieux peut
A i j