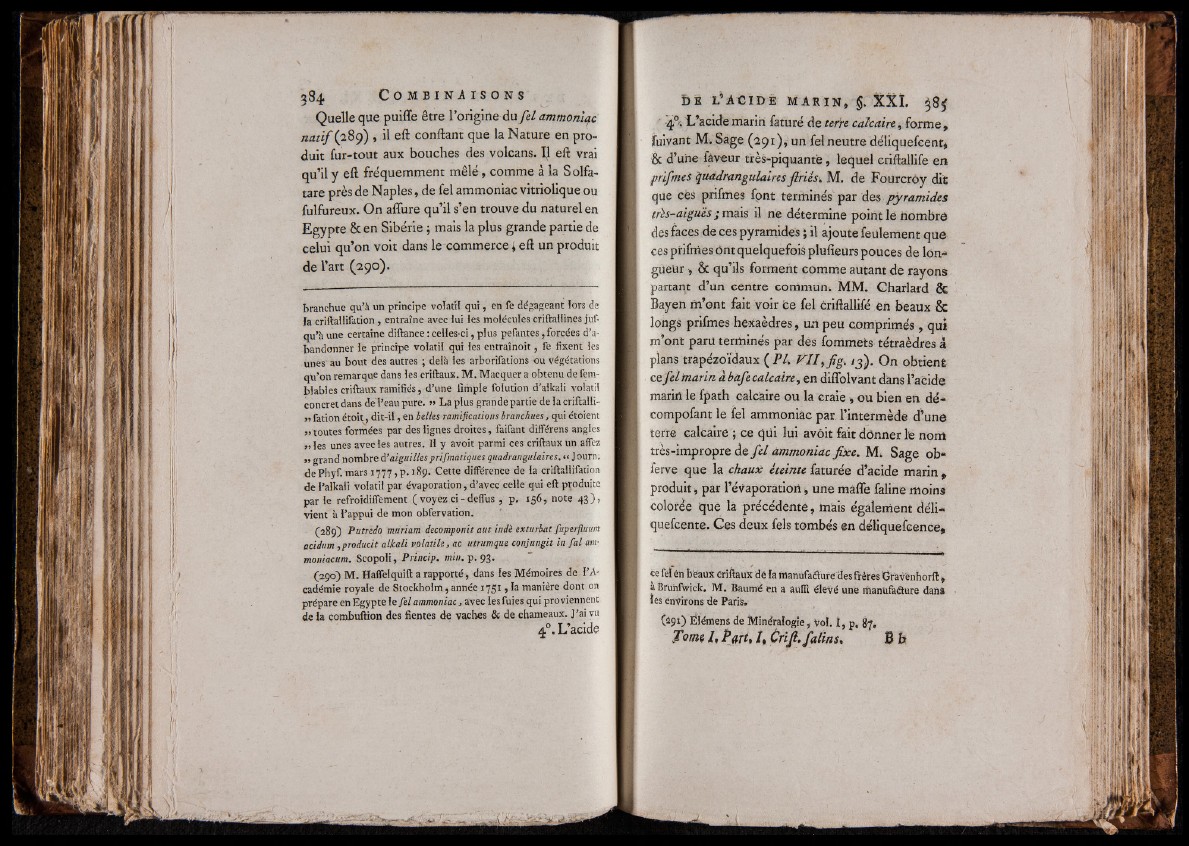
384 C o m b i n a i s o n s
Quelle que puiffe être l’origine du/è/ ammoniac
natif (289) , il eft confiant que la Nature en produit
fur-tout aux bouches des volcans. Ç eft vrai
qu’il y eft fréquemment mêlé, comme à la Solfatare
près de Naples, de fel ammoniac vitriolique ou
fulfureux. On affure qu’il s’en trouve du naturel en
Egypte &en Sibérie ; mais la plus grande partie de
celui qu’on voit dans le commerce ( eft un produit
de l’art (290).
branchue qu’ à un principe volatil q u i, en fe dégageant io n de
la criftaüifation, entraîne avec lux les molécules criftaüines juf-
au’ à une certaine diftance : celles-ci, plus pefantes, forcées d’ abandonner
le principe volatil qui les entraînoit, fe fixent les
unes’ au bout des autres ; delà les arborifations ou végétations
qu’on remarque dans les criftaux. M . Macquer a obtenu de fem-
biables criftaux ramifiés, d’une fimpïe folution d’alkaii volatil
concret dans de l’eau pure. » La plus grande partie de la criftaili-
« fation é toit, d it- il, en belles ramifications branchues, qui étoient
« toutes formées par des lignes droites, faifant différens angles
« le s unes avec les autres. II y avoir parmi ces criftaux un affez
« trrand nombre à’ aiguillesprifmadques quadrangulaires. « J ourn.
dePhyf.mars 17 7 7 ,p. 189. Cette différence de la criftaüifation
de l’ alkali volatil par évaporation, d’avec celle qui eft produite
par le refroidilfement ( voyez ci - deflus , p . 156, note 43) ,
vient à l’ appui de mon obfervation.
(289) Putredo muriam decomponit aut indè exturbat fuperfluum
acidum, producit alkali volatile, ac utrumque conjungit in fiai am-
moniacum. Scopoli, Princip. min.-p. 93.
(290) M . Haffelquift a rapporté , dans les Mémoires de l’Académie
royale de Stockholm, année 1751, la manière dont on
prépare en Egypte le fe l ammoniac, avec les fuies qui proviennent
de la çombuftion des fientes de vaches & de chameaux. J’ai vu
40. L’acide
Ï)E L*ACIDË MARIN, §. X X Ï . $8*
■ 4°. L’acide marin faturé de terre calcaire, forme ,
fuivant M. Sage (291), un fel neutre déliquefeent*
& d’une faveur très-piquante, lequel eriftallife en
prifmes quadrangulaires fries. M. de Foürcrôy dit
qüe ces prifmes font terminés par des pyramides
très-aiguës ; mais il ne détermine point le nombre
des faces de ces pyramides ; il ajoute feulement qüô
ces prifmes ônt quelquefois plufieurs pouces de Ion*
gùeür , & qu’ils forment comme autant de rayons
partant d’un centre commun. MM. Gharlard 8e
Bayen m’ont fait voir ce fel eriftallife en beaux &
longs prifmes hexaèdres, un peu comprimés , qui
m’ont paru terminés par dès fommets tétraèdres à
plans trapézoïdaux ( Pl. K I f f ig . if). On obtient
ce fe l marin à bafe calcaire, en diffolvant dans l’acide
marin le fpath calcaire ou la craie, ou bien en dé*
compofant le fel ammoniac par l’intermède d’une
terre calcaire ; ce qui lui avôit fait dônner le nom
très-impropre de fe l ammoniac fine. M. Sage ob-
ferve que la chaux ¿teinte faturée d’âeide marin ,
produit, par l’évaporation, une mâffe faline moins
colorée que la précédente ? maïs également déli-
quefeente. Ces deux fels tombés en déliquefcence,
ce fel én b'eaüX criftaux dé la rnanufaâure des frères Gravenhorft »
à Brunfwick. M . Baumé en a âiiffi élevé une manufaélure dans
les environs de Paris.
(291) Ëlémens de Minéralogie, Vol. 1, p. 87,
Tome I, Part, /, Crif. faims, 8 h
«