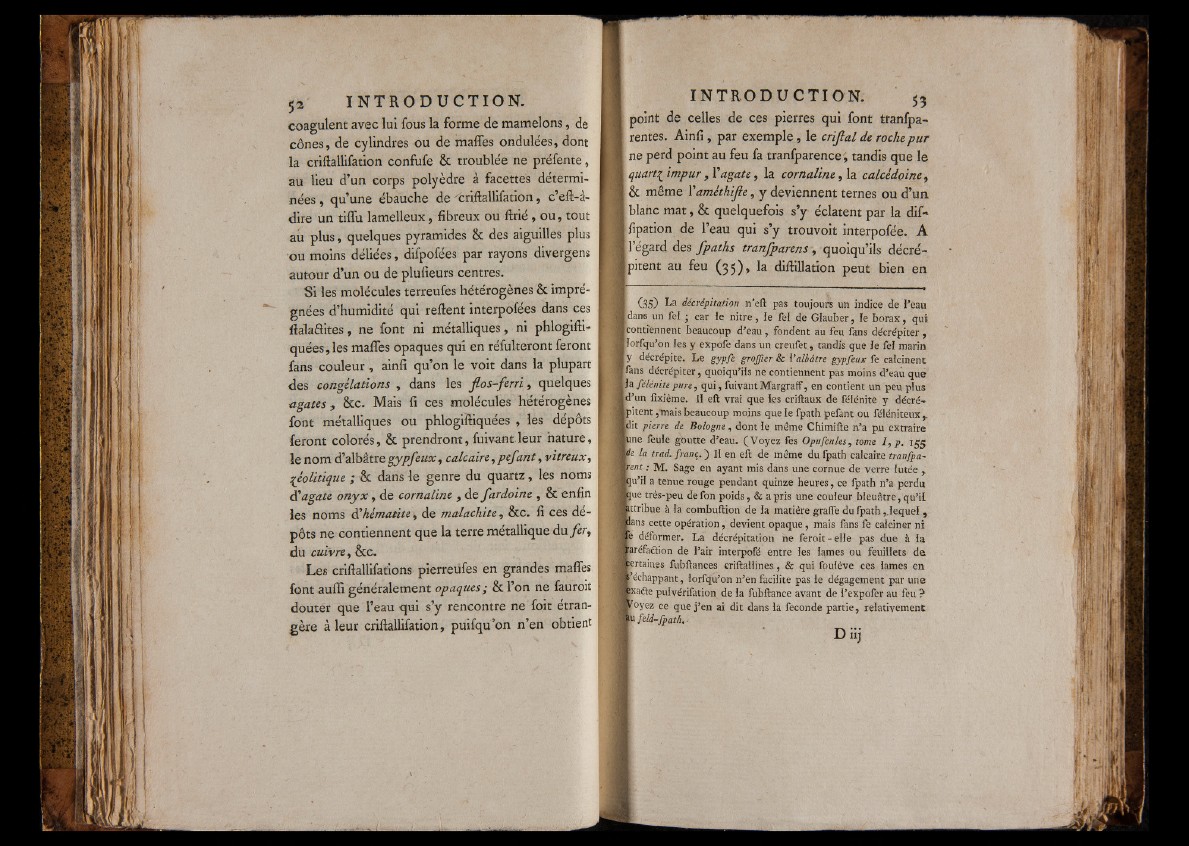
coagulent avec lui fous la forme de mamelons, de
cônes, de cylindres ou de maffes ondulées, dont
la criftallifation confufe & troublée ne préfente,
au lieu d’un corps polyèdre à facettes déterminées
, qu’une ébauche de 'triftallifation, c’eft-à-
dire un tiffu lamelleux, fibreux ou ftrié, ou, tout
au plus, quelques pyramides & des aiguilles plus
ou moins déliées, difpofées par rayons divergens
autour d’un ou de plufieurs centres.
Si les molécules terreufes hétérogènes & imprégnées
d’humidité qui reftent interpofées dans ces
iialaâites, ne font ni métalliques, ni phlogifti-
quées,les maffes opaques qui en réfulteront feront
fans couleur, ainfi qu’on le voit dans la plupart
des congélations , dans les flos-ferri, quelques
agates, Scc. Mais fi ces molécules hétérogènes
font métalliques ou phlogiftiquées , les dépôts
feront colorés, & prendront, fuivant leur nature,
le nom d’albâtrégypfttik,- calcaire, pefant, vitreux,
léolitique ; 8c dans le genre du quartz, les noms
d’agate onyx, de cornaline , de fardoine , & enfin
les noms d’hématite, de malachite, &c. fi ces dépôts
ne contiennent que la terre métallique du fer,
du cuivre, &c.
Les criftallifations pierreüfes en grandes maffes
font auifi généralement opaques; & l’on ne fauroit
douter que l’eau qui s’y rencontre ne foit étrangère
à leur criftallifation, puifqu’on n’en obtient
I point de celles de ces pierres qui font tranfpa-
I rentes. Ainfi, par exemple, le crijlal de roche pur
I ne perd point au feu fa tranfparence ; tandis que le
Mquart{ impur , Y agate, la cornaline, la calcédoine,
K & même Yaméthijle, y deviennent ternes ou d’ua
I blanc mat, & quelquefois s’y éclatent par la dif»
■fipation de l’eau qui s’y trouvoit interpofée. A
■l’égard des fpaths tranfparens, quoiqu’ils décré-
■pitent au feu (35), la diftillation peut bien en
(35) La décrépitation n'eft pas toujours un indice de Peau
■dans un fei • car le nitre, le fei de Giauber, le borax, qui
■contiennent beaucoup d'eau, fondent au feu fans décrépiter ,
■iorfqu’on les y expofe dans un creufet, tandis que le fei marin
■y décrépite. Le gypfe g ro ß e r & {’albâtre gypfeux fe calcinent
■fans décrépiter, quoiqu’ils ne contiennent pas moins d’eau que
«Ja fé lé ni te p u r e , qui, fuivant Margraif, en contient un peu plus
!™ d ’ un fixième. H eft vrai que les criftaux de félénite y décrépitent
,mais beaucoup mojns que le fpath pefant ou féiéniteux r
jdit pierre de Bolo g n e , dont le même Chimifte n’ a pu extraire
J u n e feule goutte d’ eau. (V o y e z fes Opufcules, tome I , p . 155
¡■de la trad. franç. ) Il en eft de même du fpath calcaire tranfpa-
w e / ;t ; M . Sage en ayant mis dans une cornue de verre lutée ,
■qu’il a tenue rouge pendant quinze heures, ce fpath n’a perdu
■que très-peu de fon poid s, & a pris une couleur bleuâtre, qu’il
jijattribue à la combuftion de la matière grade du ipath,.lequel ,
» a n s cette opération, devient opaque, mais fans fe calciner ni
¡■e déformer. La décrépitation ne fe ro it-e lle pas due à la
raréfaction de Pair interpofé entre les lames ou feuillets da
ce rtain e s fubftances criftallines, & qui foulève ces lames en
^■échappant, lorfqu’on n’ en facilite pas le dégagement par une
pulvérifation de la fubftance avant de Pexpofer au fe u ?
■ ° y e z ce que j ’en ai dit dans la fécondé partie, relativement
au feld-fpath. ■
D iij