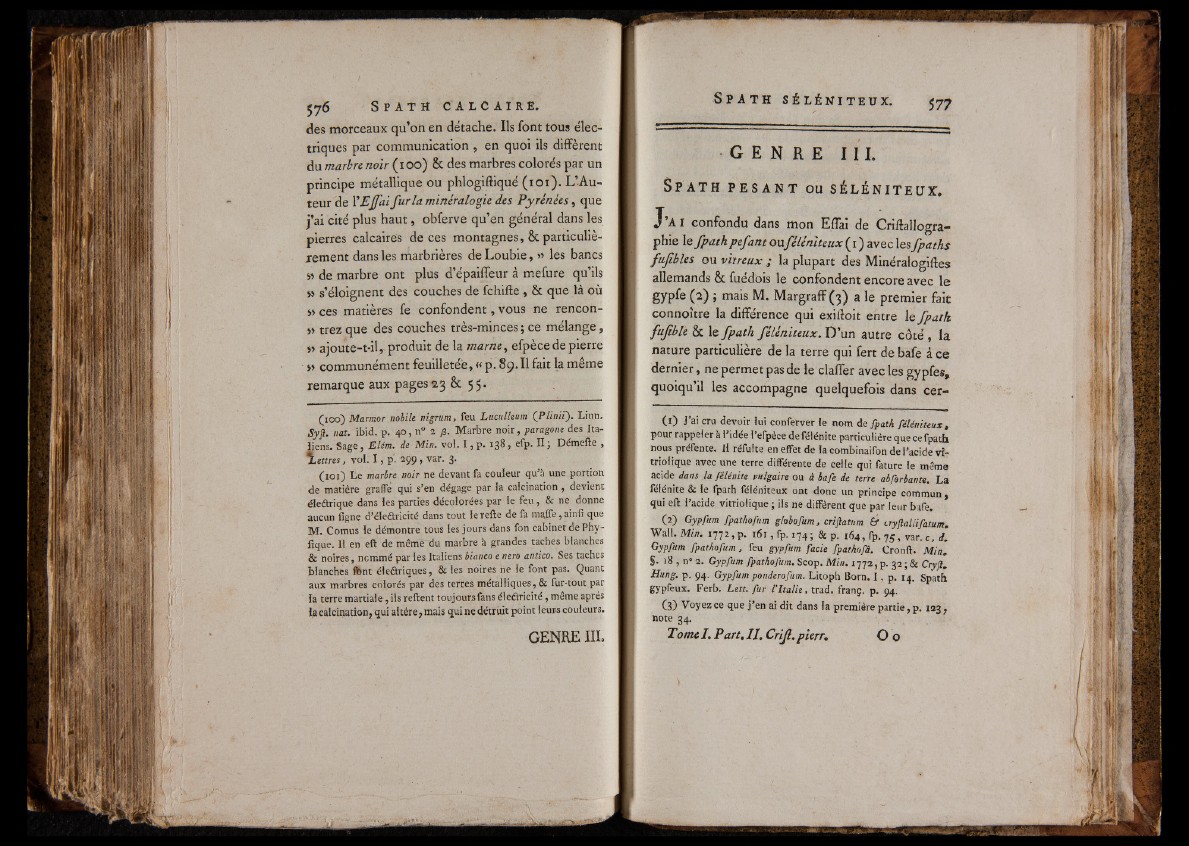
des morceaux qu’on en détache. Ils font tous électriques
par communication , en quoi ils diffèrent
du marbre noir (100) & des marbres colorés par un
principe métallique ou phlogiftiqué (101). L’Auteur
de VEjfai fur la minéralogie des Pyrénées, que
j’ai cité plus haut, obferve qu’en général dans les
pierres calcaires de ces montagnes, & particulièrement
dans les marbrières de Loubie, » les bancs
» de marbre ont plus d’épaiffeur à mefure qu’ils
» s’éloignent des couches de fchifte , & que là où
» ces matières fe confondent, vous ne rencon-
» trez que des couches très-minces ; ce mélange ,
» ajoute-t-il, produit de la marne, efpèce de pierre
» communément feuilletée, « p. 89.Il fait la même
remarque aux pages 23 & 55.
(100) Marmor nobile nigritm, feu Lucnlleum ( Plittii). Linn.
Syjl. nat. ibid. p. 40, n" 2 fi. Marbre n oir, paragone des Italiens.
Sage , E/An. de Min. vo l. I , p. 138, efp. I I ; Démette ,
Lettres vol. I , p. 299, var. 3.
(101) Le marbre noir ne devant fa couleur qu’ à une portion
de matière gratte qui s’en dégage par la calcination , devient
éleétrique dans les parties décolorées par ie fe u , & ne donne
aucun figne d’éleûricité dans tout lerefte de fa maffe,ainfi que
M . Cornus ie démontre tous les jours dans fon cabinet de Phy-
lique. Il en eft de même du marbre à grandes taches blanches
& noires, nommé par les Italiens bianco e nero antico. Ses taches
blanches ft>nt éleétriques, & les noires ne le font pas. Quant
aux marbres colorés par des terres métalliques, & fur-tout par
la terre martiale, ils reftent toujours fans éleétricité, même après
ta calcination, qui a ltère, mais qui ne détruit point leurs couleurs.
GENRE III.
• G E N R E I I I .
S p a t h p e s a n t ou s é l é n i t e u x .
J ’A I confondu dans mon Effai de Criffallogra-
phie le fpath pefant onféléniteux ( 1 ) avec les fpaths
fujibles ou vitreux ; la plupart des Minéralogiftes
allemands & fuédois le confondent encore avec le
gypfe (2) ; mais M. Margraff (3) a le premier fait
connoître la différence qui exiftoit entre le fpatk
fufible & \Qfpath féléniteux. D’un autre côté, la
nature particulière de la terre qui fert de bafe à ce
dernier, ne permet pas de le claffer avec les gypfes,
quoiqu’il les accompagne quelquefois dans cer-
( 1 ) J'ai cru devoir lui conferver le nom de fpatk féléniteux,
pour rappeler à l’ idée l’efpèce de félénite particulière quecefpath
nous préferne. Il réfulte en effet de fa combinaifon de l’ acide vî-
triolique avec une terre différente de celle qui fature le même
acide dans la félénite vulgaire ou à bafe de terre abforbante. La
félénite 8c le fpath iéléniteux ont donc un principe commun,
qui eft l’acide vitriolique ; ifs ne diffèrent que par leur bafe.
(2 ) Gypfum fpathofum globofum, criftatum & cryftallifatum.
Wall. Min. 17 72 , p. 16 1 , fp. 174 ; & p. 164, fp. 7 5 , var. c , i ,
Gypfum fpathofum, feu gypfum fade fpathofâ. Cronft. Min,
§. 18 , n° 2. Gypfum fpathofum. Scop. Min. 1772, p. 32;8cCryjl.
Hung. p. 94. Gypfum ponderofum. Litoph Born. I , p. 14. Spath
gypfeux. Ferb. Lett. fur l'I ta lie . trad. franç. p. 94.
(3 ) Voyez ce que j ’ en ai dit dans la première partie, p. 123,
note 34.
Tome I, Part, II. Crijl. pierr. O o