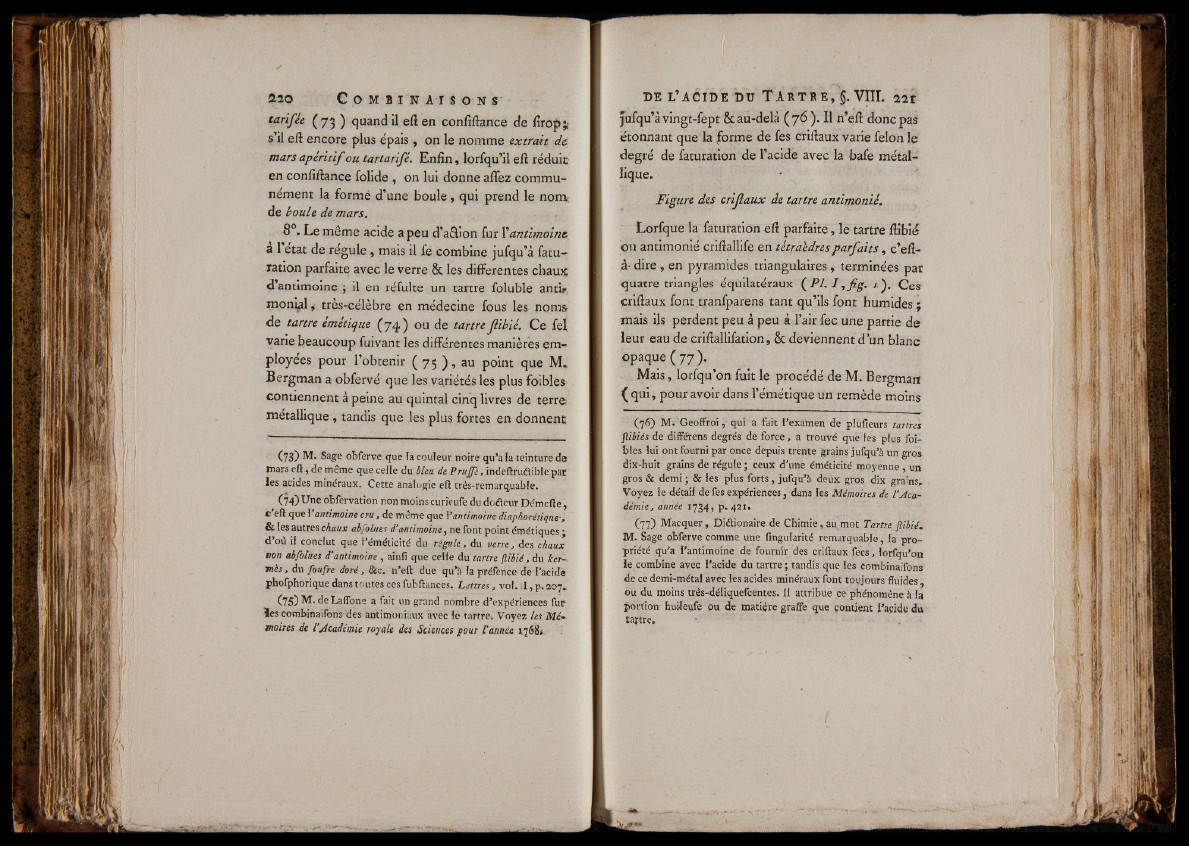
tarifée (73 ) quand il eft en coniïftance de firopÿ
s’il eft encore plus épais , on le nomme extrait de
mars apéritif ou tartarifé. Enfin, lorfqu’il eft réduit
en confiftance folide , on lui donne aflez communément
la formé d’une boule, qui prend le non*
de boule de mars.
8°. Le même acide a peu d’aâion fur l1antimoine
a 1 état de régulé, mais il fe combine jufqu’à fatu-
iation parfaite avec le verre 8c les différentes chaux
d’antimoine ; il en réfulte un tartre foluble antir
monial, tres-célèbre en médecine fous les noms
de tartre émétique (74 ) ou de tartre fiibié. Ce fel
varie beaucoup fuivant les différentes manières employées
pour l’obtenir ( 75 ) , au point que M.
Bergman a obfervé que les variétés les plus foibles
contiennent à peine au quintal cinq livres de terre
métallique, tandis que les plus fortes en donnent
( 73) M . Sage obferve que ïâ couleur noire qu’ a fa teinture de
mars e ft , de même que ceife du bleu, de Prtijfè, indeftruélible par
les acides minéraux. Cette analogie eft très-remarquable.
( 74) Une obfervation non moins curieufe du doéteur Démefte ,
c eft que 1 antimoine cru, de même que Vantimoine diaphorétique-,
& les autres chaux abfolues d’antimoine, ne font point émétiques ;
d ’où il conclut que i’ éméticité du régule, du verre, des chaux
non abfolues d'antimoine, aînfi que celle du tartre ftibié, du kermès,
du foufre doré, & c. n’ eft due qu’ à la préfence de l’acide
phofphorique dans toutes ces fubftances. Lettres, v o l. i l , p . 207.
( 75) M . de Laffone a fait un grand nombre d’expériences fur
le s combinaifons des antimoniaux avec le tartre. Voyez les Mémoires.
de l’Académie royale des Sciences pour l ’année 1768*.
DE L’ A C IDE DU T A R T RE, §. VIII. 22r
Jufqu’à vingt-fept 8c au-delà (76 ). Il n’eft donc pas
étonnant que la forme de fes criftaux varie félon le
degré de faturation de l’acide avec la bafe métallique.
Figure des crifiaux de tartre antimonié.
Lorfque la faturation eft parfaite, le tartre ftibié
ou antimonié criftallifé en tétraèdres parfaits, c’eft-
à- dire , en pyramides triangulaires, terminées par
quatre triangles équilatéraux (P L I ,f ig . /.). Ces
criftaux font tranfparens tant qu’ils font humides *
mais ils perdent peu à peu à l’air fec une partie de
leur eau de criftallifation, 8c deviennent d ’un blanc
opaque ( 7 7 ) .
Mais, lorfqu’on fuit le procédé de M. Bergman
( qui, pour avoir dans l’émétique un remède moins
(76) M . G eoffroi, qui a fait l’examen de plufieurs tartres
flibiés de différens degrés de fo rc e , a trouvé que fes plus foibles
lui ont fourni par once depuis trente grains jufqu’à un <ros
dix-huit grains de régule ; ceux d’une éméticité moyenne, un
gros & demi ; & les plus fo rts , jufqu’ à deux gros dix grains.
Vo y ez le détail de fes expériences, dans les Mémoires de l'Académie,
année 1734, p. 421,
(7 7 ) Macquer, Diâionaîre de Chimie, au mot Tartre ftibié.
M . Sage obferve comme une fmgularité remarquable, la propriété
qu’a l’antimoine de fournir des criftaux fecs , lorfqu’ on
le combine avec l’acide du tartre ; tandis que les combinaifons
de ce demi-métal avec les acides minéraux font toujours fluides ,
ou du moins très-déliquefcentes. Il attribue ce phénomène à fa
portion huileufe pu de matière graffe que contient i’açide du
tartre.