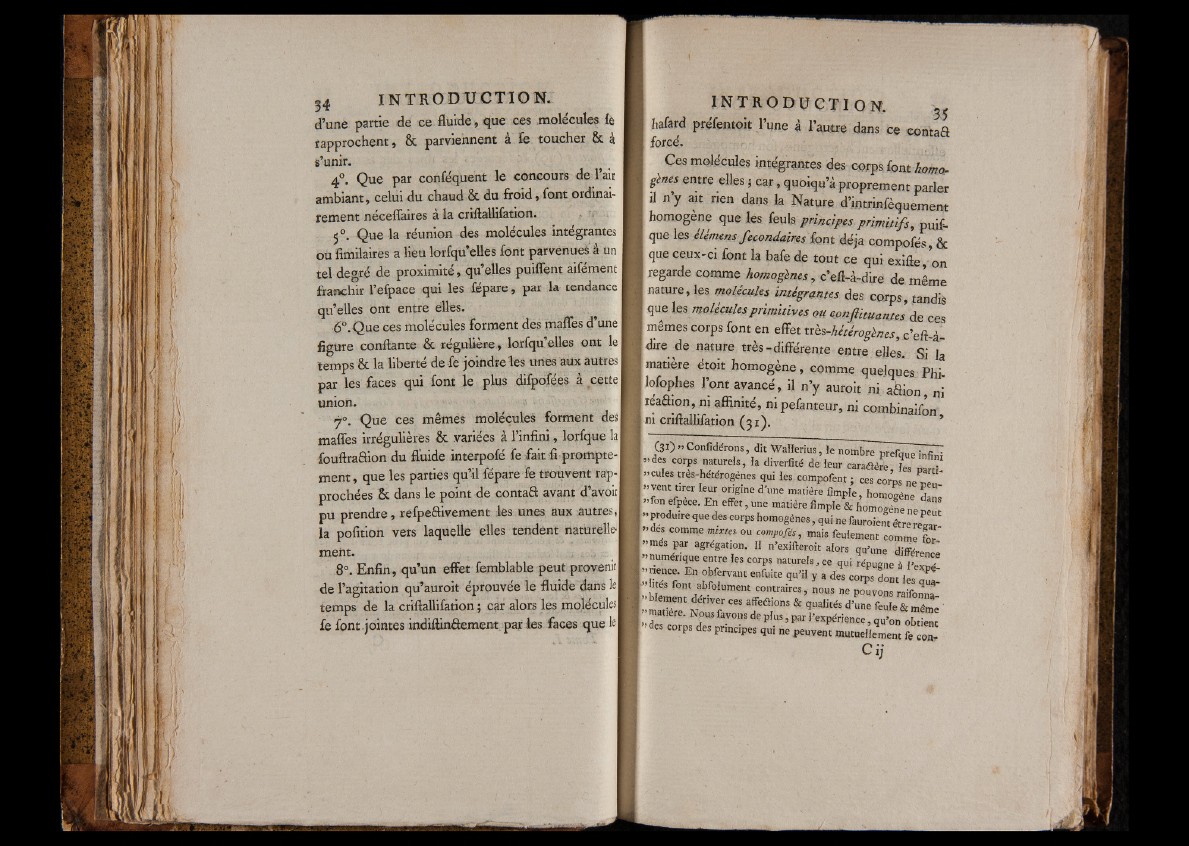
34 I N T R O D U C T I O N *
d’une partie de ce fluide, que ces molécules le
rapprochent, & parviennent à fe toucher & à
s’unir.
4°. Que par conféquent le concours de l’air
ambiant, celui du chaud 8t du froid, font ordinairement
néceffaires à la criflallifation.
50. Que la réunion des molécules intégrantes
ou iimilaires a lieu lorfqu’elles font parvenues à un
tel degré de proximité, qu’elles puiffent aifément
franchir l’efpace qui les fépare, par la tendance
qu’elles ont entre elles.
6°. Que ces molécules forment des mafTes d’une
figure confiante & régulière , lorfqu’elles ont le
temps & la liberté de -fe joindre les unes aux autres
par les faces qui font le plus difpofées à cette
union.
7°. Que ces mêmes molécules forment des
maffes irrégulières & variées à l’infini , lorfque la
fouftraftion du fluide interpolé fe fiait fi promptement,
que les parties qu’il fépare fe trouvent rapprochées
& dans le point de contaâ avant d’avoir
pu prendre, refpeâivement lés unes aux autres, I
la pofition vers laquelle elles tendent naturellement.
8°. Enfin , qu’un effet femblable peut provenir
de l’agitation qu’auroit éprouvée le fluide dans le
temps de la criflallifation ; car alors les molécules I
fe font jointes indifiinüement par-les faces que le I
I tekrd préfentoit l’une à l’autre dans ce contaS
I forcé.
Ces molécules intégrantes des corps font homo-
I gènes entre elles ; car, quoiqu’à proprement parler
I nV rien da°s la Nature d’intrinfèquement
I homogène que les feuls principes primitifs, puifi-
I que les elemens fecondaires font déjà compofés, &
I que ceux-ci font la bafe de tout ce qui exifie on
■ regarde comme homogènes, c’efi-à-dire de même
I nature, les molécules intégrantes des corps, tandis
■ que les molécules primitives ou oonftituantes de ces
■ mêmes corps font en effet très -hétérogènes, c’eft-i-
I dire de nature très-différente entre elles. Si la
I matière étoit homogène, comme quelques Phi.
■ lofophes 1 ont avancé, il n’y auroit ni aâion, ni
lieaâion, ni affinité, nipefanteur, ni combinaifon
■ ni criflallifation (31). *
(3 1 ) »Confidérons, dit Wallerius, le nombre prefque infini
J » d e s corps naturels, la diverfité de leur caraétère, fes J ?
■ »cules tres-hélérogènes qui les compofent ; ces corps ne üeT
1 » vent tirer leur ongine d'une matière fimple, homogène d Z
f f° " efpece- E » effet »une matière Ample & homogène ne peu
produire que des corps homogènes, qui ne fauroient être reg-ar
■ «dés c o m m e ou compofés, mais feulement c om m u e r
:” més Par agrégation. II n'exifteroic alors qu’une difl£L
«numérique entre les corps naturels, ce qui répugne à i ï
y n en c e . En obfervant enfuite qu'il y a des corps dont les q L -
: h és font abfolument contraires, nous ne pouvons nuTonnt
’ lement dériver ces affeâions & qualités d’une feule & même
L at!ere> Nous fayous de p lu s, par l'expérience, qu’on obtient
s corps des principes qui ne peuvent mutuellement fe ctmr
Ci}