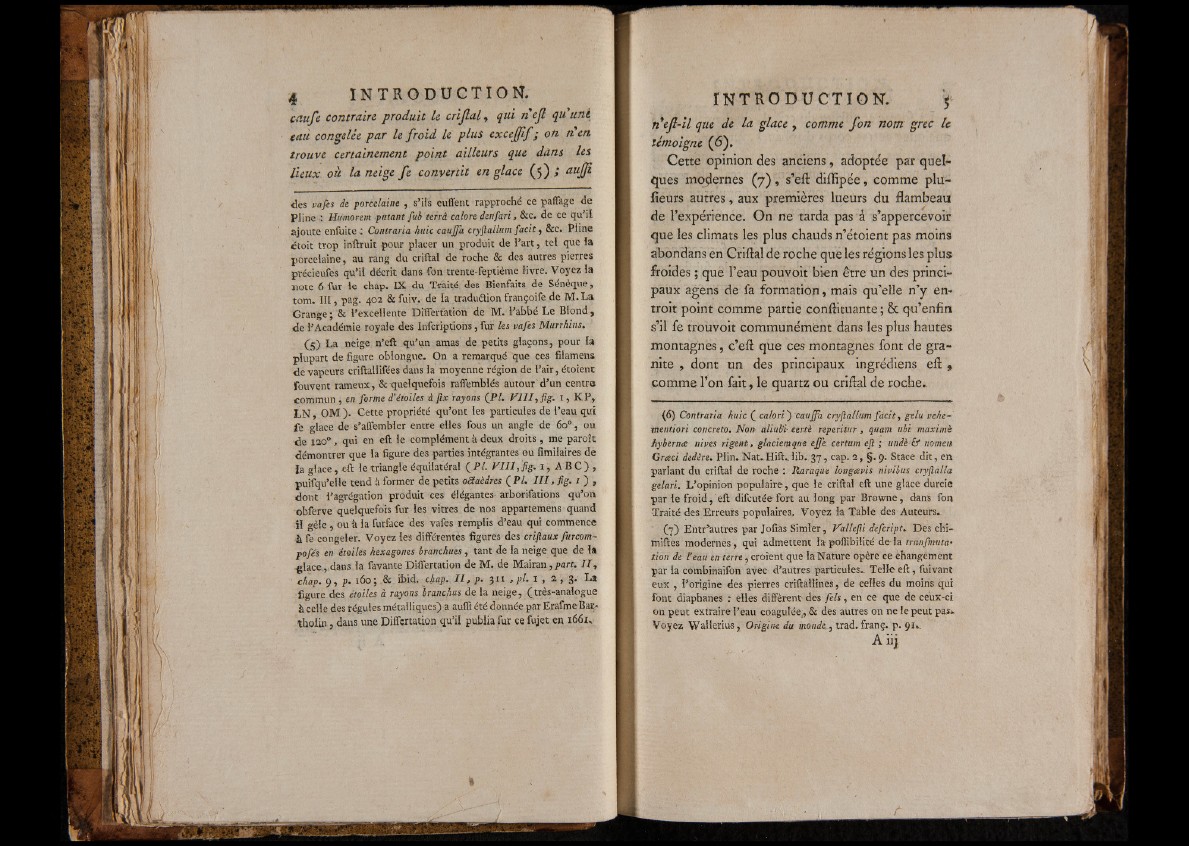
cnufe contraire produit le crijlal, qui nejl qu'uni
eau congelée par le froid le plus excejjif j on n en
trouve certainement point ailleurs que dàns les
lieux ou la neige fe convertit en glace (.5) > aujji
des va fis de porcelaine , s’ ils euffent rapproché ce paffage de
Pline : Humorem putant fub terrâ calore deitfari, &c. de ce qu'il
ajoute enfuite-: Contraria huic caujfa cryftallum fa c it, &c. Piine
¿ toit trop inllruit pour placer un produit de P a r t, tel que la
porcelaine, au rang du criftal de roche & des autres pierres
précieufes qu’ il décrit dans fon trente-feptième livre. Voyez la
note 6 fur le chap. IX du Traité des Bienfaits de Sénèque,
tom. I I I , pag. 402 & fuiv. de la tradu&ion françoife de M . La
Grange; & l’ excellente Differtation de M . l’ abbé L e B lo n d ,
d e l’Académie royale des Infcriptions, fur les vaj'ts Murrhins.
( 5 ) La neige n’ eft qu’un amas de petits glaçons, pour la
plupart de figure oblongue. On a remarqué que ces filamens
de vapeurs criftallifées dans la moyenne région de Pair, étoient
fouvent rameux, & quelquefois ralfemblés autour d’ un centre
commun , en forme d’étoiles à fix rayons (P/. V I I I , fig. I , K P ,
L N , OM ) . Cette propriété qu’ont les particules de Peau qui
fe glace de s’ affembler entre elles fous un angle de 6 o ° , ou
de 120“ , qui en eft le complément à deux droits , me paroît
démontrer que la figure des parties intégrantes ou fimilaires de
la g la ce , eft le triangle équilatéral ( PL V I I I ,'fig. x , A B C ) ,
puifqu’elle tend à former de petits oStaèdres ( P L I I I , fig. 1 ) ,
dont l ’ agrégation produit ces élégantes arborifations qu’ on
obferve quelquefois fur les vitres de nos appartemens quand
i l g è le , ou à la furface des vafes remplis d ’eau qui commence
à fe congeler. Vo y ez les différentés figures des criflaux furcom-
pofés en étoilés hexagones branchues, tant de la neige que de la
•glace.,.dans la favante Diflèrtation de M . de Mairan, part. I I ,
chap. 9 , p. 160; . & ibid. chap. I I , p. 311 , p l. 1 , 2 ; 3. La
figure des étoiles à rayons branchas de la neige , (très-analogue
à celle des régules métalliques) a auffi été donnée par Erafme Bar-
th o lin , dans une Diflèrtation qu’il publia fur ce fujet en 1661.
n*ejl-il que de la glace , comme fon nom grec le
témoigne (6).
Cette opinion des anciens, adoptée par quel*
ques modernes ( 7 ) , s’eft diffipée, comme plu-
Îieurs autres, aux premières lueurs du flambeau
de l’expérience. On ne tarda pas à s’appercevoir
que les climats les plus chauds n’étoient pas moins
ahondans en Criftal de roche que les régions les plus
froides ; que l’eau pouvoit bien être un des principaux
agens de fa formatiop, mais qu’elle n’y en*
troit point comme partie conftituante ; & qu’enfin
s’il fe trouvoit communément dans les plus hautes
montagnes, c’eft que ces montagnes font de granité
, dont un des principaux ingrédiens eft ,
comme l’on fait, le quartz ou criftal de roche..
(6) Contraria huic ( calori ) caujfa cryflallum fa c it, gelu vehe-
tnentiori concreto. Non aliub'i- tertè reperitur, quam ubv maxime
hyberme vives rigevl, glaciemque ejfe certum eft ; undè & nomen
Græci dedêre. Plin. Nat..HifL lib. 3 7 , cap. 2 , § . 9. Stace d it, en
parlant du criftal de roche : Ha raque Ion grc vis nivibus cryftalla
gelari. L ’ opinion populaire, que le criftal eft une glace durcie
par le f ro id , eft difeutéefort au long par Browne, dans fon
Traité des Erreurs populaires. Vo y ez la Table des Auteurs.
(7 ) Entr’ autres par Jofi'as Simler, Vallefti defeript. Des chi-
miftes modernes , qui admettent la pofiibilicé de-la tranfmuta-
tion de l’eau en terre, croient que laNature opère ce changement
par la combinaifon avec d’autres particules.. T e lle e ft , fuivant
eux , l’ origine des pierres criftalfines, de celles du moins qui
font diaphanes : elles diffèrent des f e l s , en ce que de ceux-ci
on peut extraire l ’ eau coagulée;, & des autres on ne le peut pasi.
Voyez Wallerius, Origine du monde., trad. franç. p. 91».
A iij