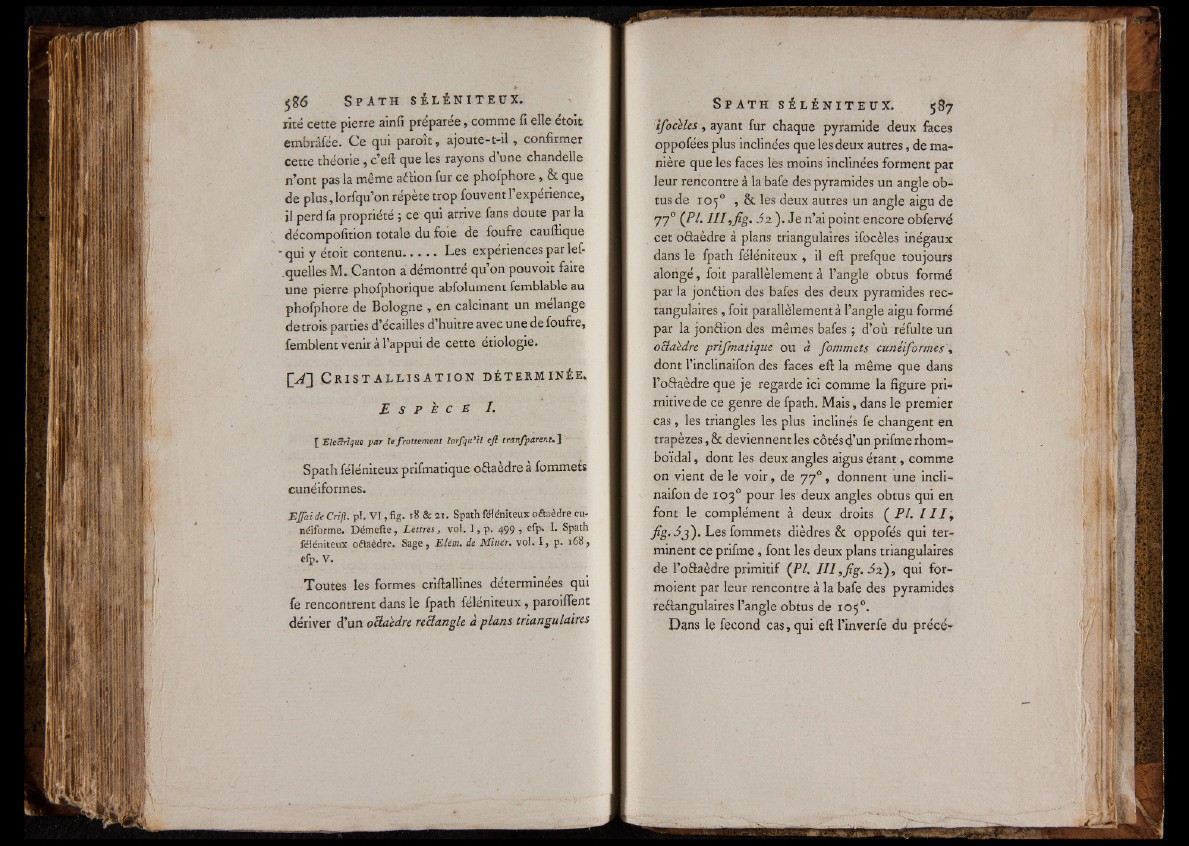
5 8 6 S p a t h s é l é n i t e u x .
rite cette pierre ainii préparée, comme fi elle étoit
embrâfée. (Je qui paroit, ajoute-t-il, confirmer
cette théorie , c’eft que les rayons d’une chandelle
n’ont pas la même aétion fur ce phofphore, 8c que
de plus,lorfqu’on répète trop fouvent l’expérience,
il perd fa propriété ; ce qui arrive fans doute par la
décompofition total© du foie de foufre cauftique
‘ qui y étoit contenu.. . . . Les expériences parlef-
.quelles M. Canton a démontré qu’on pouvoit faire
une pierre phofphorique abfolument femblable au
phofphore de Bologne , en calcinant un mélange
detrois parties d’écailles d’huitre avec une de foufre,
femblent venir à l’appui de cette etiologie.
[\ A \ C r i s t a l l i s a t i o n d é t e r m i n é e .
E s p è c e I.
[ Electrique par le frottement lorfqu'tl eft t ranfparent,]
Spath féléniteux prifmatique oôaedre a fommets
cunéiformes.
E fa i Je Crift. pl. V I , fig. 18 & 2 i. Spath féléniteux oôaèdre cunéiforme.
Déme fte , Lettres, vol. 1 , p. 499 , efp. I. Spath
féléniteux oftaèdre. Sage , Elém. de Minér. v o l. I , p. 168,
efp. V .
Toutes les formes criftallines déterminées qui
fe rencontrent dans le fpath féléniteux, paroiffent
dériver d’un octaedre reSangle à plans triangulaires
S p a t h s é l é n i t e u x . 587
ifoctles, ayant fur chaque pyramide deux faces
oppofées plus inclinées que les deux autres, de manière
que les faces lès moins inclinées forment par
leur rencontre à la bafe des pyramides un angle obtus
de 1050 , êc les deux autres un angle aigu de
7 70 (Pl. III,fig. 5z ). Je n’ai point encore obfervé
cet oâaèdre à plans triangulaires ifocèles inégaux
dans le fpath féléniteux , il eft prefque toujours
alongé, foit parallèlement à l’angle obtus formé
par la jonifion des bafes des deux pyramides rectangulaires
, foit parallèlement à l’angle aigu formé
par la jonôion des mêmes bafes ; d’où réfulte un
octaedre prifmatique ou à fommets cunéiformes \
dont l’inclinaifon des faces eft la même que dans
l’oâaèdre que je regarde ici comme la figure primitive
de ce genre de fpath. Mais, dans le premier
cas, les triangles les plus inclinés fe changent en
trapèzes, 8c deviennent les côtés d’un prifmerhom-
boïdal, dont les deux angles aigus étant, comme
on vient de le voir, de 770, donnent une incli-
naifon de i03°pour les deux angles obtus qui en
font le complément à deux droits ( Pl. I I I ;
/ g . i j ) . Les fommets dièdres 8c oppofés qui terminent
ce prifme , font les deux plans triangulaires
de l’oâaèdre primitif (Pl. I I I , fig. 52), qui for-
moient par leur rencontre à la bafe des pyramides
rectangulaires l’angle obtus de 105°.
Dans le fécond cas, qui eft l’inverfe du précé