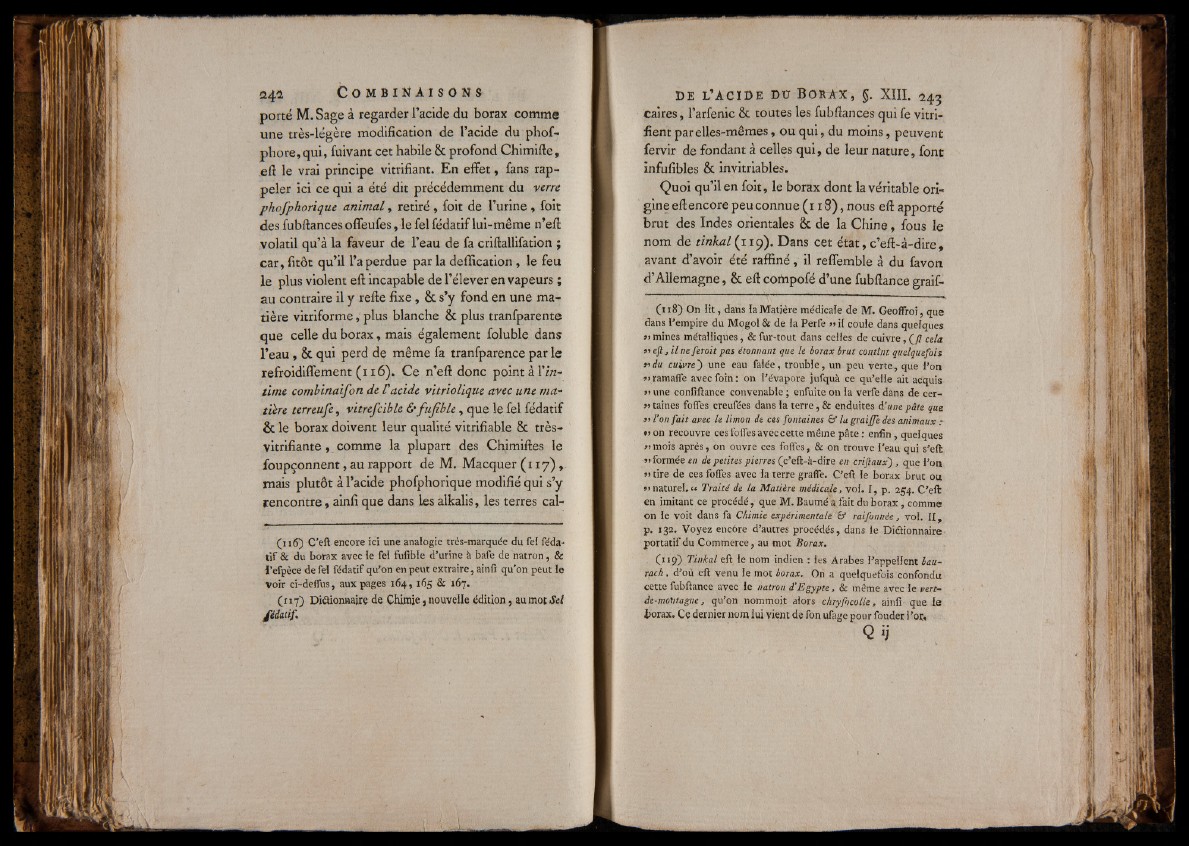
24$ C o m b i n a i s o n s
porté M.Sage à regarder l’acide du borax comme
une très-légère modification de l’acide du phof-
phore,qui, fuivant cet habile 8c profond Chimifte,
.eft le vrai principe vitrifiant. En effet, fans rappeler
ici ce qui a été dit précédemment du verre
phofphorique animal, retiré , foit de l’urine , foit
des fubftances ofleufes, le fel fédatif lui-même n’eft
volatil qu’à la faveur de l’eau de fa criftallifation ;
car,fitôt qu’il l’a perdue par la déification, le feu
le plus violent eft incapable de l’élever en vapeurs ;
au contraire il y refte fixe, & s’y fond en une matière
vitriforme, plus blanche 8c plus tranfparente
que celle du borax, mais également foluble dans
l’eau, 8c qui perd de même fa tranfparence par le
refroidiffement ( i 16). Ce n’eft donc point à Xintime
combinaifon de Cacide, vitriolique avec une matière
terreufe, vitrefcible & fujible, que le fel fédatif
8c le borax doivent leur qualité vitrifiable 8c très-
vitrifiante ».comme la plupart des Chimiftes le
foupçonnent, au rapport de M. Macquer (1 17 )^
mais plutôt à l’acide phofphorique modifié qui s’y
rencontre » ainfi que dans les alkalis, les terres cal-
( 1 16 ) C'eft encore ici une analogie très-marquée du fel fédat
i f & du borax avec le fel fufible d’urine à bafe de natron, &
i ’efpèce de fel fédatif qu’on en peut extraire, ainfi qu'on peut le
v o ir ci-delfus, aux pages 16 4 , 165 & 167.
(117) Dictionnaire de Chimie » nouvelle édition, au mot Sel
/¿datif.
DE L’ A C ID E DU B O R A X , §. XIII. 243
caires, l’arfenic 8c toutes les fubftances qui fe vitrifient
par elles-mêmes, ou qui, du moins, peuvent
fervir de fondant à celles qui, de leur nature, font
infufibles 8c invitriables.
Quoi qu’il en foit, le borax dont la véritable origine
eft encore peu connue (1 18 ) , nous eft apporté
brut des Indes orientales 8c de la Chine, fous le
nom de tinkal (119). Dans cet état, c’eft-à-dire,
avant d’avoir été raffiné, il reffemble à du favon
d’Allemagne, 8c eft compofé d’une fubftance graif-
( 1 18 ) On l i t , dans la Matière médicale de M. Geoffroi, que
dans l’ empire du Mogoi & de ia Perfe »> if coufe dans quelques
» mines métalliques, & fur-tout dans celles de cu iv re , Qfl cela
»’ eflj i l ne ferait pas étonnant que le borax brut contint quelquefois
ndu cuivre') une eau falé e, trouble , un peu ve rte , que l ’on
«ramalfe avec foin: on l’ évapore jufquà ce qu’ elle ait acquis
» une confiftance convenable ; enfuite on la verfe dans de cert
a in e s folfes creufées dans la te r re , & enduites d’ unepâte que
■» Ton fait avec le limon de ces fontaines & la graiffe des animaux r
*>on recouvre ces folfes avec cette même pâte : enfin, quelques
» mois après, on ouvre ces folles, & on trouve l'eau qui s’ eft
’ > formée en de petites pierres (c ’eft-à-dire en criftaux), que l ’on
» tire de ces folfes avec la terre gra(Te. C’ eft le borax brut ou
»»naturel.« Traité de la Matière médicale, v o l. I , p. 254. C’ eft
en imitant ce procédé, que M. Baumé a fait du b o ra x , comme
on le voit dans fa Chimie expérimentale & raifonnée, vol. I I ,
p. 132. Voyez encôre d’autres procédés, dans le Diâionnaire
portatif du Commerce, au mot Borax.
( 1 19 ) Tinkal eft le nom indien : les Arabes l’appellent bau-
rach, d’où eft venu le mot borax. On a quelquefois confondu
cette fubftance avec le natron d'Egypte, & même avec le vert-
de-montagne, qu’on nommoit alors chryfocolie, ainfi que le
borax. Ce dernier nom lui vient de fon ufage pour fouder l ’or,
Q I