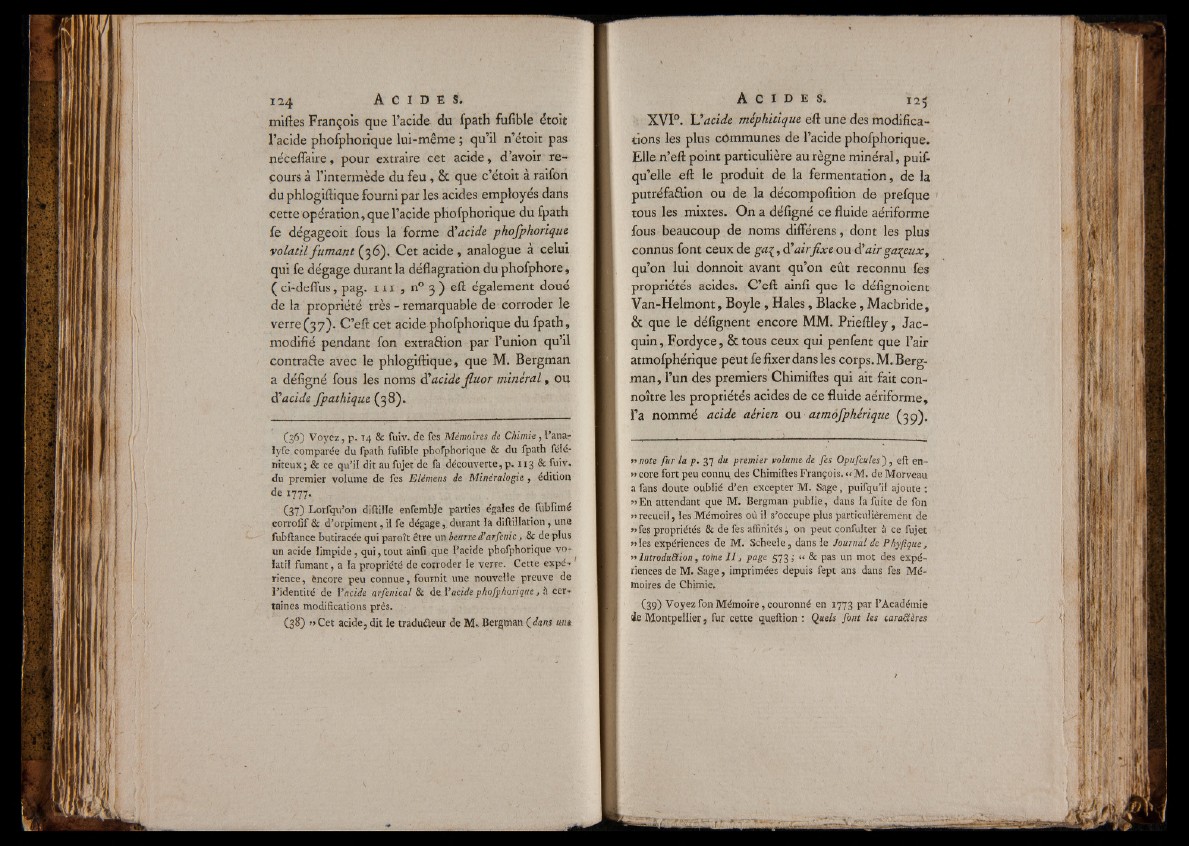
12 4 A c i d e s .
milles François que l’acide du fpath fufible ¿toit
l ’acide phofphorique lui-même ; qu’il n’ëtoit pas
n é ce fla ire , pour extraire c e t a c id e , d ’avoir re cours
à l’intermède du f e u , & que c’étoit à raiibn
du phlogiftique fourni par les acides employés dans
c e tte opération, que l’acide phofphorique du fpath
fe dégageoit fous la forme d'acide phofphorique
volatil fumant (3 6 ) . C e t acide , analogue à celui
qui fe dégage durant la déflagration du p h o fp h o re ,
( ci-deflus, pag. m , n° 3 ) eft également doué
de la propriété très - remarquable de corroder le
v e r r e ( 3 7 ) . C ’eft c e t acide phofphorique du fpath,
modifié pendant fan extraâion par l’union qu’il
contraÔe avec le p h lo g iftiq ue , que M . Bergman
a défigné fous les noms diacide fluor minéral, ou
dacide fpathique (3 8 ) .
(36) V o y e z , p. 14 & fuiv.. de fes Mémoires de Chimie , l’ ana-
îyfe comparée du fpath fufible phofphorique & du fpath félé,-
r ite u x ; & ce qu’il dit au fujet de fa découverte, p . 113 & fuiv.
du premier volume de fes Elémens de Minéralogie, édition
de 1777.
(37) Lorfqu’on diftille enfembJe parties égales de fùbfimé
corrofif & d’ orpiment, il fe dégage,. durant la diftillation, une
fubftançe butiracée qui paroît être un beurre d’arfenic, & de plus
un acide limpide , q u i, tout ainfî que l ’acide phofphorique vo latil
fumant, a la propriété de corroder le verre. Cette expérience,
ftncore peu connue, fournit une nouvelle preuve de
l ’identité de l’ acide arfenical & de l’ acide phofphorique, i l certaines
modifications près.
(38) ’»Cet acide, dit le traduéteur de M . Bergman (dans un*
X V P . XIacide méphitique eft une des modifications
les plus communes de l’acide phofphorique.
Elle n’eft point particulière au règne minéral, puif-
qu’elle eft le produit de la fe rmentation, de la
putréfaâion ou de la décompolition de prefque
tous les mixtes. O n a défigné ce fluide aériforme
fous beaucoup de noms différens, dont les plus
connus font ceux de ga^, d’airfixe ou d’air galeux,
qu’on lui donnoit avant qu’on eû t reconnu fes
propriétés acides. C ’eft ainfi que le défignoient
V an -H e lm on t, B o y le , H a ie s , B la c k e , Macbride,
& que le défîgnent encore M M . P r ie ftle y , Jac-
q uin , F o rd y c e , & tous ceux qui penfent que l’air
atmofphérique peut fe fixer dans les corps. M. Bergman,
l’un des premiers Chimiftes qui ait fait con-
noître les propriétés acides de ce fluide aériforme,
l’ a nommé acide aérien ou atmofphérique (3 9 ).
»» note fur la p. 37 du premier volume de fes Opufcules ) , eft en-
» core fort peu connu des Chimiftes François. « M . de Morveau
a fans doute oublié d’ en excepter M . Sage, puifqu’il ajoute :
»En attendant que M . Bergman publie, dans la fuite de fon
»»recueil, les Mémoires où il s’occupe plus particulièrement de
»fes propriétés & de fes affinités, on peut confulter à ce fujet
»»les expériences de M . Scheele, dans le Journal de Phyfique,
»Introdu&ion, totne I I , page 573; « & pas un mot des expériences
de M. Sage , imprimées depuis fept ans dans fes Mé moires
de Chimie,
( 39) V o y ez fon Mémoire, couronné en 1773 par l’Académie
¿e Montpellier, fur cette queftion : Quels font les caractères