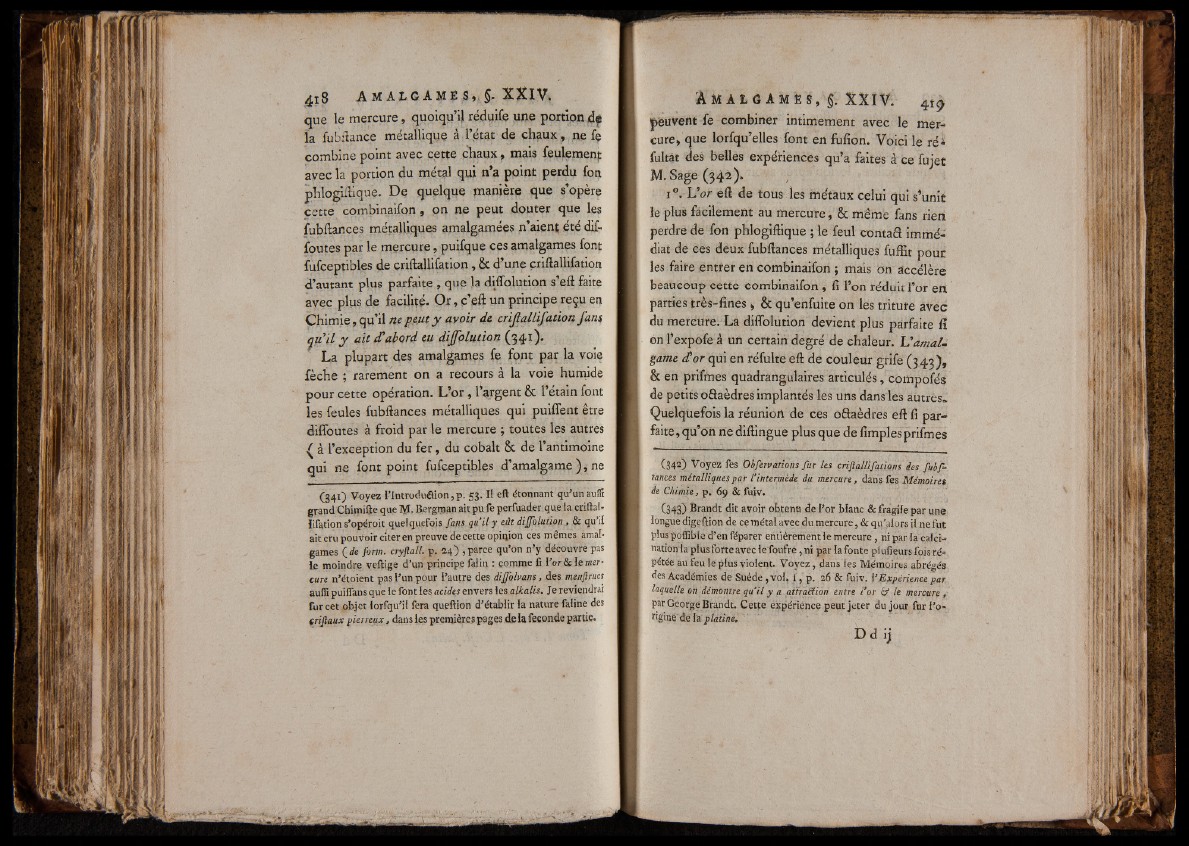
4;8 A M A L G A M Ë S „ X X l Vv
que le mercure, quoiqu’il réduife une portion df
îa fubftance métallique à l’état de chaux, ne fç
combine point avec cette chaux, mais feulemenf
avec la portion du métal qui n’a point perdu font
phlogiilique. De quelque manière que s’opère
cette combinaifon, on ne peut douter que les
fubftances métalliques amalgamées n’aient été dif-
ioutes par le mercure, puifque ces amalgames font
fufceptibles de çriftallifation, & d’une çriftallifation
d’autant plus parfaite , que la diffolution s’eft faite
avec plus de facilité- O r , c’eft un principe reçu en
Chimie, qu’il ne peut y avoir de crißallifation fans
qu 'il y ait d'abord tu diffolution (34,1).
j La plupart des amalgames fe font par la voie
fèche ; rarement on a recours à la voie humide
pour cette opération. L’or , l’argent & l’étain font
les feules fubftances métalliques qui puiffent être
diffoutes à froid par le mercure ; toutes les autres
/ à l’exception du fer, du cobalt & de l’antimoine
qui ne font point fufceptibles d’amalgame ) , ne
(3 4 1 ) Vo yez l’Introduôion,p. 53. Il eft étonnant qu’ unaufii
grand Chimifte que M . Bergman ait pu fe perfuader.que la criftai-
iifation s’opéroit quelquefois faits qu’ i l y eût diffolution, & qu’il
ait cru pouVoir citer en preuve de cette opiqion ces mêmes amalgames
O form, cryflall. p. 2 4 ) , parce qu’on n’ y découvre pas
le moindre veftige d’un principe faim : comme fi l’or & ie mercure
n’ étoient pas l’ un pour l’autre des diffolvans, des menftrues
aulfi puifians que le font les acides envers les alkalis. Je reviendrai
iu rce t objet lorfqu’ il fera queftion d’ établir la nature faline des
çriflaux pierreux, dans les premières pages de la fécondé partie.
peuvent fe combiner intimement avec le mercure,
que lorfqu’elles font en fuiîon. Voici le ré^
fultât des belles expériences qu’a faites à ce fujet
M. Sage (342).
i°. L’or eft de tous les me'tàüx celui qui s’unit
le plus facilement au mercure, & même fans rien
perdre de fon phlogiftique ; le feul contafi immédiat
de ces deux fubftances métalliques fuffir pour
les faire entrer en combinaifon ; mais On accélère
beaucoup cette combinaifon, fi l’on réduit l’or en
parties très-fines » & qu’enfuite on les triture avec
du mercure. La diffolution devient plus parfaite fi
on fexpefe à un certain degré de chaleur. Vamalgame
d or qui en réfulte eft de couleur grife (3 43),
&en prifmes quâdrangülaires articulés, compofés
de petits oâaèdres implantés les uns dans les autres.
Quelquefois la réunion de ces oâaèdres eft fi parfaite,
qu’on ne diftingue plus que de fimples prifmes
( 342) Vo yez fes Obfeivations fur les criftallifations des fubftances
métalliques par l’intermède du mercure, dans fes Mémoires
ae Chimie, p. 69 & fuiv.
(343) Brandt dit avoir obtenu de l’ or blanc &fragifepar une
longue digeftion de ce métal avec du mercure, & qu’alors il ne fut
plus poffible d’en féparer entièrement le mercure, ni par la calci-
natiônla plus forte avec le foufre, ni par la fonte pf ufieurs fois ré->
pétée au feu le plus violent. V o y e z , dans les Mémoires abrégés
des Académies de Suède ,v o l, I , p. 26 & fuiv. {’Expérience par
laquelle on démontre qu’i l y a attra&iàù entre l’or & le mercure ,
par George Brandt. Cette expérience peut jeter du jour fu r i’o-
tiginé de l'a platine.