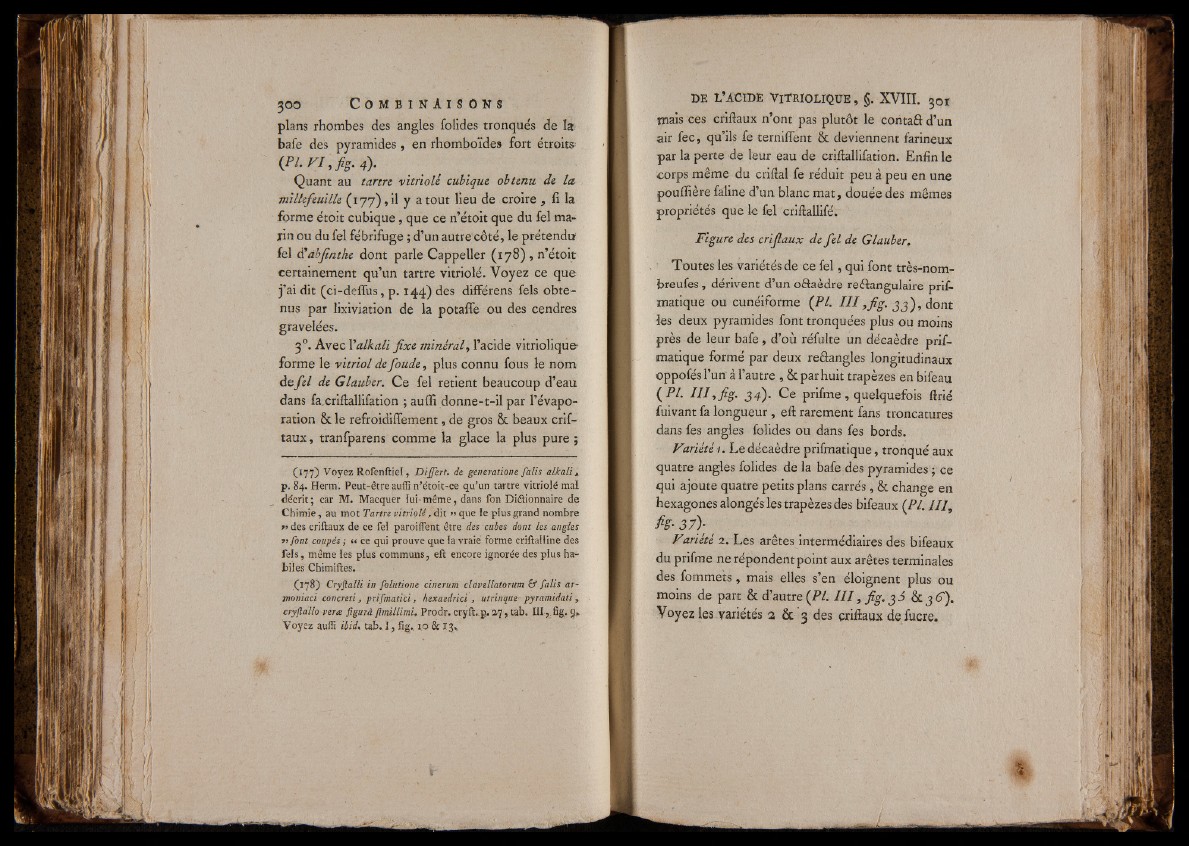
plans rhombes des angles folides tronqués de la
bafe des pyramides, en rhomboïdes fort étroit»
( P L V I , f i g . 4 ) .
Quant au tartre vitriolé cubique obtenu de la
millefieuille ( 1 7 7 ) , il y a tout lieu de croire , fi la
forme étoit cubique, que ce n’étoit que du fel marin
ou du fel fébrifuge ; d’un autre côté, le prétendu»
fel di’àbfintke dont parle Cappeller (178) , n’étoit
certainement qu’un tartre vitriolé. Voyez ce que
j’ai dit (ci-deflus, p. 144) des différens fels obtenus
par lixiviation de la potafîè ou des cendres
gravelées.
30. Avec Yalkali fix e minéral, l’acide vitriolique
forme le vitriol de fo u d e , plus connu fous le nom
def e l de Glauber. Ce fel retient beaucoup d’eau
dans fa.criitallifation ; aufli donne-t-il par l’évaporation
& le refroidiflement, de gros & beaux criftaux
, tranfparens comme la glace la plus pure ;
(17 7 ) Voyez Rofenftiel, DiJJert. de generatione fa lis a lk a li,
p. 84. Herm: Peut-être aufli n’étoit-ce qu’ un tartre vitriolé mal
décrit; car M . Macquer fui-même, dans fon Diétionnaire de
Chimie, au mot Tartre v itr io lé , dit » que le plus grand nombre
5) des criftaux de ce fel parodient être des cubes dont les angles
»> fo n t coupés ; « ce qui prouve que la vraie forme criftalline des
fe ls , même les plus communs, eft encore ignorée des plus habiles
Chimiftes.
(178) Cryftalli in folutione cinerum clavellatomm 6* fa lis ar-
moniaci conçreti, p rïfm a tic i, hexaedrici , utrinque- pyramidati ,
cryjlallo verte figurâ fm illim i. Prodr. cryft. g. 2 7 , tab. I I I f i g . g .
V o y e z auffi ibid, tab. I , f ig . 10 & 1 3 .
mais ces criftaux n’ont pas plutôt le contaâ d’un
air fec, qu’ils fe terniflent & deviennent farineux
par la perte de leur eau de criftallifation. Enfin le
corps même du criftal fe réduit peu à peu en une
pouflière faline d’un blanc mat, douée des mêmes
propriétés que le fel criftallifé.
. : v Æm • '4mm '
Figure des criftaux de f e l de Glauber,
Toutes les variétés de ce fe l, qui font très-nom-
breufes, dérivent d’un oâaèdre rectangulaire prif-
matique ou cunéiforme (P L I I I , fig. 3 3 ), dont
les deux pyramides font tronquées plus ou moins
près de leur bafe, d’où réfulte un décaèdre prif-
matique formé par deux reâangles longitudinaux
oppofésl’un' à l’autre , & par huit trapèzes en bifeau
( P l . I I I , f ig . 34). Ce prifme, quelquefois ftrié
fuivant fa longueur , eft rarement fans troncatures
dans fes angles folides ou dans fes bords.
Variété t. Le décaèdre prifmatique, tronqué aux
quatre angles folides de la bafe des pyramides ; ce
qui ajoute quatre petits plans carrés , & change en
hexagones alongés les trapèzes des bifeaux (P L I I I ,
fis• 37)- \
Variété 2. Les arêtes intermédiaires des bifeaux
du prifme ne répondent point aux arêtes terminales
des fommets, mais elles s’en éloignent plus ou
moins de part & d’autre (P L I I I , fig. g S
Voyez les variétés 2 & 3 des çriftaux defucre.