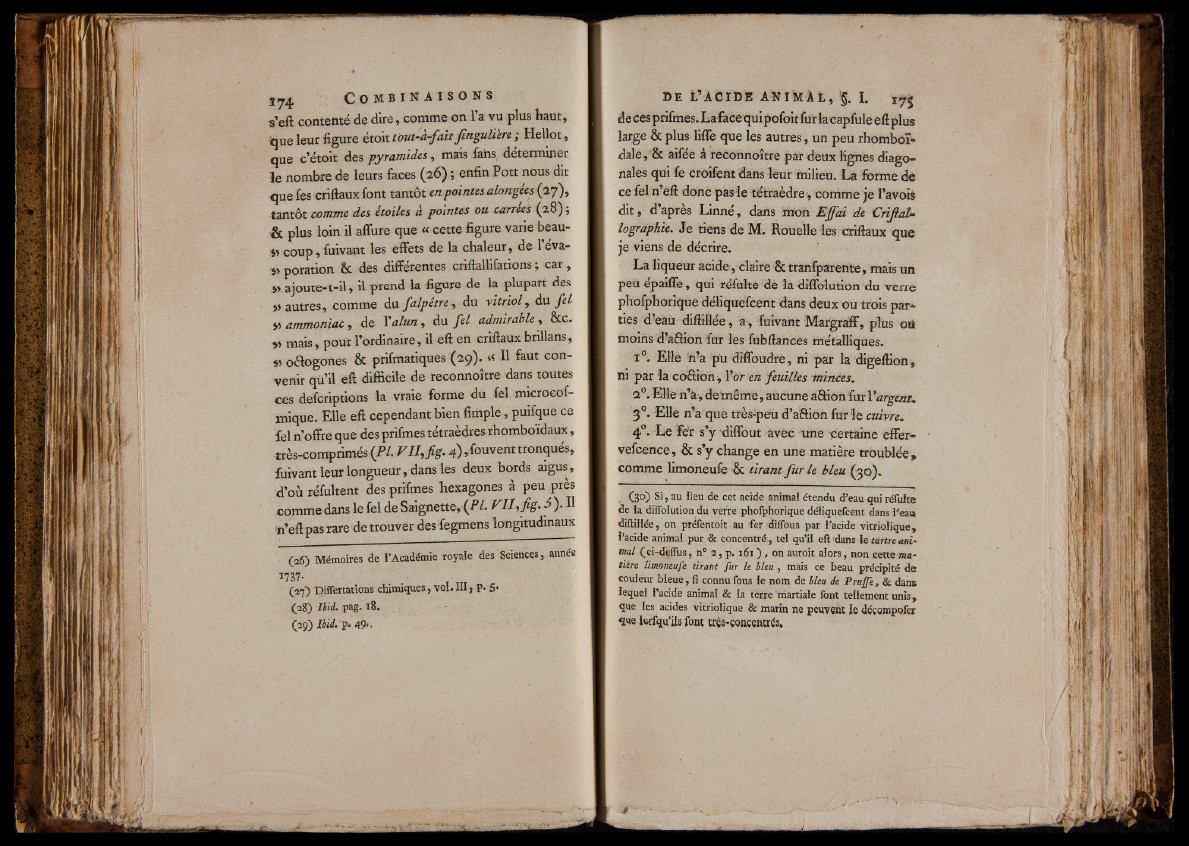
1 7 4 C o m b i n a i s o n s
s’ eft contenté de dire , comme on l’a vu plus h au t,
q u e leur figure étoit tout-a-fait fnguliere ; H e llo t ,
que c’étoit des pyramides, mais fans déterminer
le nombre de leurs faces (2 6 ) ; enfin P ott nous dit
q u e fes criftaux font tantôt en pointes alongees (2 7 ) ,
tantôt comme des étoiles à pointes ou carrées (28 ) ;
& plus loin il affure que « c e tte figure varie beau-
c o u p , fuivant les effets de la ch aleur , de 1 eva-
» poration & des différentes criftallifations ; c a r ,
» a jo u te - t- il, il prend la figure de la plupart des
» autres, comme du falpêtre, du vitriol, du fe l
» ammoniac, de Y alun, du fe l admirable, & c .
3> mais, pour l’ordinaire, il eft en criftauxbrillans,
» octogones & prifmatiqües (2 9 ) . « Il faut c o n venir
qù’il e ft difficile de reconnoître dans toutes
ces defcriptions la vraie formé du fel microeof-
mique. E lle eft cependant bien fim p le , puifque ce
fe l n’offre que des prifmes tétraèdres rhomboïdaux,
très-comprimés {P L V I I , fig. 4 ) , fou vent tronqués,
fuivant leur lo n g u eu r , dans les deux bords aigus,
d’où réfultent des prifmes hexagones à peu près
comme dans le fel de Saignette, (P l. V I I 11
n’ eft pas rare de trouver des fegmens longitudinaux
(26) Mémoires de l ’Académie royale des Sciences, année
*7 37*
(2 7) Differtations chimiques, vol. III, P- 5«
(28) Ihid. :pag. 18.
(29) Ihid. p . 49«.
ÔE t ’ A C l D E A N I M Â t , § , I. 175
de ces prifmes. L a fa e e qui pofoit fur la eapfuleeft plus
large & plus liffe que les autre s , un peu rhomboï*
dale, & aifée à reconnoître par deux lignes diagonales
qui fe croifent dans leur milieu. L a forme d e
ce fel n’ eft donc pas le tétraèdre ', comme je l’avois
d i t , d’après L in n é , dans mon Effdi de Crijlal-
lographte. Je tiens de M . Rouelle les criftaux q u e
je viens de décrire.
L a liqueur acide , claire 8c tranfparehte, mais un
peu épaiffe, qui réfulte de la diffolution du verre
phofphorique déliquefcent dans deu x o u trois par*
lies d ’eau diftillée, a , fuivant M a rg ra ff, plus oü
moins d’a â ion fur les fübftances métalliques.
ï ° . E lle n’a pu dîffoudre, ni par la digeftion»
ni par !la c o â io n , Y or en feuilles minces.
2 °. E lle n’a , de m êm e , aucune a S io n fu r Vargent.
3 ° . E lle n’a que très-pëu d’aô io n fur le cuivre.
4 0. L e fer s’ÿ diffout avec une certaine effer-
v e fc en c e , 8c s’y change en une matière tro u b lé e ,
comme limoneufe 8c tirant fur le bleu (30).
, C3°) s i 5 au Keu de cet acide animal étendu d’eau qui réfulte
de la dïflblution du verre phofphorique déliquefcent dans l’eaa
diftillée, on préfentoit au -fer diffous par l ’acide vitriolique,
l ’acide animal pur de concentré:, tel qu’il eft'dans le tartre ani~
mal {ci-deffus, n° 2 , p. 161 ) , on auroit alors, non cette matière
limoneufe tirant fur le bleu, mais ce beau précipité de
couleur b leu e , fi connu fous le nom de bleu de Praffe, & dans
lequel l’acide animal & la terre martiale font tellement un is,
que les acides vitriolique & marin ne peuvent le décowpQÎèï
que ferfqu’ils font très-concentrés.
W