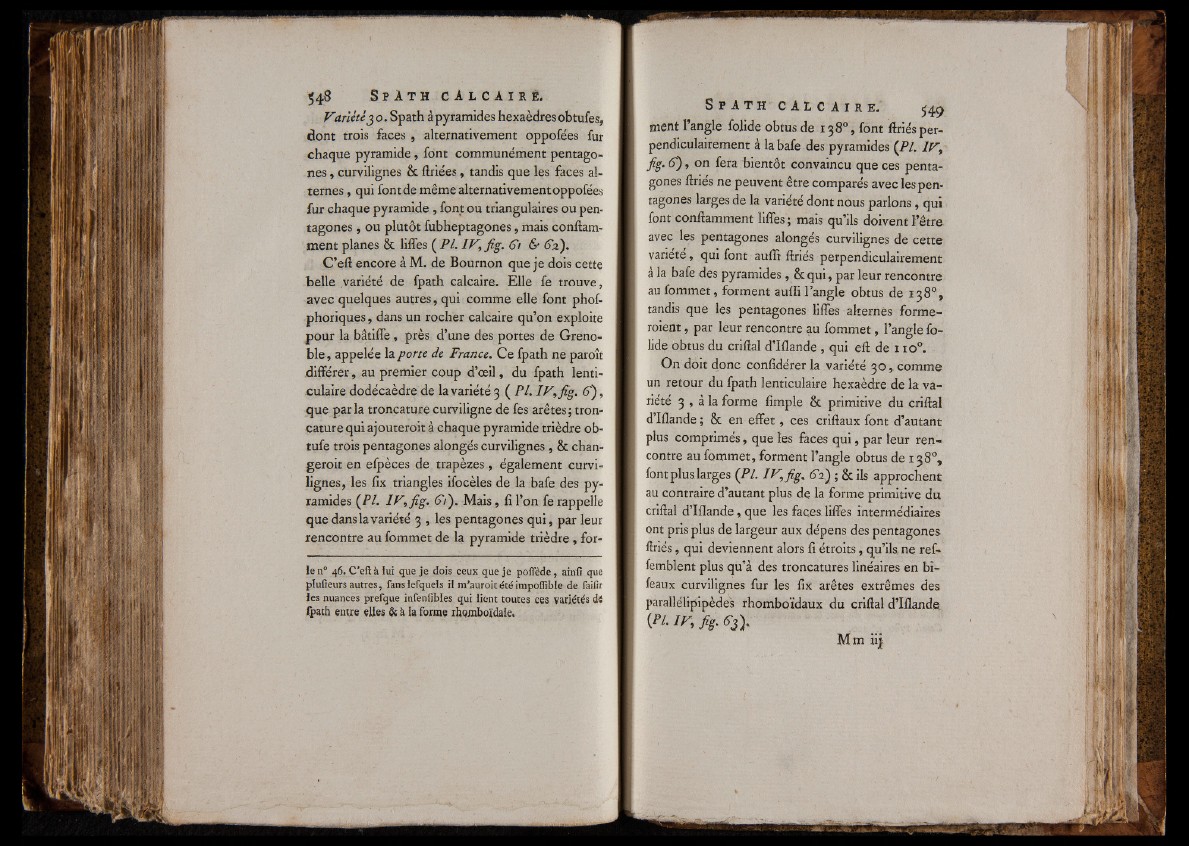
V drittes o. Spath à pyramides hexaèdres obtufes,
dont trois faces , alternativement oppofées fur
chaque pyramide , font communément pentagones
, curvilignes & ftriées, tandis que les faces alternes
, qui font de même alternativement oppofées
fur chaque pyramide , font ou triangulaires ou pentagones
, ou plutôt fubheptagones, mais conftam-
ment planes & liffes ( Pl. IV, fig. 6/ & Sz).
C ’eft encore à M. de Bournon que je dois cette
belle variété de fpath calcaire. Elle fe trouve,
avec quelques autres, qui comme elle font phof-
phoriques, dans un rocher calcaire qu’on exploite
pour la bâtiffe, près d’une des portes de Grenoble,
appelée la porte de France. Ce fpath ne paroît
différer, au premier coup d’oeil, du fpath lenticulaire
dodécaèdre de la variété 3 ( PL IV, fig. S ),
que parla troncature curviligne de fes arêtes; troncature
qui ajouteroit à chaque pyramide trièdre ob-
tufe trois pentagones alongés curvilignes , & changerait
en efpèces de trapèzes., également curvilignes,
les fix triangles ifocèles de la bafe des pyramides
(Pl. IV, fig. Si). Mais, fi l’on fe rappelle
que dans la variété 3 , les pentagones qui, par leur
rencontre au fommet de la pyramide trièdre, forïe
n° 46. C ’eft à lui que je dois ceux que je poffède, ainfi que
plufieurs autres, fansiefquels H m’auroit été impoffible de faifir
les nuances prefque infenfibles qui lient toutes ces variétés dé
fpath entre elles & à la forme rhomboidale.
ment l’angle folide obtus de 138°, font ftriésperpendiculairement
à la bafe des pyramides (Pl. IV,
fig-S), on fera bientôt convaincu que ces pentagones
ftries ne peuvent être comparés avec les pentagones
larges de la variété dont nous parlons, qui
font conftamment liffes ; mais qu’ils doivent l’être
avec les pentagones alongés curvilignes de cette
variété, qui font aufli ffriés perpendiculairement
à la bafe des pyramides , &qui, par leur rencontre
au fommet, forment auffi l ’angle obtus de 138°,
tandis que les pentagones liffes alternés formeraient
, par leur rencontre au fommet, l’angle folide
obtus du criftal d’Iilande , qui eft de 1 io°.
On doit donc confidérer la variété 30, comme
un retour du ipath lenticulaire hexaèdre de la variété
3 , à la forme fimple & primitive du criftal
d’Iilande ; & en effet, ces criftaux font d’autant
plus comprimés, que les faces qui, par leur rencontre
au fommet, forment l’angle obtus de 138°,
fontplu&larges (Pl. IV, fig. 62) ; & ils approchent
au contraire d’autant plus de la forme primitive du
criftal d’Iilande, que les faces, liffes intermédiaires
ont pris plus de largeur aux dépens des pentagones
ftriés, qui deviennent alors fi étroits, qu’ils, ne ref-
femblent plus qu’à des troncatures linéaires en bî-
feaux curvilignes fur les fix arêtes extrêmes des
parallélipipèdes rhomboïdaux du criftal d’Iilande.
{p i. 0 * jig. i f y .
Mm üj