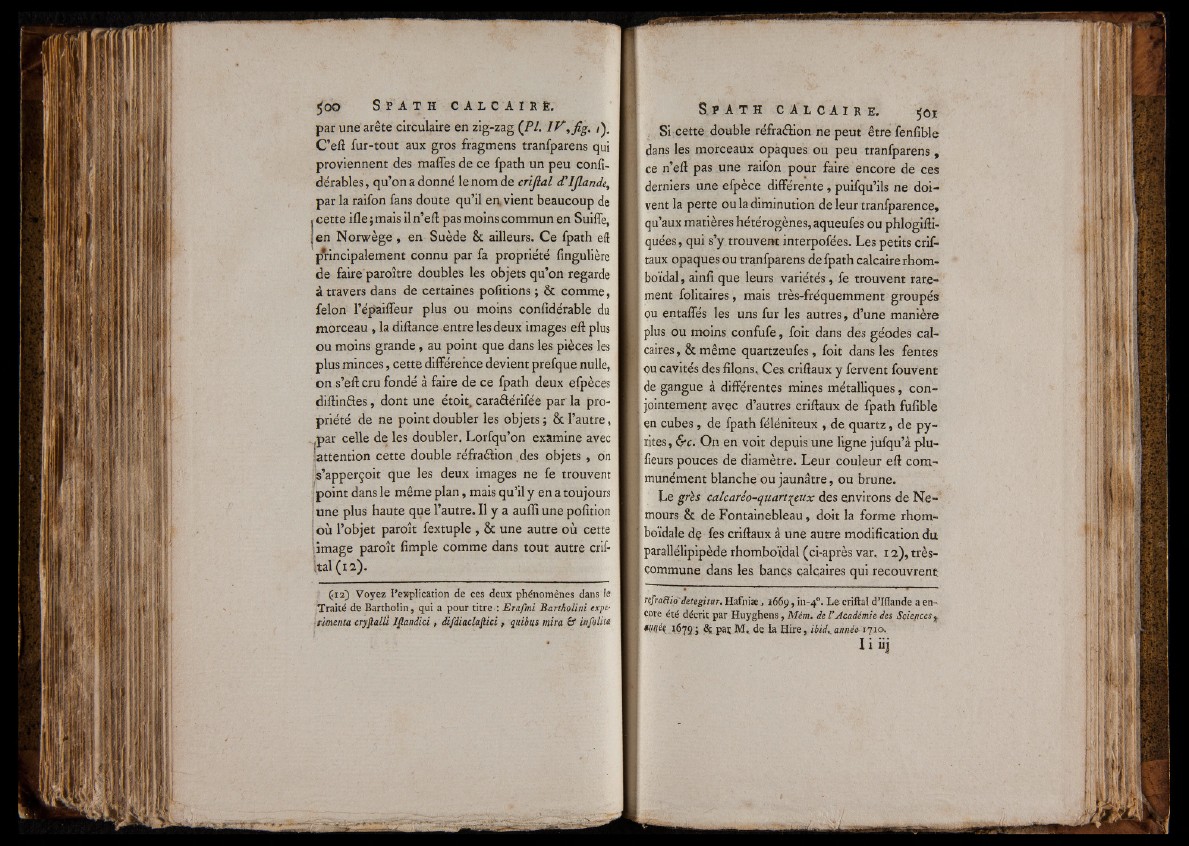
par une arête circulaire en zig-zag (Pl. lV ,fig . /),
C ’eft fur-tout aux gros fragmens tranfparens qui
proviennent des maiTes de ce fpath un peu confi-
derables, qu’on a donné le nom de crijlal d'IJlande,
par la raifon fans doute qu’il eavient beaucoup de
. cette ifle ; mais il n’eft pas moins commun en Suiffe,
|en Norwège , en Suède & ailleurs. Ce fpath eft
i&incipalement connu par fa propriété fingulière
de faire paroître doubles les objets qu’on regarde
à travers dans de certaines pofitions ; & comme,
félon l’épaiffeur plus ou moins confidérable du
morceau , la diftance entre les deux images eft plus
ou moins grande, au point que dans les pièces les
plus minces, cette différence devient prefque nulle,
on s’eft cru fondé à faire de ce fpath deux efpèces
diftinâes, dont une étoit, caraâérifée par la propriété
de ne point doubler les objets ; & l’autre,
..par celle de les doubler. Lorfqu’on examine avec
'attention cette double réfraâion des objets , on
is’apperçoit que les deux images ne fe trouvent
¡point dans le même plan, mais qu’il y en a toujours
iune plus haute que l’autre. Il y a auffi une pofition
Joù l’objet paroît fextuple , & une autre où cette
limage paroît fimple comme dans tout autre crif-
jtal (12).
; Ç12) Vo y ez l ’ explication de ces deux phénomènes dans fe
Traité de Bartholin, qui a pour titre : Erafmi Bartholini expérimenta
cryfialh Iflandici, difdiaclajtici, quitus mira & infoüti
S p a t h c a l c a i r e . 501
. Si cette double réfra&ion ne peut être fenfïble
dans les morceaux opaques ou peu tranfparens ,
ce n’eft pas une raifon pour faire encore de ces
derniers une efpèce différente, puifqu’ils ne doivent
la perte ou la diminution de leur tranfparence,
qu’aux matières hétérogènes, aqueufes ou phlogifti-
quées, qui s’y trouvent interpofées. Les petits crif-
taux opaques ou tranfparens de fpath calcaire rhom-
boïdal, ainfi que leurs variétés, fe trouvent rarement
folitaires, mais très-fréquemment groupés
ou entaffés les uns fur les autres, d’une manière
plus ou moins confufe, foit dans des géodes cal-
i caires, &même quartzeufes, foit dans les fentes
ou cavités des filons. Ces criftaux y fervent fouvent
de gangue à différentes mines métalliques, conjointement
avec d’autres criftaux de fpath fufible
çn cubes , de fpath féléniteux , de quartz, de pyrites
, £fc. Qn en voit depuis une ligne jufqu’à plu-
fieurs pouces de diamètre. Leur couleur eft com-
| munément blanche ou jaunâtre, ou brune.
Le grès çalcaréo-quartqeux des environs de Nemours
& de Fontainebleau, doit la forme rhom-
| boïdale dç fes criftaux à une autre modification du
parallélipipède rhombo'fdal (ci-après var, 12), très-
commune dans les bançs çalçaires qui recouvrent
I TtfraBio'detegituT. Hafniæ„ 1669, in-40. Le criftal d’ Iflancîe a en-
I çore été décrit par Huyghens, Mém. de l ’Académie des SciepceSy
1679 ; 8s paç M. de la Hire, ibidK année 1710,
i i iii
lu
f i m| iM|m
1Il1 t1a1 r i
I i l !
M i l | ill| jfi'K
II
I I I
h î i f t