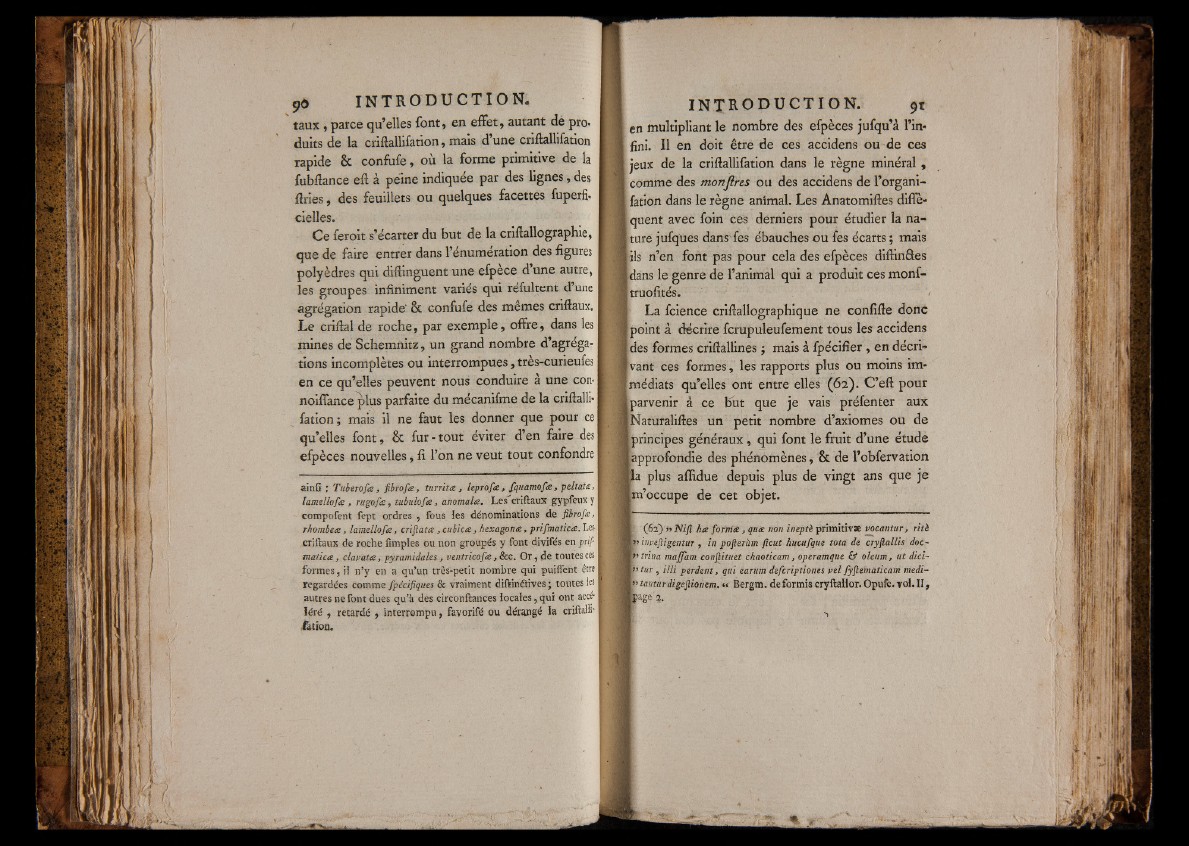
taux , parce qu’elles font, en effet, autant dé produits
de la criftallifation, mais d’une criftallifation
rapide & confufe, où la forme primitive de la
fubftance eft à peine indiquée par des lignes, des
ftries, des feuillets ou quelques facettes fuperfi.
eielles.
Ce feroit s’écarter du but de la criftallographie,
que de faire entrer dans l’énumeration des figures
polyèdres qui diftinguent une efpece d’une autre,
les groupes infiniment variés qui réfultent d’une
agrégation rapide' & confufe des mêmes criftaux.
Le criftal de roche, par exemple, offre, dans les
mines de Schemnitz, un grand nombre d’agrégations
incomplètes ou interrompues, très-curieufes
en ce qu’elles peuvent nous conduire à une con-
noiffance plus parfaite du mécanifme de la criftallifation;
mais il ne faut les donner que pour ce
qu’elles font, & fur-tout éviter d’en faire des
efpèces nouvelles, fi l’on ne veut tout confondre
ainfi ; Tuberofie, fibrofæ, turritoe, leprofe, fquamofce, peltatæ,
lams/lofæ , rugofæ, tubulofe , anomalie. Les criftaux gypfeuxy
compofent fept ordres , fous les dénomination^ de fibrofæ,
rhombeoe, lamellofe, crifiatæ, culicoe, hexagonæ, prifmaticæ. Les
criftaux de roche fimples ou non groupés y font divifés en prif-
mat ica , clavatæ, pyramidales , ventricofæ, &c. O r , de toutes ces
formes, il n’y en a qu’un très-petit nombre qui puiffent être
regardées comme fpécifiques & vraiment diftinétives ; toutes les
autres ne font dues qu’à des circonftances locales, qui ont accéléré
, retardé , interrompu, favorifé ou dérangé la criftalli-
fttion.
I N T R O D U C T I O N . 9t
[ en multipliant le nombre des efpèces jufqu’à l’in-
I fini. Il en doit être de ces accidens ou de ces
ijeux de la criftallifation dans le règne minéral,
I comme des monfirts ou des accidens de l’organi-
¡fation dans le règne animal. Les Anatomiftes diffè-
Iquent avec foin ces derniers pour étudier la na-
Iture jufques dans fes ébauches ou fes écarts ; mais
lils n’en font pas pour cela des efpèces diftinâes
■dans le genre de l’animal qui a produit ces monf-
■truofités. /
La fcience criftallographique ne confifte donc
Ipoint à décrire fcrupuleufement tous les accidens
Ides formes criftallines ; mais à fpécifier , en décri-
Ivant ces formes, les rapports plus ou moins im-
I médiats qu’elles ont entre elles (62). C ’eft pour
■parvenir à ce but que je vais préfenter aux
■Naturaliftes un petit nombre d’axiomes ou de
«principes généraux, qui font le fruit d’une étude
■approfondie des phénomènes, & de l’obfervation
la plus affidue depuis plus de vingt ans que je
■m’occupe de cet objet.
■ s ........... . . . . ——-------
| (62) » Ni fi hte formce, quæ non ineptè primitivse vocantur, riti
1 ” invefiigentwr , in pofierhm ficut hucufque tota de cryftallis doc-
H i’ trina maffam confiituet chaoticam, operamque & oleum, ut dici-
B ” tur , illi perdent, qui earum defcriptiones vel fyfieinaticam medi-
» » tantur Aigefiionem. “ Bergm. defbrmis cryftallor. Opufc. vol. II ,
I p g e 3.