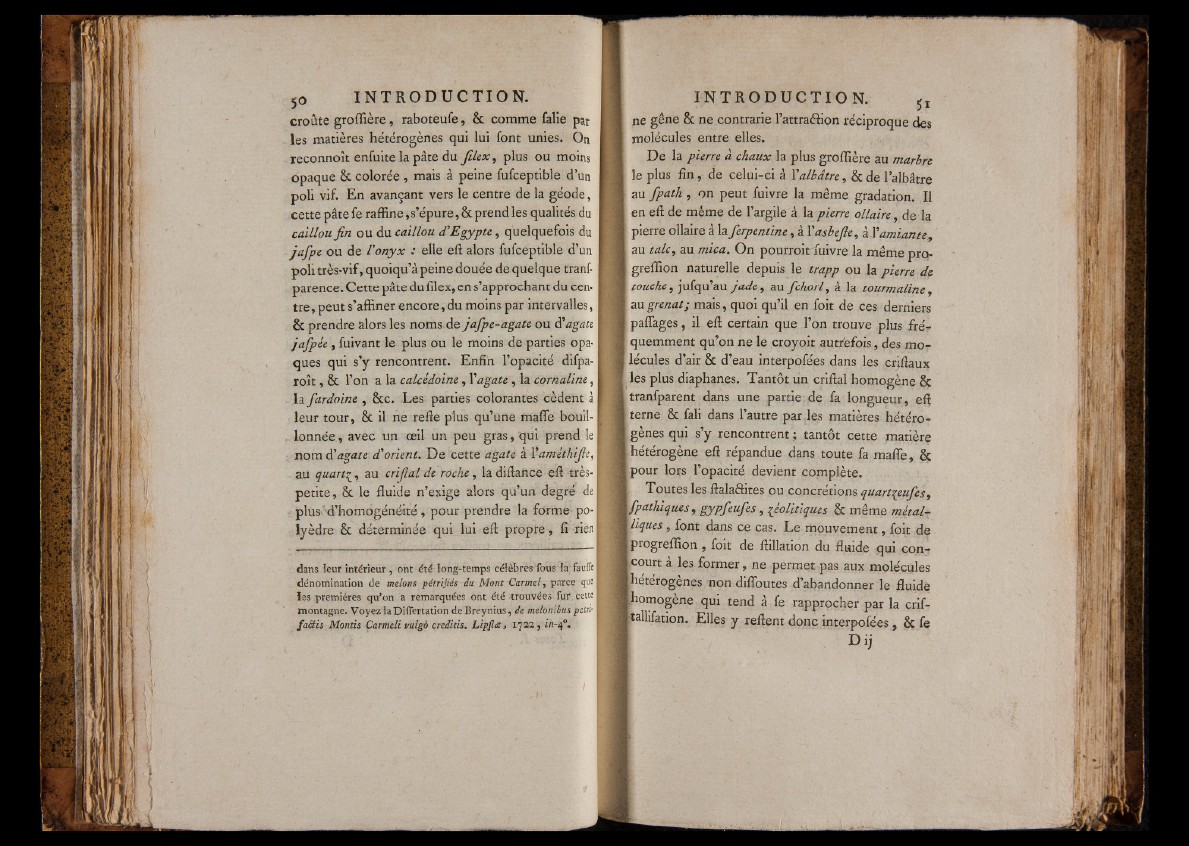
croate groffière, raboteufe, & comme falie par
les matières hétérogènes qui lui font unies. On
reconnoît enfuite la pâte du file x , plus ou moins
opaque & colorée , mais à peine fufceptible d’un
poli vif. En avançant vers le centre de la géode,
cette pâte fe raffine, s’épure, & prend les qualités du
caillou fin ou du caillou d'Egypte, quelquefois du
jafpe ou de l'onyx : elle eft alors fufceptible d’un
poli très-vif, quoiqu’à peine douée de quelque tranf-
parence. Cette pâte du iilex, en s’approchant du centre,
peut s’affiner encore,du moins par intervalles,
& prendre alors les noms de jafpe-agate ou d'agate,
jafpée, fuivant le plus ou le moins de parties opaques
qui s’y rencontrent. Enfin l’opacité difpa-
roît , fit l’on a la calcédoine , l’agate, la cornaline,
la fardoine , 8tc. Les parties colorantes cèdent à
leur tour, & il ne relie plus qu’une maffe bouil-
lonnée, avec un oeil un peu gras, qui prend le
nom d’agate d'orient. De cette agate kVamètkifie,
au q u a r t au cri fiai de roche, la diftance eft très-
petite, & le fluide n’exige alors qu’un degré de
plus -.'d’homogénéité , pour prendre la forme polyèdre
& déterminée qui lui eft propre, fî rien
dans leur intérieur , ont été long-temps célèbres 'fous îa faulit
dénomination de melons pétrifiés du Mont Carmel, parce que
les premières qu’ on a remarquées ont été trouvées fur tette
montagne. Vo yez ia DifTertation deBreynius, de melonièus petn-
fa&is Montis Çarmeli vulgà creditis. Lipfue, 1 7 2 2 , in-40.
ne gêne & ne contrarie l’attraèlion réciproque des
molécules entre elles.
De la pierre a chaux la plus groffière au marbre
le plus fin, de celui-ci à l’albâtre, & de l’albâtre
au fpath, on peut fuivre la même gradation. Il
en eft de même de l’argile à la pierre ollaire, de la
pierre ollaire à la ferpentine, à Yasbefle, à Y amiante,
au talc, au mica. On pourroit fuivre la même pro-
greffion naturelle depuis le trapp ou la pierre de
touche, jufqu’au jade, au fchorl, à la tourmaline,
au grenat; mais, quoi qu’il en foit de ces derniers
pairages, il eft certain que l’on trouve plus fréquemment
qu’on ne le croyoit autrefois, des molécules
d’air & d’eau interpolées dans les criftaux
les plus diaphanes. Tantôt un criftal homogène &
tranfparent dans une partie de fa longueur, eft
terne & fali dans l’autre parles matières hétérogènes
qui s’y rencontrent; tantôt cette matière
¡hétérogène eft répandue dans toute fa maffe, &
•pour lors l’opacité devient complète.
Toutes les ftalaâites ou concrétions quart^eufes,
■ fpathiques, gypfeufes, lèolitiques & même métal-
ïliques , font dans ce cas. Le mouvement, foit de
jprogreffiori , foit de ftillation du flaide qui concourt
a les former, ne permet pas aux molécules
Ibeterogenes non difloutes d’abandonner le fluide
jhomogene qui tend à fe rapprocher par la crif-
itallifation. Elles y relient donc interpolées, 8c fe
D i j