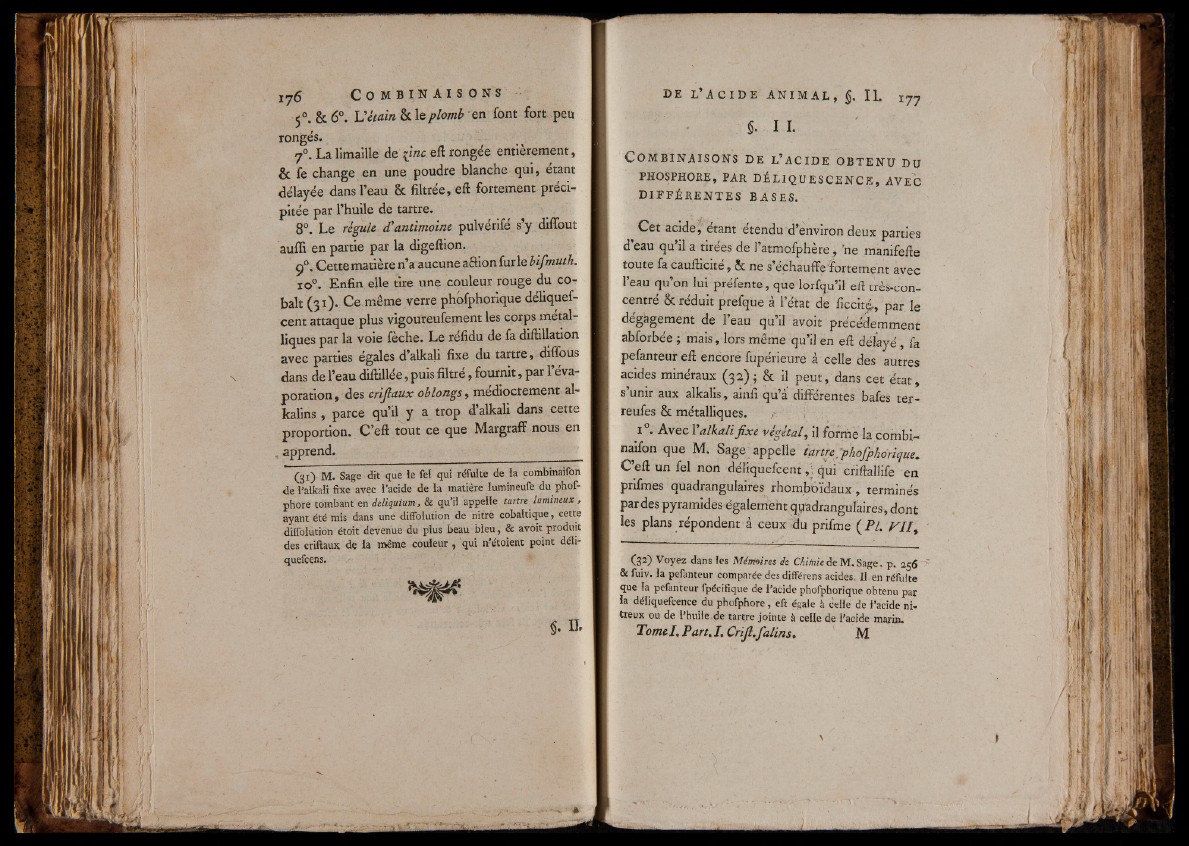
1 7 6 C o m b i n a i s o n s
5°. & 6°. Vétain & le plomb en font fort peu
rongés.
7 ° . L a limaille de (inc zb rongée entièrement,
& fe change en une poudre blanche q u i, étant
délayée dans l’ eau 8c filtrée, eft fortement précipitée
par l’huile de tartre.
8°. L e régule d'antimoine pulvérifé s’y diffout
auÎfi en partie par la digeftion.
ç 0. C e t te matière n’a aucune aftion fur le bifmuth.
io ° . E nfin elle tire une couleur roug e du c o balt
( 3 1 ) . C e .m êm e verre phofphorique déliquef-
c en t attaque plus vigoureufement les corps métalliques
par la vo ie feche. L e refîdu de fa diftillation
a v e c parties égales d’alkali fixe du tartre, diffous
dans de l’eau diftillée, puis filt r é , fo u rn it, par l’évap
o ra tio n , des crijlaux oblongs, médiocrement al-
Icalins, parce qu’il y a trop d alkali dans cette
proportion. C ’eft tou t c e que Margraff nous en
, apprend.
(3 1 ) M . Sage dit que ie fe! qui réfulte de la combinaifon
de l’aikali fixe avec l ’acide de la matière lumineufe du phof-
phore tombant en ie.liqu.ium, & qu’i! appelle tartre lumineux,
ayant été mis dans une diffolution de nitre cobaltique, cette
diffolütiôn étoit devenue du plus beau b leu , & avôit produit
des criftaux de la même copieur , qui n'étoient point déli-
quefcens.
D E L ’ A C I D E A N I M A L , §. I I . 1 7 7
§. I I.
C o m b i n a i s o n s d e l ’ a c i d e o b t e n u d u
PH O S PH O R E , P A R D É L I Q U E S C E N C E , A V E C
D I F F É R E N T E S B A S E S .
C e t a cid e , étant etendu d’environ deux parties
d eau qu’il a tirées de l’atmo fp h è re , ne manifefte
toute fa caufticité, & ne s’échauffe fortement avec
l ’eau qu’on lui p ré fen te , que lorfqu’il efttrès-con-
I centré & réduit prefque à l’état de ficcitei,, par le
I dégagement de 1 eau qu’il avoit précédemment
| abforbée ; mais, lors même qu’il en eft d é la y é , fa
pefanteur eft encore fupérieure à celle des autres
acides minéraux ( 3 2 ) ; & | p e u t , dans c e t é ta t ,
s’unir aux alkalis, ainfi qu’a différentes bafes te r -
4 reufes 8c métalliques. ;
i ° . A v e c Y alkali fixe végétal, il forme la combinaifon
que M. S age appelle i'artrejphofphàrique„
C ’eft un fel non déliquefcent ,1 q u i' criftallife en
prifmes quadrangulaires rh om b o ïd au x , terminés
par des pyramides également quadrangulaires , dont
les plans répondent à ceux du prifme ( Pl. V I I ,
(32) Voyez dans les Mémires de Ckitnie de M . Sage. p. 256
& fuiv. la pefanteur comparée des différens acides. Il en réfuite
que la pefanteur fpécifique de l’ acide phofphorique obtenu par
la déliquefcence du phofphore, eft égale à celle de l’acide ni-
Creux ou de l’huile de tartre jointe à celle de l’acide marin.
Tome I, Part. I.CriJl'falins. M